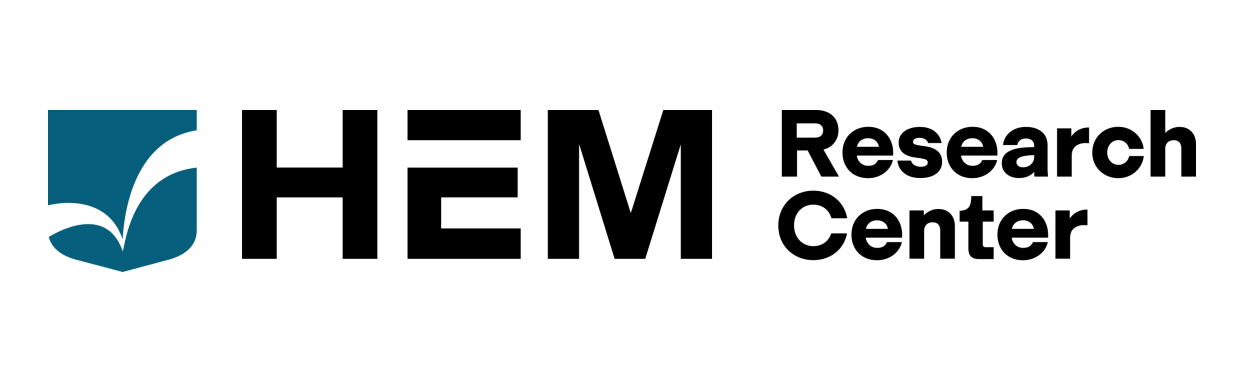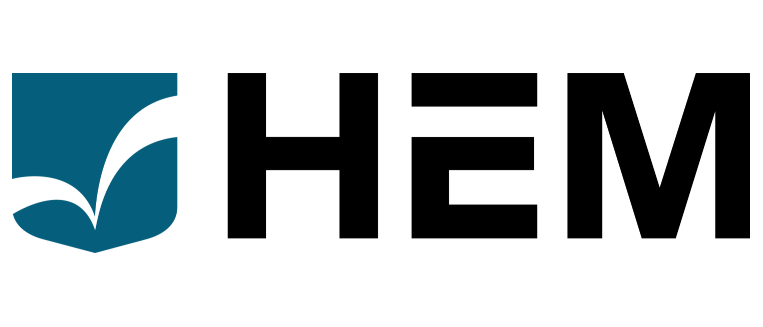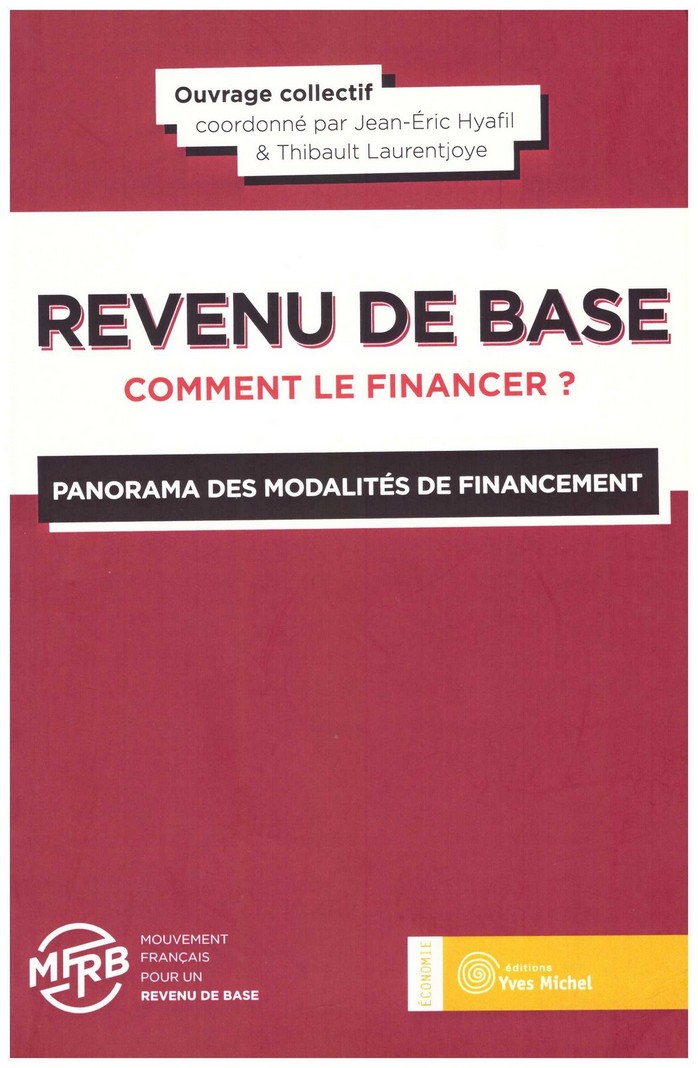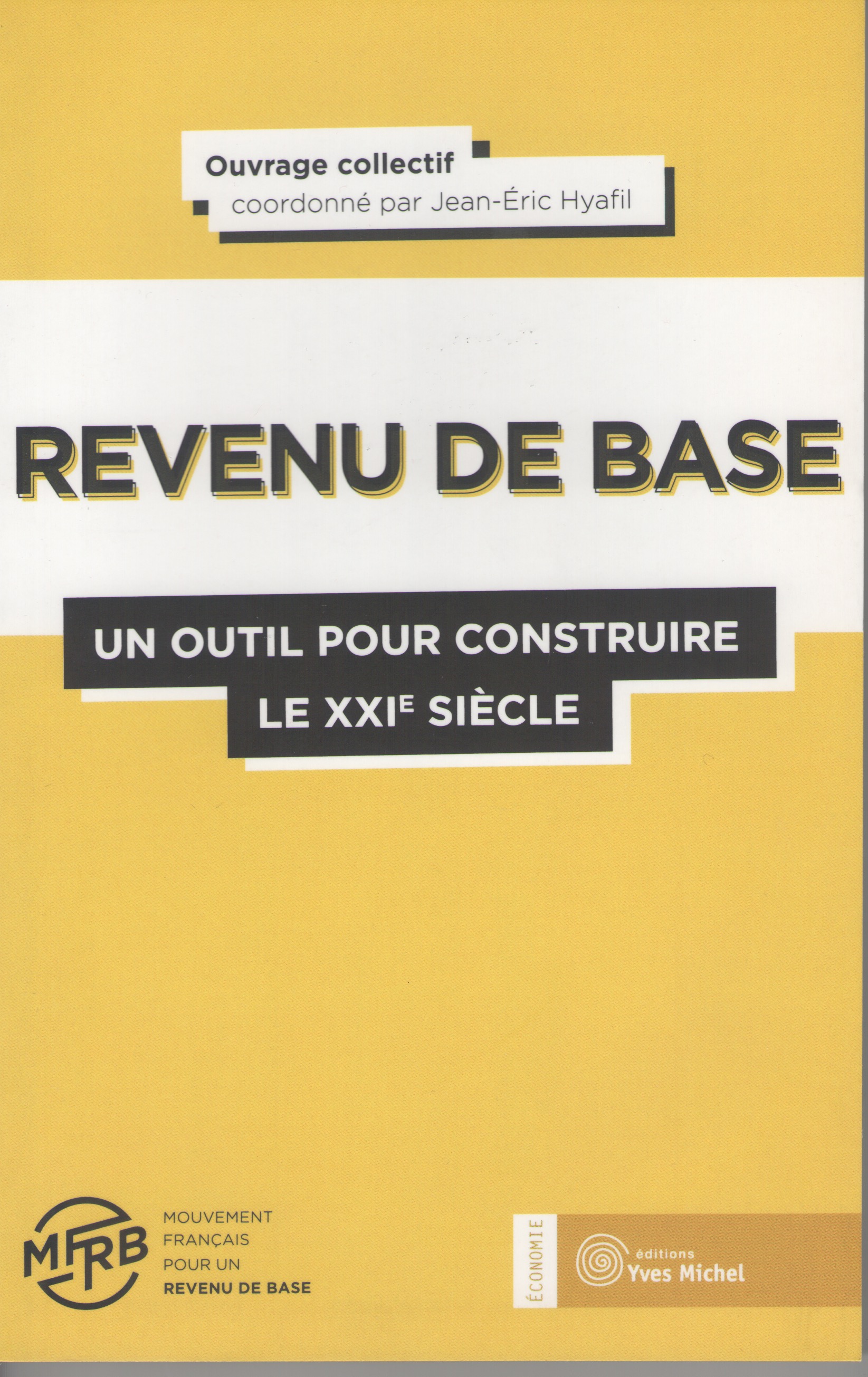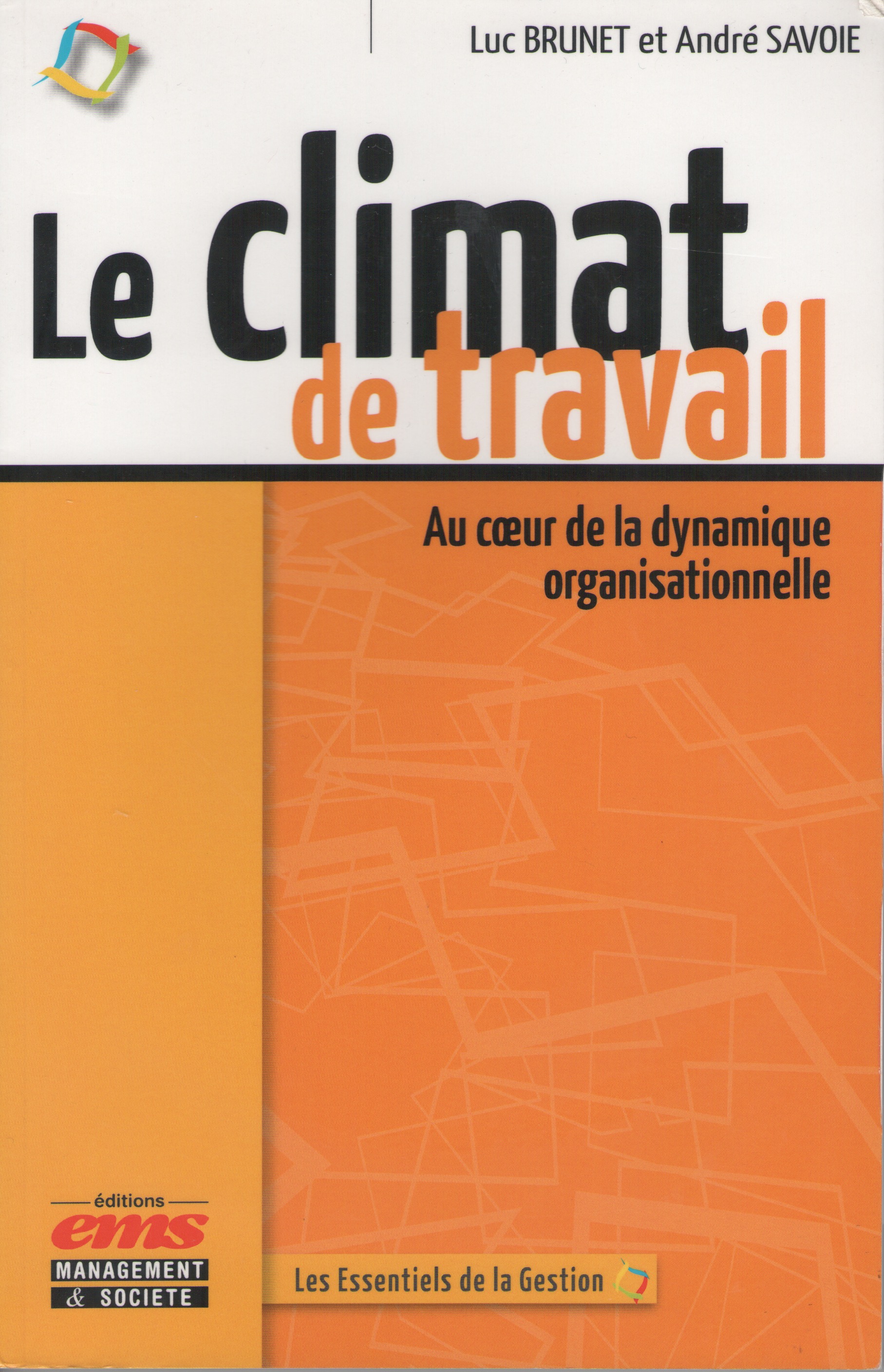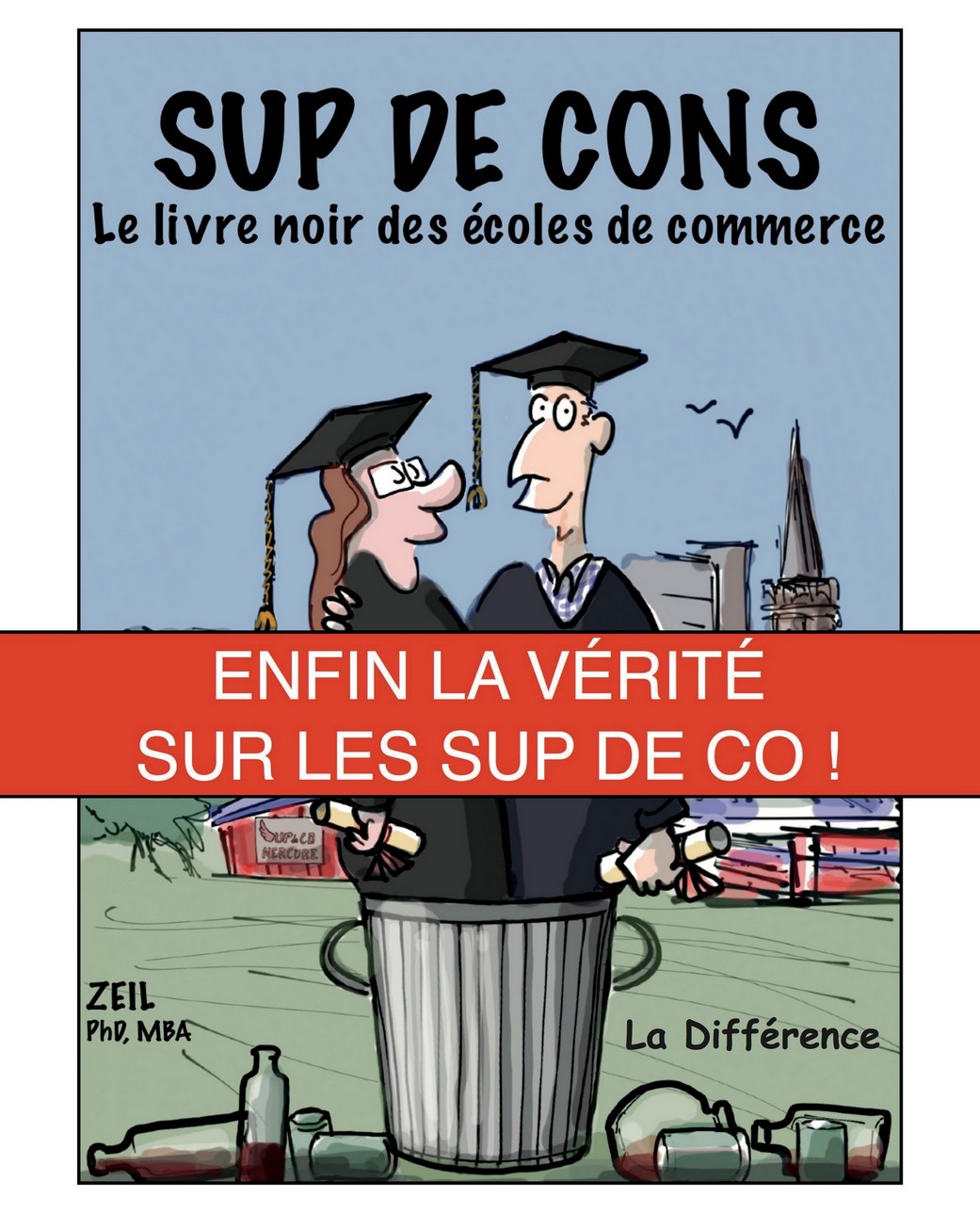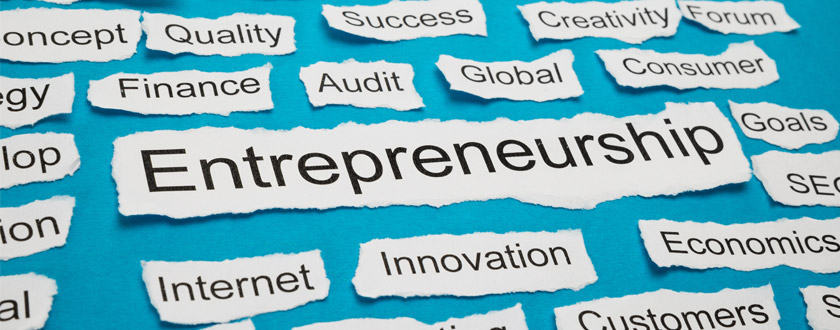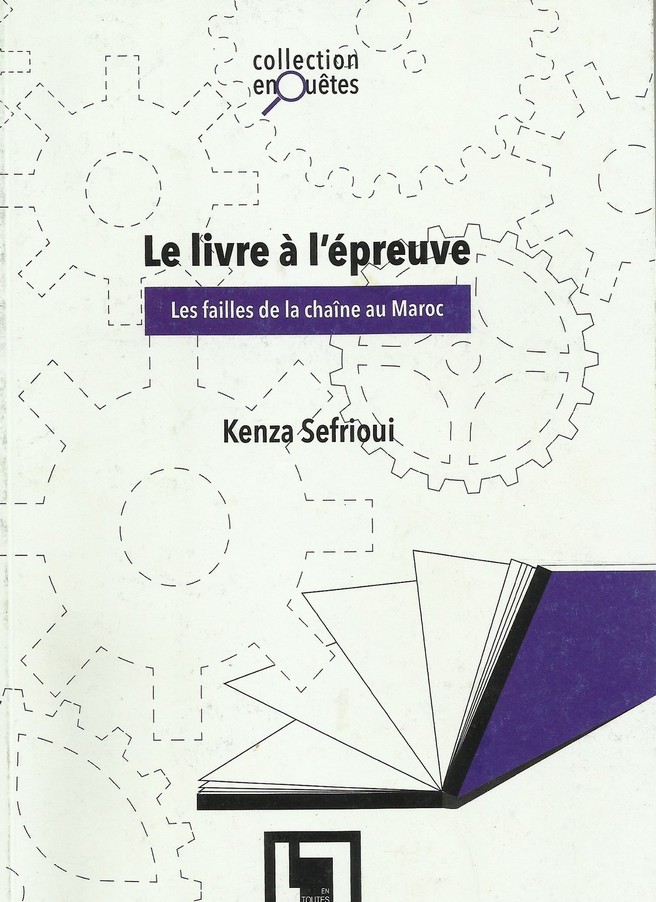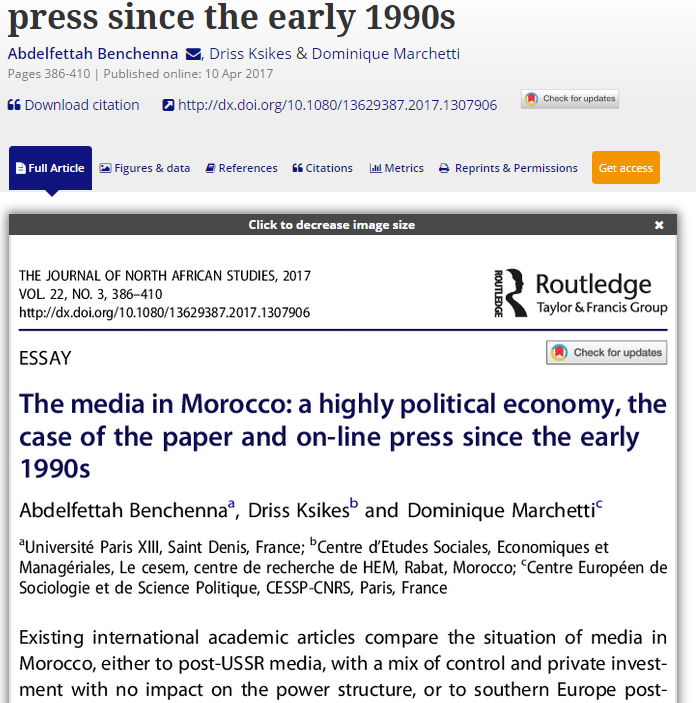Kenza Sefrioui [i]est une très belle plume qui aime les livres et les raconte merveilleusement ; cela on le sait, surtout sur les pages de www.economia.ma où l’auteure a eu l’habitude de faire régulièrement des notes agréables de lecture pour les nouvelles parutions. Cette année, à l’occasion de l’édition Siel de Casablanca 2017, elle vient de signer un travail très particulier, inscrit dans la série ‘’Collection Enquêtes‘’ dédiée au journalisme d’investigation et dirigée par Hicham Hodaifa[ii]. Il s’agit, en effet, d’une enquête sur le livre au Maroc. Une approche forcément louable, on ne le sait que trop, il n’y a pas beaucoup de travaux académiques ou journalistiques sur le sujet.
D’emblée Kenza Sefrioui nous décrit sur les plans quantitatif et qualitatif, l’absence du marché du livre au Maroc .La production marocaine ne dépasse pas 1300 titres par an et occupe une faible partie des rayonnages des librairies dominées par des livres importés de Liban, d’Egypte et de France. On ne vit pas de sa plume au Maroc, 35,5% des ouvrages sont édités à compte d’auteurs, et dans un contexte marqué par la défaillance des circuits de distribution. « Aujourd’hui les meilleures plumes marocaines sont publiées à l’étranger » constate-t-elle ; et pour les jeunes, le numérique avec ses blogs et ses réseaux sociaux apparait comme une alternative plus commode.
Kenza Sefrioui constate que le livre est resté le parent pauvre de la politique culturelle dans ce pays, il fut beaucoup moins loti que le cinéma par exemple. Il n’y a pas à ce jour de législation qui pourrait permettre de réguler le secteur et ouvrir la voie de son développement sain.
Selon une enquête datant de 2014 on a recensé 394 bibliothèques officielles dans un Maroc de plus de 34 millions d’habitants. Et il y aurait 3 millions de livres dans les bibliothèques d’où notre grand écart avec l’objectif de l’Unesco appelant à un livre par habitant ! En outre, la moitié des personnes inscrites dans les bibliothèques entretiennent un rapport utilitaire avec elles. C’est pour une formation ou l’acquisition d’un diplôme que les gens s’inscrivent! De même, le secteur de l’édition (comprenant le scolaire) représente moins de 1% du chiffre d’affaires global du secteur industriel, ce qui est vraiment dérisoire !
En 2014 l’auteure avait recensé 750 librairies très inégalement réparties au Maroc ; la faiblesse des ventes induit un cercle vicieux de réduction des tirages « un livre tiré à 1500 exemplaires met trois à quatre ans à se vendre. Sefrioui cite à ce propos M Sghir Janjar directeur de la fondation Al Saoud qui déclarait en 2016 « il faut cent doctorants pour avoir deux auteurs d’articles et de livres au Maroc ».
Dans ce combat inégal il y a cependant des héros, la fatalité qui frappe le domaine de la lecture et du livre n’arrive pas à prendre le dessus sur la détermination et la volonté de certains acteurs sociaux ; L’auteure cite le cas de l’association de Bouhouda dans la zone rurale de Taounate ; engagée dans des programmes de scolarisation non formelle et d’une bibliothèque très réussies et ce, malgré les difficultés matérielles et la vague rampante de l’obscurantisme.
Indisponibilité organisée
Kenza Sefrioui évoque aussi la question de la censure. Si officiellement celle ci n’existe pas au Maroc, il y a des procédés efficaces en usage (le système des visas obligatoire) qui la mettent en œuvre plus subtilement mais fermement consacrant ainsi les tabous nationaux (monarchie, religion, ..).Elle rapporte notamment pour les publications importées de l’étranger, « le Dernier combat du Captain Ni’mat » de feu Mohmed Leftah comme illustration récente de cas implicitement censurés.
La concentration du système de distribution se trouve illustré aussi par la domination de trois institutions qui ont l’exclusivité pour la distribution au Maroc de la plupart des éditeurs français : La librairie Nationale, Sochepress, et la Librairie des Ecoles. Les libraires marocains qui ont les moyens optent pour des demandes directes d’importation afin de pallier aux lenteurs du régime en vigueur ; cela ne permet cependant pas de surmonter le système omniprésent des visas, niant ainsi à tout un chacun le droit de choisir librement ses lectures.
Le piratage et la contrefaçon enfoncent le secteur
Kenza Sefrioui évoque aussi le cas des ouvrages piratés qui deviennent un phénomène en expansion rapide permettant d’avoir sur les étals de quelques librairies ou chez des Ferracha , les copies d’ouvrages demandés par le public à des prix beaucoup moins chers que les originaux .La révolution numérique a créé le boom de ce marché informel et déclenche le mécontentement des opérateurs du secteur lesquels exigent une action publique contre cette déviation fatale .
Dans cette contrefaçon il s’agirait d’un double circuit local et international. Le premier est installé à Casablanca avec un opérateur qui choisit les ouvrages très demandés, les renvoie à des petites imprimeries pour en faire 10 000 ou 20 000 exemplaires. Il procède ensuite à leur distribution à travers un pole installé à Kenitra utilisant un réseau informel efficace à travers l’ensemble du pays.
Le second circuit repose sur la même structure de distribution mais travaille et importe du Liban et d’Egypte sur commande les livres et ouvrages récents les plus demandés.
A cela s’ajoute le téléchargement à travers Internet ; l’enquête sur les pratiques culturelles rapporte que 14,4% d’un échantillon interrogé déclarent le faire pour des livres et documents écrits.
Parmi les autres défis du livre au Maroc, l’auteure évoque le recensement des ouvrages publiés. A ce jour, il n’est pas encore possible d’avoir une bibliographie nationale complète. D’après les professionnels, 20 % de la production environ n’est pas déclarée ou n’a pas de numéro légal. Ainsi chaque année, une partie non négligeable échappe à l’inventaire de la BNRM ; le grief souvent cité concerne la complexité et le cout des procédures ainsi que leur centralisation .De même, une partie non négligeable des livres édités à compte de leurs auteurs n’ont pratiquement aucune vie commerciale, ils restent dans le cercle restreint des amis et de l’entourage.
Kenza Sefrioui a suivi le parcours annuel de deux documentalistes qui effectuent un recensement pour le compte de la Fondation AL Saoud et de la BNRM ; un travail fastidieux en l’absence de la numérisation des prestations chez la plupart des libraires et la domination de l’informel. Cet effort parvient à améliorer l’inventaire des publications par an mais reste incomplet, il y a nécessité de mettre des moyens plus importants. Pour le moment, chez la plupart des « libraires » « la règle c’est le modèle papeterie, tabac, photocopie, et des employés malheureux.. ». Certes, « le livre en français bénéficie d’éditeurs et de libraires plus professionnels » ainsi que d’une information mieux partagée. Mais « Pour le livre en arabe, c’est l’arbitraire ». « Le livre peut être sérieux mais le lecteur n’a pas d’information à son sujet ». « Hors de l’axe Casa-Rabat c’est l’anarchie totale, une activité presque totalement informelle ».
Partir pour exister ?
Faut-il quitter le Maroc si l’on a un projet d’écriture ? Leila Slimani qui a eu le Goncourt 2016 répond par la négative, mais souligne la nécessité d’une bonne relation avec l’éditeur. La liste des auteurs expatriés est pourtant assez longue ; depuis Driss Chraibi à ce jour, sans oublier celles et ceux qui tout en résidant au Maroc, évoluent dans des circuits à l’étranger. Chacun a ses griefs, l’auteur Youssef Fadel explique que la diffusion se fait mieux à l’étranger offrant une meilleure audience aux auteurs et aux œuvres, mais pour Mohamed Hmoudane « si les distributeurs sont des filiales de groupes français, comment voulez vous qu’ils s’intéressent à un livre marocain ? Sans diffusion ni distribution, le livre est mort né ». Kenza Sefrioui rapporte également les témoignages de Taher Benjelloun et Abdelatif Laabi sur le sujet. Mais Elle finit par se rendre à l’évidence, celle cruciale et inévitable relative à la politique culturelle du Maroc. « Il faut que le pays s’autonomise et de consommateur devienne producteur de culture » disent en substance toutes et tous les auteur(e)s .Il faut commencer par un effort en éducation et chercher à consolider un lectorat dans le pays ….
Le dernier chapitre de ce livre est consacré aux passeurs de livres, il s’agit de personnes ou d’initiatives destinées à encourager la lecture. Kenza Sefrioui y rappelle d’abord qu’en 2011 le HCP avait annoncé -dans le cadre de son enquête sur L’emploi du temps des Marocains- que ces derniers dépensent en moyenne 1 dh par an et par personne pour le livre ; soit 25 fois moins que la moyenne mondiale .Une autre enquête de l’association Racines en 2016 sur les pratiques culturelles avait révélé que 15,2% de l’échantillon marocain interrogé affirment ne lire jamais de livres.
On retiendra dans ce chapitre en note d’espoir, l’initiative du club conscience estudiantine qui organise des groupes de lecture à la Fac à Casablanca, celle des bouquineurs de Rabat avec Facebook, « Dakhla bktab » de Marwan Naji, et le « Réseau de lecture au Maroc » engagé depuis 2013 et qui est en cours d’extension à ce jour.
[i] Elle est l’auteure de l’étude « la revue Souffles(1966-1973)espoirs de révolution culturelle au Maroc »Editions du Sirocco .(Prix du Grand Atlas 2013 )
[ii] Editions :En toutes lettres
Par : Bachir Znagui