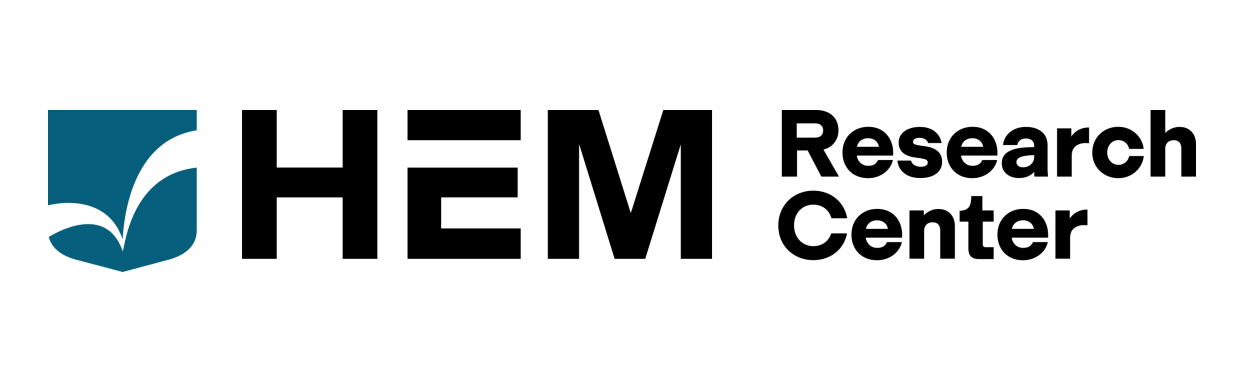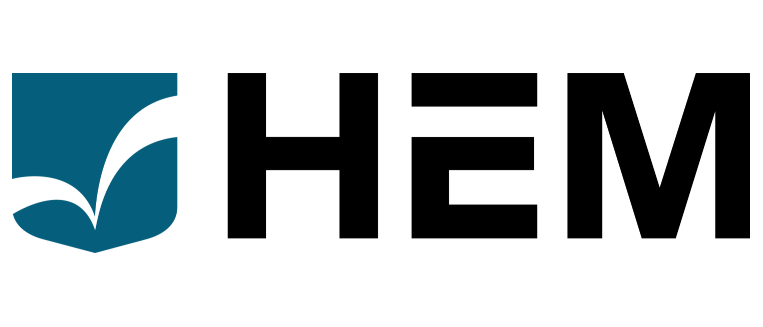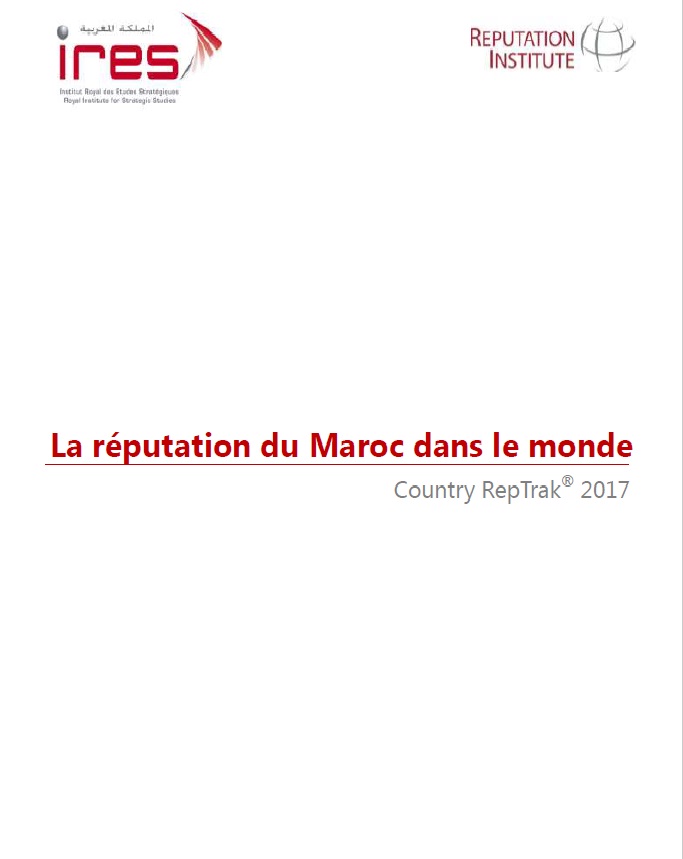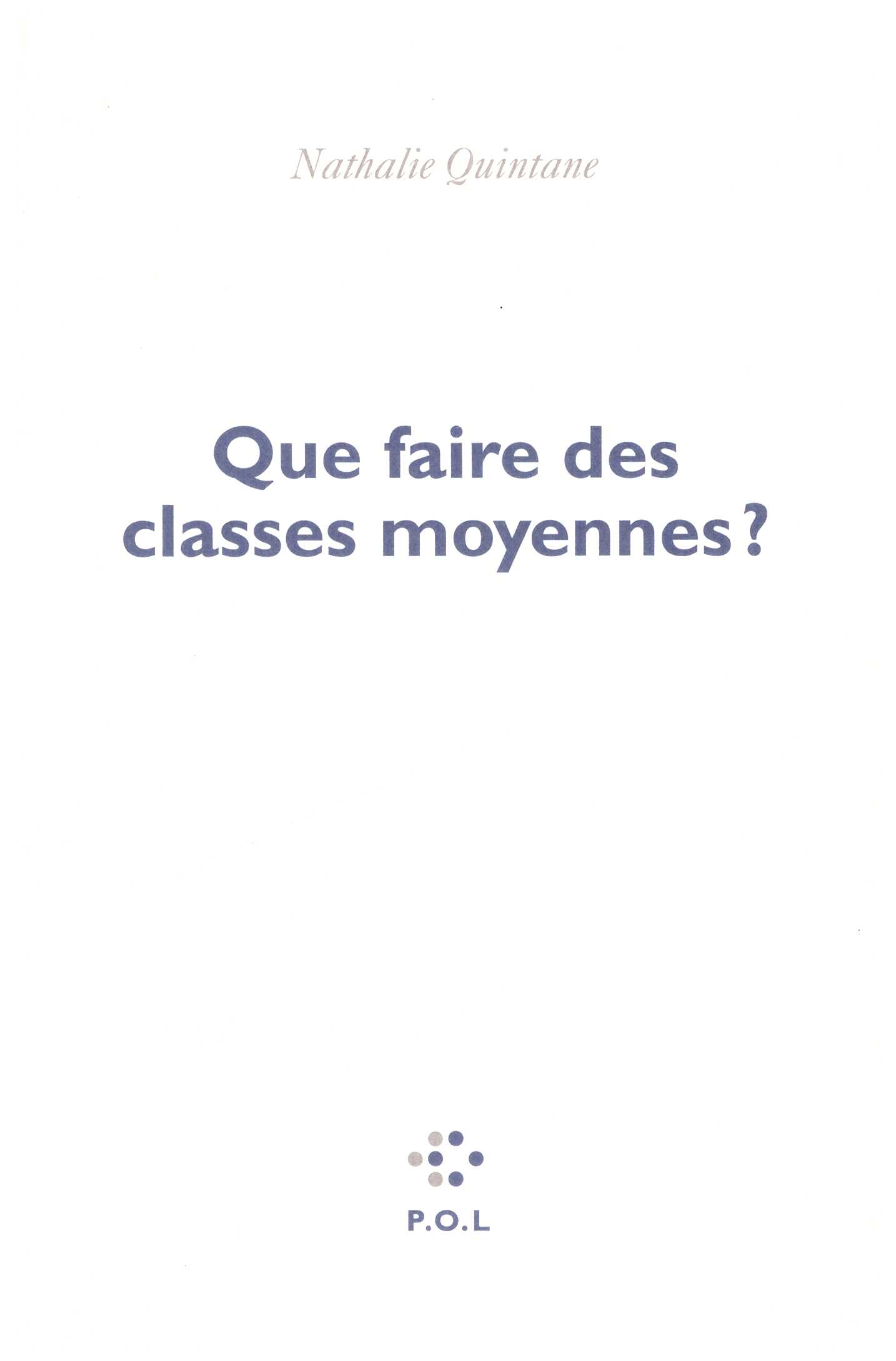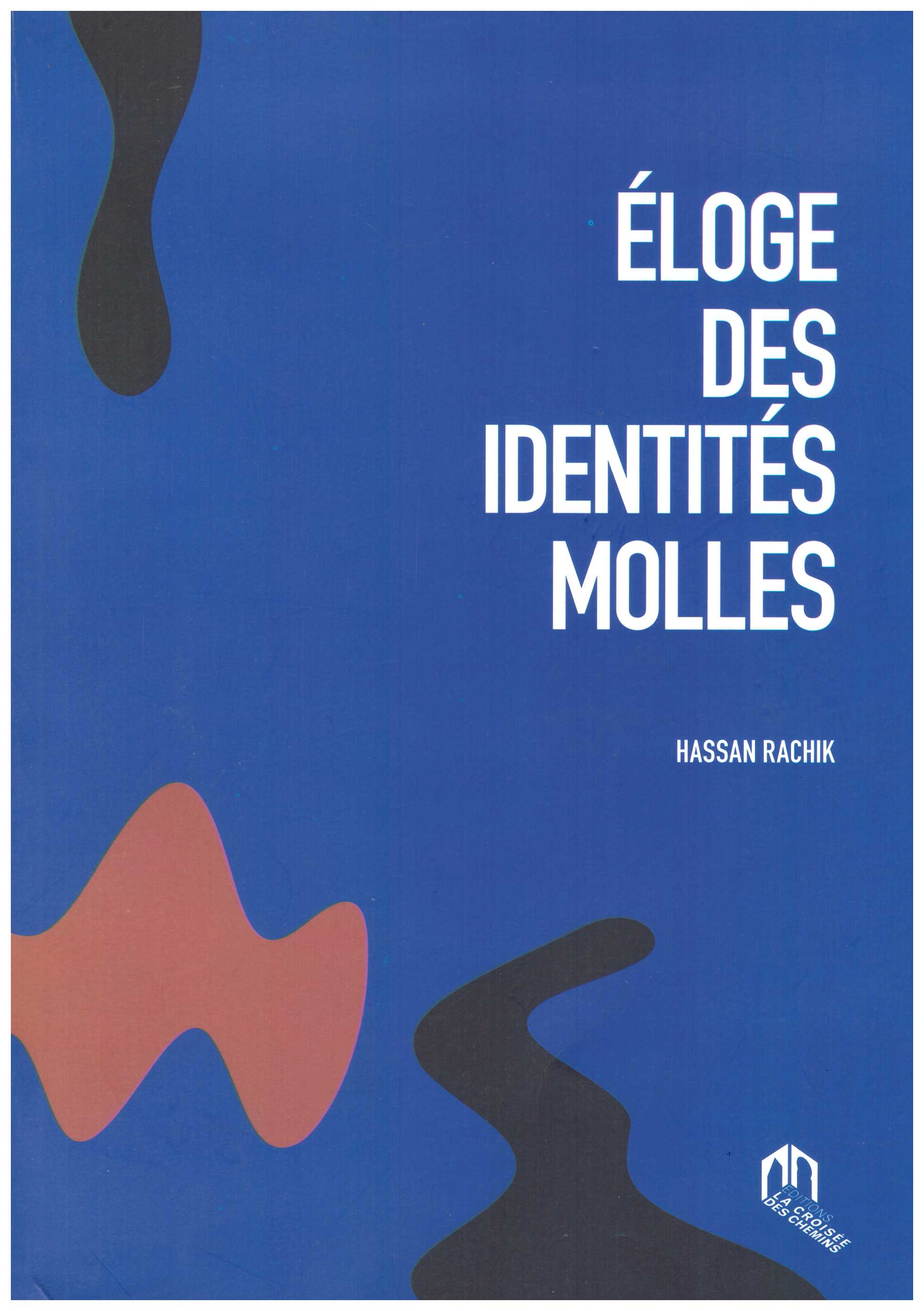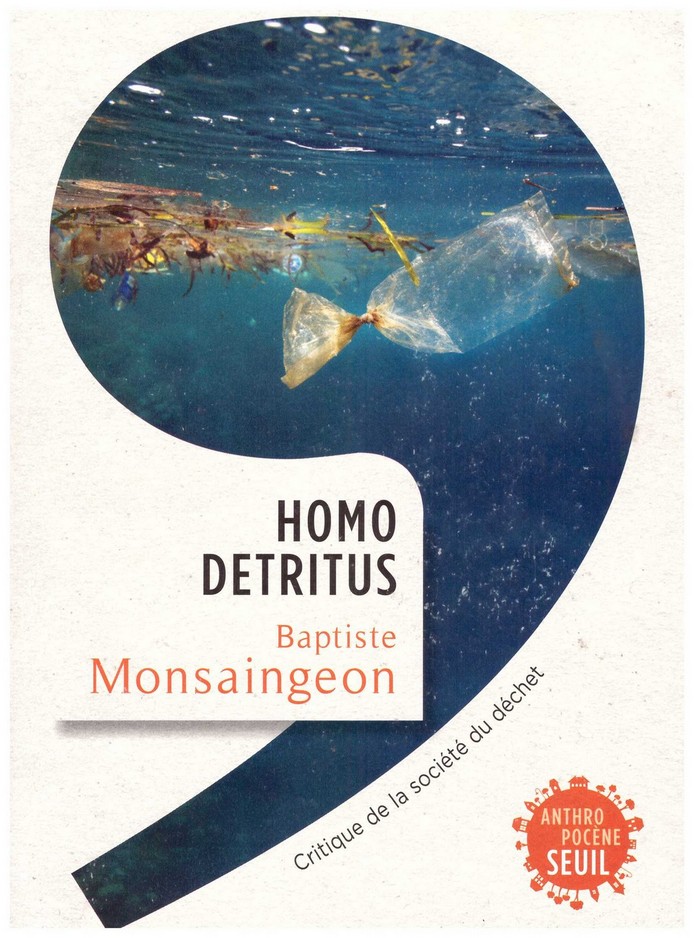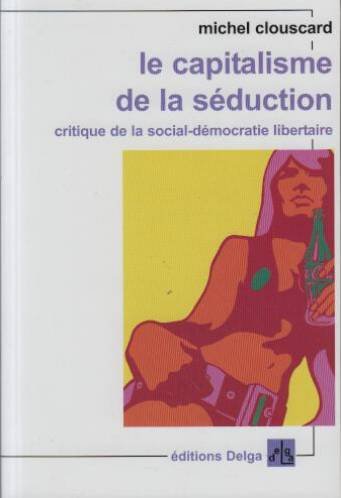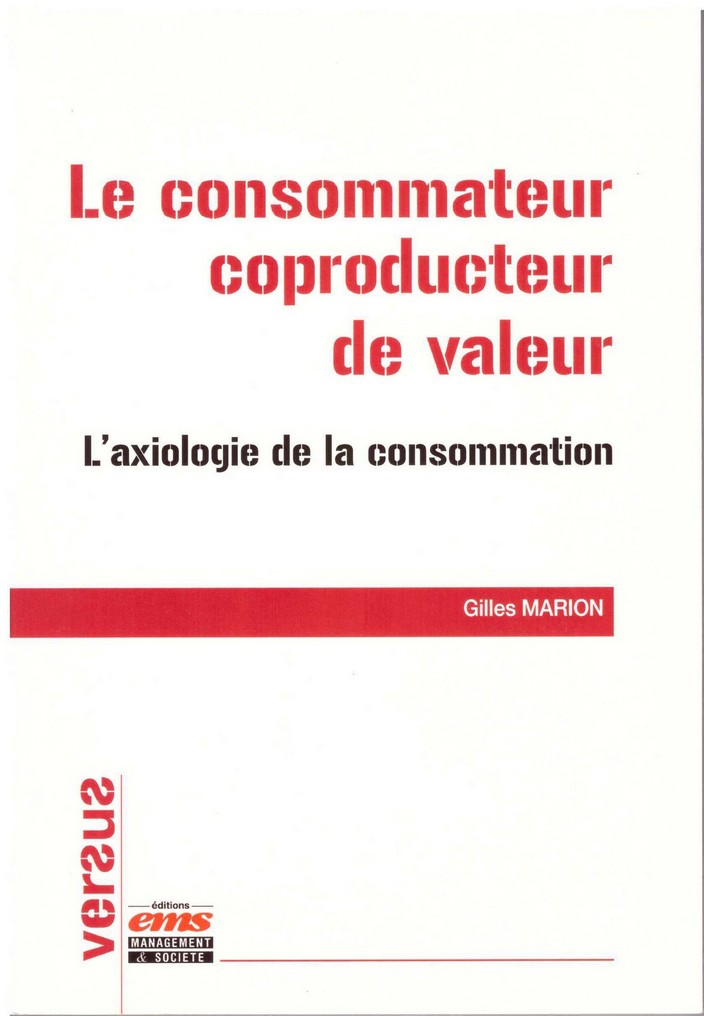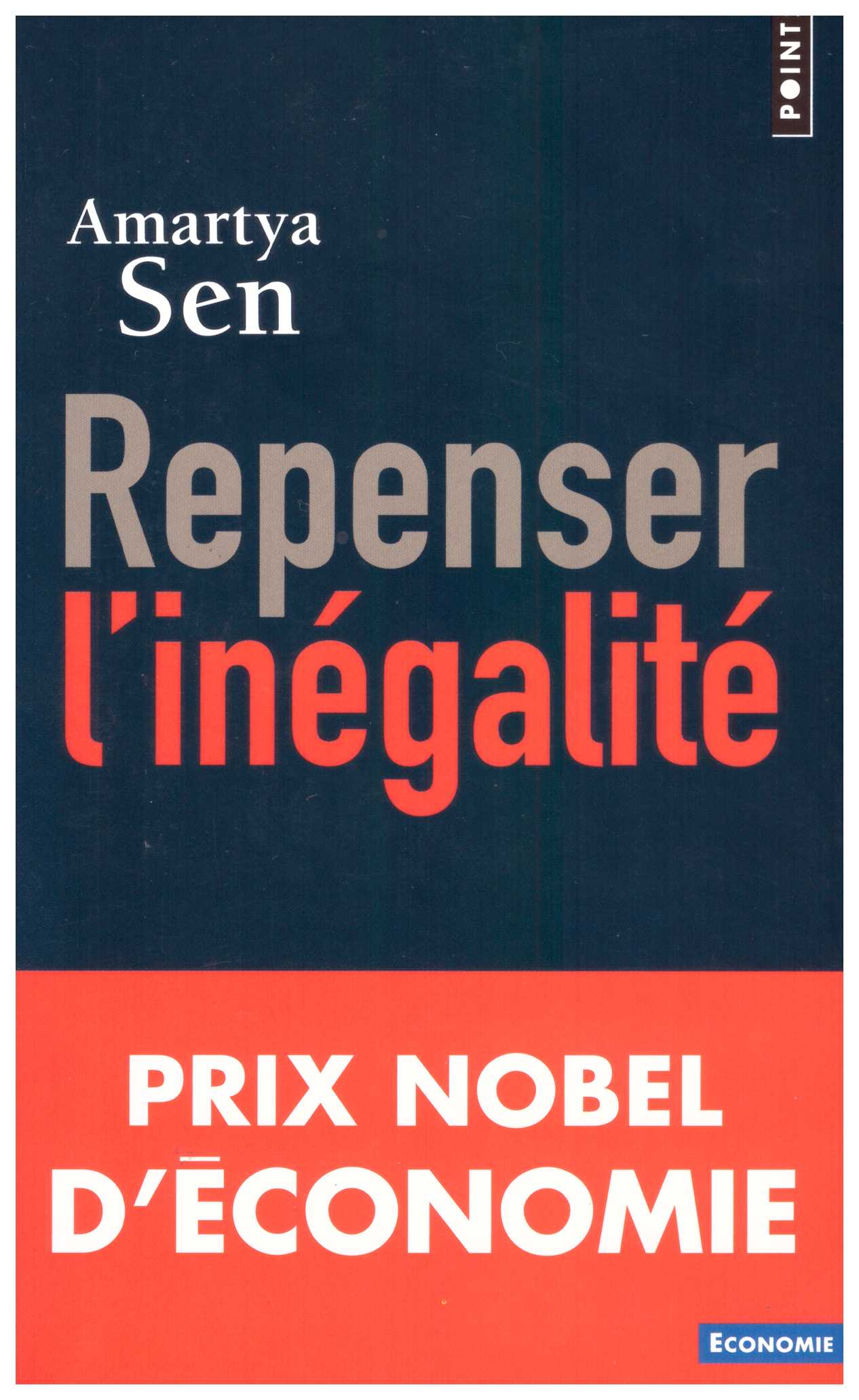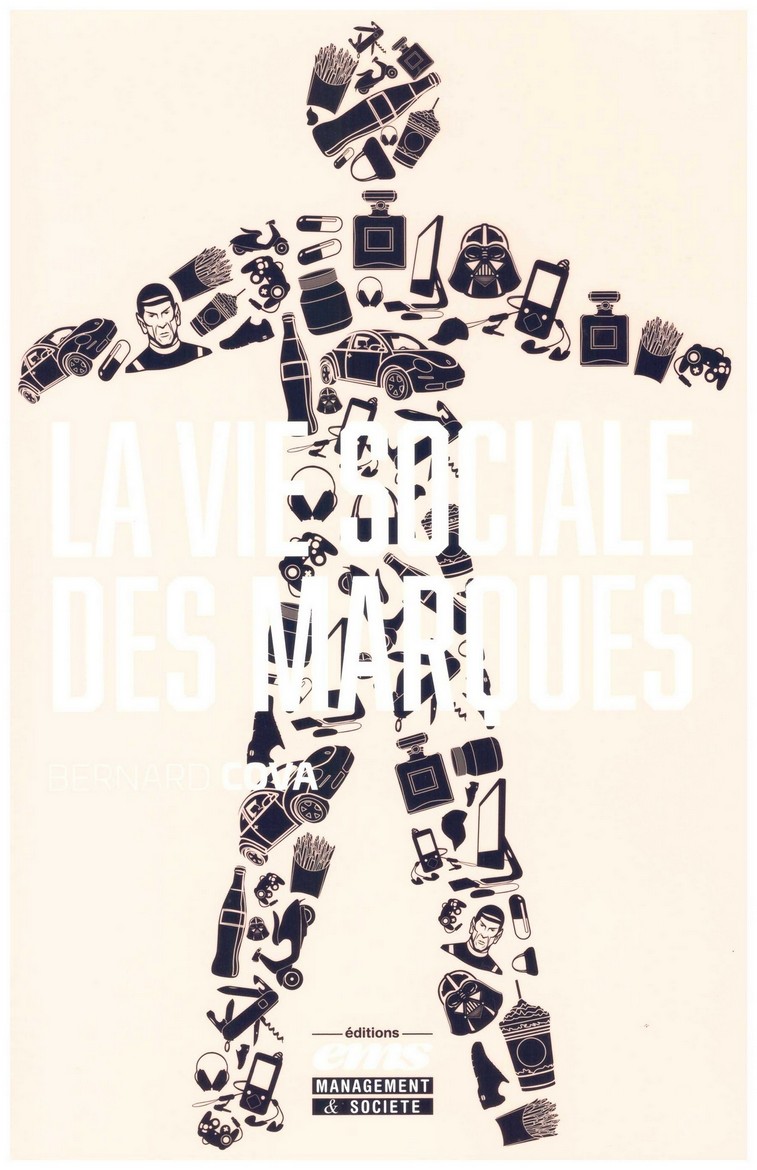

Mohamed DOUIDICH

Claude Courlet
La société de marques
Auteur : Bernard Cova
Le sociologue Bernard Cova analyse les marques à l’aune de l’ethnosociologie, pour comprendre le rôle du marché dans la construction identitaire.
Les marques, objet économique ? Pas seulement : elles structurentle quotidien, l’articulation entre sphère privée et sphère professionnelle, le lien social, bref, l’identité. Cela fait peu de temps que les marques sont objet d’étude pour la sociologie et l’anthropologie, rappelle Bernard Cova, qui enseigne la sociologie de la consommation et le marketing dans une Business School de Marseille. Alors que l’idée qu’on vit dans une société qui pousse les individus à consommer sans cesse davantage est largement admise et analysée depuis les années 1960, la sociologie de la consommation n’a émergé comme champ d’étude que vers les années 1990. L’auteur explique que son titre est un clin d’œil à La vie sociale des objets (The social life of things, 1986) d’Arjun Appadurai, « qui montre comment les objets sont omniprésents dans notre vie quotidienne ». De même, les marques sont devenues si omniprésentes qu’elles débordent largement du champ économique, au point d’échapper aux entreprises qui les ont créées et de générer de nouveaux types de liens.
Bernard Cova analyse dans une première partie cette « société de marques » dans laquelle nous vivons : « Nous sommes passés de sociétés dont le pilier central était le travail à des sociétés dont le pilier central est la consommation. » Consommer de la culture, du tourisme, du sport, etc., est devenu une manière d’exister et de se construire. Or, dans un monde où le travail est devenu synonyme de stress ou d’ennui et vous expose au burn-out ou au bore-out, c’est aussi une manière de fuir des conditions de vie de plus en plus pénibles : « Moins que de chercher à échapper à la consommation, l’individu d’aujourd’hui s’échappe par la consommation et les expériences qui lui sont associées. »Il s’affirme désormais par sa passion eten tire une reconnaissance fondée sur le partage de ses centres d’intérêts et de ses expériences, « une reconnaissance horizontale par d’autres personnes passionnées [plutôt] qu’une reconnaissance verticale par une autorité surplombante ou une hiérarchie. » Mais, note l’auteur, lecteur de L’Incendie de la maison de George Orwell d’Andrew Ervin (2015), même dans sa stratégie de fuite, l’individu ne fait que pratiquer une « fragile inversion du quotidien », qui ne le fait nullement échapper aux impératifs de la consommation.
Dimension religieuse
Bernard Cova se penche sur les « artefacts symboliques » par lesquels les marques donnent sens à la vie des individus, et souligne l’importance de la métaphore religieuse dans ce domaine. Il distingue « marque iconique », et « marque culte ». « Une marque devient iconique lorsqu’elle délivre un mythe identitaire », statut réservé à de rares marques, comme Apple, Harry Potter, Lego, Nutella, Google, Star Wars, etc. au niveau mondial, ou comme Vespa en Italie, au niveau national. Quant à la marque culte, elle est l’emblème d’une communauté et contribue à une « sous-culture » : ainsi de Atari pour les fans de jeu vidéo. « Le pouvoir d’une marque ne provient pas de la richesse de ses associations mentales comme on le pensait traditionnellement en marketing, mais du mythe qu’elle porte pour résoudre les contradictions culturelles au sein de la société. » La théorie du branding culturel souligne la dimension à la fois culturelle et politique d’une marque. Exemple : Nike défendant la liberté face aux discriminations sociales.
L’auteur s’attache ensuite à décrire comment notre quotidien est « marqué ». Le passage d’un nom de marque à un nom commun ou à un verbe – ubériser, googler, etc. – est significatif de l’imprégnation de la société. Au départ, les entreprises (Kleenex, Tupperware…) luttaient contre ce « généricide », ou usage générique de leur nom de marque. Aujourd’hui, elles développent des stratégies, soit de gamme de produits (un iPad est forcément un Apple), soit de contenu de marque pour définir une référence identitaire. Aujourd’hui, le brandverbing à la mode nous vaut des snapchater, airbnbiser, et autres goproiser. Autre critère, la prolifération de communautés de marques, tribus qui ne sont plus seulement consommatrices mais animent une sous-culture avec ses codes, ses rôles et ses rituels, et deviennent des agrégateurs. Parfois, ces tribus en viennent à s’estimer dépositaires de l’esprit de la marque. Ainsi, le conflit entre les loggionisti et la direction de la Scala de Milan : ces fins connaisseurs de bel canto terrorisent les plus grands chanteurs d’opéra qui fuient le célèbre théâtre par peur de leurs huées. Les journées de marque sont aussi l’occasion de constater « l’attachement quasi religieux des fans » : le 4 mai, les fans de Star Wars prennent un congé pour se déguiser et se regrouper. Bernard Cova fait le parallèle entre fêtes religieuses et fêtes profanes (mystique, pèlerinages, rituels quotidiens, etc.) et souligne « la diffusion du divin dans la vie quotidienne ». Un pas est franchi avec la « surfaçon de marque », quand les fans enrichissent leur marque, qui échappe ainsi au management de l’entreprise. Par exemple, les épisodes de suite de la série Star Trek. Qu’elle soit lucrative ou non, cette pratique est « un laboratoire d’usages pouvant être captés par le marché afin d’offrir de nouvelles opportunités aux investisseurs et aux entreprises détentrices de la marque. » C’est aussi un indice du « glissement de la marque du marché vers la société ». Enfin le phénomène des volontaires de marque témoigne d’une mutation de l’engagement militant et pérenne vers des formes plus éphémères et hédonistes de mobilisation. D’où la multiplication des programmes de marketing collaboratifs pour profiter de ces apports. La question se pose alors de la limite entre le bénévolat et le travail (orienté mais non rémunéré).
Bernard Cova brosse un panorama critique de cette situation, et consacre la dernière partie du livre à ses dangers. D’abord la « perte de compétences non marquées » : on est imbattable sur l’univers de sa marque préférée, mais incapable de réparer un appareil domestique, de connaître le rythme des saisons… Crise écologique et culturelle menacent. Les initiatives d’autoproduction peuvent être une alternative. Là encore, les entreprises ont flairé le créneau de « l’autoproduction accompagnée » : on s’autonomise de l’entreprise, mais pas de la marque… D’autre part, la consommation est le symptôme de relations de don et contre-don affaiblies : il s’agit de reconstruire des formes d’entraide, parfois basées sur d’anciennes traditions, comme le café suspendu à Naples, en veillant à ce qu’elles ne soient pas, là encore récupérées. Un essai fin et nuancé sur un phénomène qui s’étend bien au-delà du marché.
Par Kenza Sefrioui
La vie sociale des marques
Bernard Cova
Éditions EMS, 208 p., 280 DH
La réputation du Maroc dans le monde en 2017
Auteur : Réalisé par le "Reputation Institute" en partenariat avec l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES)
Les sept défaillances d’une marque
Les structures et les entités (des organisations) sont de plus en plus considérées en tant que marques à jauger, comparer, consommer ou bannir. La notion de réputation est désormais une affaire ‘’universelle’’ de marketing. On estime que les pays, les nations, les Etats sont aussi des marques dotées de bonne ou de mauvaise réputation, il s’agit d’un capital ou patrimoine qui renforce les atouts économiques et commerciaux d’un pays , tout comme il est susceptible de leur porter préjudice .Le management est allé jusqu’à explorer les outils capables d’offrir des approches quantitatives dans ce domaine . Et même tardivement, au Maroc aussi la question de la réputation commence, à devenir un sujet à la fois d’enquêtes, de recherches et de préoccupation !
Une réputation ça se cultive
Le rapport qui vient d’être rendu public au début de cette rentrée 2017/2018 a été achevé en juillet 2017. Réalisé par le "Reputation Institute". en partenariat avec l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) il constitue la troisième édition de l'étude sur la réputation du Maroc dans le monde. Le R I est une institution spécialisée qui travaille sur la question surtout au bénéfice des entreprises. Introduite en 2008, l’étude "Country RepTrak®" représente une analyse de la réputation des pays, basée sur un modèle inspiré de la mesure de la réputation des entreprises. Sur le plan méthodologique, les attributs retenus pour mesurer la réputation des 71 pays de l'échantillon sont au nombre de 17, parmi lesquelles la sécurité, la transparence, le bien être social, la qualité des produits et services.…. L’analyse factorielle de ces 17 attributs a permis de les regrouper en trois facteurs que "Reputation Institute" a appelés les dimensions de la réputation d’un pays : qualité de vie, niveau de développement et qualité institutionnelle.
Le travail de terrain fut réalisé en interrogeant un échantillon d'individus issu de 30 pays, composé du grand public, sur les perceptions que ces individus ont de leur propre pays et par rapport à d’autres nations. : Plus de 39 000 personnes ont été interrogées fournissant des notes internes et externes. Les évaluations sont basées sur un échantillon minimal de 100 évaluations pour chaque pays dans chacun des marchés où il est évalué.
Pour ce rapport, en plus du G-8, l’étude a été réalisée dans un autre groupe de pays choisi par l’IRES, lequel inclut, notamment, le Brésil, la Chine, l’Espagne, l’Inde, la Corée du Sud, le Maroc, le Mexique, les Pays-Bas, la Turquie et l’Afrique du Sud.
Différence entre l’évaluation externe dans les pays du G-8 et l’évaluation interne des attributs du Maroc

En termes de résultats, selon le rapport, le Maroc obtient en 2017 une note de 59,3 points sur une échelle de 0 à 100, pour l’indicateur général de la réputation des pays "Country RepTrak® Pulse", ce qui lui confère la 35ème place sur un total de 71 pays évalués. Le Royaume figure, également, parmi les 37 pays ayant la meilleure réputation, au même niveau que Porto Rico, l’Argentine, le Brésil, l’Indonésie et l’Inde.
Une qualité de vie au Maroc plutôt appréciée
La première étude relative à la réputation du Maroc, réalisée en 2015, a concerné un échantillon de 18 pays. La seconde et la troisième édition de cette étude ont porté en 2016 et 2017 sur un échantillon, respectivement, de 23 et 22 pays.
Les évaluations les plus positives de la réputation externe du Maroc concernent les attributs afférents à la qualité de vie (environnement naturel, population aimable et sympathique, loisirs et distractions et style de vie), et à la qualité institutionnelle, en particulier, la sécurité et l'usage efficace des ressources. Les évaluations les moins favorables se rapportent aux attributs de la dimension "Niveau de développement", notamment, le système éducatif et la technologie et l'innovation. De même la réputation interne est négative, comparativement à la réputation externe, pour ce qui est des attributs relatifs au système éducatif, à l'utilisation des ressources, à la technologie et l'innovation, à l'environnement politique et institutionnel, à l'éthique et la transparence et au bien-être social. Le rapport souligne à ce propos que «ces insuffisances, pourraient constituer des risques réels pour la réputation tant interne qu'externe du Maroc, et sont de véritables défis qu'il serait essentiel de relever ».
Le rapport constate que la réputation du Maroc a connu une certaine amélioration en 2017, comparativement à 2016, en France, au Nigéria, en Chine et en Allemagne. Elle s’est détériorée par contre en Turquie, au Chili, en Inde et en Belgique. La comparaison des résultats de 2017 avec ceux de l'année 2016 révèle unedétérioration de la réputation du Maroc en Turquie pour les attributs liés à la sécurité, à la qualité des produits et services, à la technologie et l’innovation, au système éducatif et à la culture. Les citoyens turcs recommandent nettement moins en 2017 qu’en 2016 de visiter et de vivre au Maroc.
Les personnes interrogées aux Pays-Bas, en 2017, ont un comportement de soutien plus favorable envers l'Afrique du Sud, le Chili et le Mexique, comparativement au Maroc. Ce résultat concerne l'ensemble des comportements de soutien. De même, Les personnes interrogées en Afrique du Sud, en 2017, ont un comportement de soutien plus favorable à l'égard de l’Afrique du Sud que du Maroc et du Mexique. L'ensemble des scores attribués à l’Afrique du Sud sont supérieurs à ceux accordés au Maroc.
Les Marocains sont très critiques envers le système éducatif et le manque de transparence
Le rapport fait remarquer qu’en règle générale, la perception interne est plus positive que la perception externe. Une différence entre les deux réputations, de l'ordre de 10 à 15 points, se dégage dans la plupart des cas. Mais les résultats obtenus apportent, toutefois, des exceptions importantes à cette règle générale. Dans certains pays, comme la Russie, les Etats-Unis et la Turquie, les personnes interrogées ont une perception très favorable de leurs pays, qui se traduit par une différence entre les réputations interne et externe de l'ordre de 40,8 points pour la Russie, de 23,4 points pour les Etats-Unis et de 18,8 points pour la Turquie.
À l’autre extrémité, les citoyens de quatre pays (Espagne, Italie, Afrique du Sud et Brésil) sont très critiques envers leur pays, ce qui se traduit par une différence négative entre les réputations interne et externe.
Les citoyens marocains estiment que les points forts de leur pays résident dans les attributs "Environnement naturel", "Population aimable et sympathique" et "Sécurité". Il convient de rappeler que ces trois attributs sont les piliers les plus importants de la réputation d’un pays. Mais force est de constater, néanmoins, que même si les Marocains sont conscients des points forts de leur pays, ils estiment que ces attributs ne suffisent pas pour forger les bases d'une réputation solide du Royaume, à l'échelle internationale. En effet, 7 parmi les 17 attributs examinés affichent des scores significativement faibles : " Ethique et transparence ", " Environnement institutionnel et politique ", " Bien-être social "," Usage efficace des ressources "," Système éducatif", " Marques et entreprises reconnues " et " Technologie et innovation ". Ils n'atteignent même pas le seuil des 35 points. Pour l’attribut " Technologie et innovation ", le score obtenu se situe à 15,4 points.
Par Bachir Znagui
Rapport "La réputation du Maroc dans le monde en 2017". Réalisé par le "Reputation Institute" en partenariat avec l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES)
Attention aux classes moyennes
Auteur : Nathalie Quintane
L’écrivaine française Nathalie Quintane brosse un bref portrait au vitriol des classes moyennes, qu’elle considère comme une menace pour la démocratie.
Les classes moyennes sont, pour Nathalie Quintane, « la classe invraisemblable ». Celle dont le mode de vie et la mentalité vous donnent immédiatement envie de changer d’atmosphère.Alors que les écarts sociaux se creusent entre pauvres et riches, la poétesse et écrivaine se penche sur la classe « du milieu ». Dans ce bref livre, au carrefour du témoignage, de l’étude chiffrée et du pamphlet au ton sarcastique et grinçant, elle s’inquiète du rôle des classes moyennes dans le maintien d’un modèle économique qui s’est avéré dangereux pour la démocratie. Pour contrer leur paupérisation, la logique de l’échange et l’ubérisation leur permettent de continuer à consommer à moindre frais. « Les classes moyennes étaient en train de mettre en place le système de compensation qui permettrait que tout change pour que rien ne change, selon la célèbre formule. »
Elles ont été l’emblème d’une société de consommation qui a triomphé dans les années 1970 et que les pays développés ont exporté dans le monde. Alors que quelques générations plus tôt, les classes moyennes se constituaient par la sortie des champs et des usines et l’entrée dans les bureaux du secteur tertiaire, elles ont bénéficié des grandes vacances et de la culture pour tous. Aujourd’hui elles sont en voie d’effondrement. La « neuroculture » et l’automatisation menacent leurs métiers.Et pourtant, elles ont bénéficié d’un sursis par rapport au prolétariat : « Les classes moyennes ont jusqu’à présent été relativement épargnées car nous avons collectivement décidé de sacrifier les ouvriers à leur sécurité », s’indigne Nathalie Quintane. Pour elle, l’érosion des classes moyennes n’implique pas une perte de démocratie, car ce qu’elles représentent est un contrat social défaillant, tant sur le plan politique qu’économique et culturel.
Un mirage de contrat social
Nathalie Quintane fait dans son titre un clin d’œil au livre quele philosophe anglais John Locke avait remis en 1697 au ministère du Commerce et des Colonies : Que faire des pauvres ?, et précise son propos : « [L’]objectif principal [de ce livre] n’étant pas d’exprimer les états d’âme de la classe moyenne mais, reprenant partiellement la méthode que John Locke appliqua aux pauvres, de parvenir à comprendre, en partant moins de ce que sont les classes moyennes que de ce qu’on se raconte qu’elles sont, en quoi elles concourent (ou non) à l’état déplorable de la société toute entière et peut-être du monde, et comment y remédier rapidement, je poursuivrai le propos en revenant sur la description essentiellement négative qu’on en fait, leur réputation détestable, calamiteuse en ce début de XXIe siècle, lamentable, navrante et pénible. » Et d’ajouter immédiatement cette précision : « Je pense appartenir à la classe moyenne, et par conséquent ce texte est, d’une certaine manière, un produit de la classe moyenne ». Plusieurs pages autobiographiques (autofictionnelles ?) suivent sur son adolescence en banlieue parisienne.
Au-delà du sarcasme, Nathalie Quintane se lance dans une exploration de l’intérieur de ce milieu ambigu : « La classe moyenne n’a pas une existence fiable », d’autant qu’elle se nie et que de 1981 à 2000, on ne parlait plus de la notion de classe. Ce serait un fourre-tout intermédiaire entre pauvres et riches. « La notion de classe moyenne sert encore d’illusion pour un peuple qui a honte de son état ou de déguisement pour certains membres des classes supérieures qui refusent de s’assumer comme tel ». Les premiers chapitres du livre s’attachent à démontrer, par l’absurde, la difficulté à définir les classes moyennes : par le calcul d’un salaire médian (mais « on n’additionne pas des carottes avec des yachts »), par les stratégies d’alliances (poétiquement évoquées par des rimes croisées ou embrassées), par les courbes(en mongolfière, en sablier ou en U).
Plus que les chiffres, ce sontles clichés qui sont les plus parlants. Les classes moyennes se définissent en effet plutôt par leur mode de vie : l’ascension sociale par l’école, malgré le démenti des faits, la possession de biens culturels, la stratégie résidentielle, les loisirs. Son emblème : l’armoire à glace, signe qu’on s’est extrait des classes populaires, véritable « droit de péage » pour accéder à un statut supérieur. D’ailleurs, remarque Nathalie Quintane, « chaque achat est encore obscurément le droit de péage qu’on verse pour se dégager d’une origine sociale toujours trop basse, quand on est de la classe moyenne. Toujours trop basse par rapport à quoi ? » Et d’évoquer les écarts de plus en plus vertigineux entre ce que gagnent certains et le temps qu’il faudrait aux autres pour gagner la même somme.
Mais s’il est un trait qui suscite la colère de Nathalie Quintane, c’est justement la pusillanimité des classes moyennes, leur manque de courage, leur suivisme apathique : « Ne pas être en reste est ce qui motive tout le monde, et dans ce domaine, les plus motivés sont les moyens ».C’est leur mode de vie qui les entrave, ce même mode de vie qui leur fait mettre « leur supposée insuffisante montée – qui n’est que leur trop réelle descente – dans le sablier de répartition des classes sur le compte de la démocratie ». Pour Nathalie Quintane, ce sont eux au contraire qui menacent de l’intérieur la démocratie en tentant de sauvegarder leur position. Du reste, l’expression de leur angoisse prend la forme d’un ressentiment aux relents vengeurs, populistes et racistes – l’écrivaine restitue la litanie édifiante des « ça suffit » et note que « Des ennemis qui s’identifient comme amis de la démocratie ils sont d’autant plus dangereux. »EtNathalie Quintane de conclure : « La fonte des classes moyennes et leur fusion avec le néoprolétariat est bien mieux qu’une chance de salut ou une punition juste : l’ouverture à une autocritique enfin consciente ». Mais que faire des classes moyennes ? Elle laisse la question ouverte…
Par Kenza Sefrioui
Que faire des classes moyennes ?
Nathalie Quintane
P.O.L., 112 p., 120 DH
Identités : de la souplesse !
Auteur : Hassan Rachik
Le dernier ouvrage de Hassan Rachik plaide pour des identités multiples, relatives et non totalitaires.
C’est par une jolie parabole que Hassan Rachik ouvre son dernier livre. Un vieux couple heureux regrette l’harmonie sans faille de ses débuts et consulte un sage, qui leur dit : « Le bonheur, c’est maintenant que vous le vivez, car si vous êtes constamment d’accord sur tout, l’un d’entre vous sera inutile. » Le professeur d’anthropologie à l’Université Hassan II de Casablanca décrypte la notion, à la fois galvaudée et souvent interprétée dans un sens fermé et excluant, d’identité, dont il analyser la dimension idéologique. Hassan Rachik a consacré de nombreux travaux à la notion d’identité collective : tribale, nationale, amazighe, etc. « Jusque-là, les identités étudiées étaient plutôt paisibles », rappelle-t-il, mais à partir de 2005, l’exacerbation d’identités religieuses radicales l’amènent à analyser les notions d’identité dure et d’identité molle (au sens calqué de l’anglais soft, comme dans l’expression « sciences dures / sciences molles »).
Il rappelle que la notion d’identité, qu’elle soit individuelle ou collective, se fonde sur une tension entre similitude et différence. Il s’agit à la fois de s’affirmer comme membre d’un groupe et différent d’un autre groupe. Or, c’est au niveau de l’articulation entre identité individuelle et identité collective que se produit le nœud de crispation, révélateur du niveau de dureté. « Selon cette logique identitaire, un individu qui affiche son appartenance à une communauté est tenu de mettre en veilleuse, de façon intermittente ou permanente, son identité personnelle, c’est-à-dire ce qui le différencie des membres de sa communauté (compatriotes, coreligionnaires). Il est en même temps tenu de souligner ce qui le lie aux membres de sa communauté et les distingue, en tant que collectif, du reste des communautés. » D’emblée, Hassan Rachik place le débat sous le signe de la contrainte qu’exerce le groupe sur l’individu, même s’il nuance : « La portée et l’intensité des similitudes et des différences dépendent du degré d’autonomie et de sujétion (hétéronomie) de l’individu au groupe ». S’il précise dès l’avant-propos que ce degré est largement dépendant des contextes politiques, des réseaux de mobilisation, etc., c’est à la dimension idéologique de l’identité qu’il s’intéresse.« Folles », « meurtrières », « sauvages », les identités collectives, qu’elles soient politiques, religieuses, linguistiques, etc., font en effet l’objet d’instrumentalisation et d’exhibition si violentes que l’individu est menacé d’engloutissement par le groupe.
Pour l’autonomie
Si l’identité a une fonction classificatoire, permettant d’identifier un groupe selon un critère (langue, nationalité, religion…), et des fonctions pratiques, orientantses relations sociales, Hassan Rachik s’intéresse à sa dimension impérative : « elle ne dit pas seulement ce qu’on est mais aussi ce qu’on doit faire ». L’ouvrage procède ensuite par un inventaire des différentes formes d’identité qu’on trouve suite au processus d’idéologisation, « c’est-à-dire [au] passage d’identités implicites et pragmatiques à des identités explicites, exhibées, criées sur les toits ». L’identité univoque (« Être musulman et rien que musulman »), qui « exclut la pluralité et la relativité », est typique d’une « identité assiégée dans un monde où les appartenances identitaires sont de fait plurielles », et d’une idéologie autoritaire. La métaphore du creuset permet de justifier la coexistence de plusieurs identités en affirmant l’assimilation des identités exogènes dans l’identité endogène. C’est le discours de Ali Safi à propos de l’amazighité et de l’islam. D’un autre côté, l’identité cumulative soulève la question du conflit de loyauté. Pour l’illustrer, Hassan Rachik s’appuie sur le film de Youssef Chahine, Saladin, qui met en scène ce conflit entre arabité et appartenance au christianisme. Il cite également Abdelkebir Khatibi, qui notait que « le monde arabe souffre de ce qu’il appelle l’illusion unioniste », c’est-à-dire le hiatus entre une croyance en l’unité et la réalité diverse. Pour Hassan Rachik, la notion d’identité plurielle est « incompatible avec celle de spécificité chère aux idéologies centrées sur un passé culturel ancestral ».
L’auteur aborde ensuite une autre articulation, entre identité prescrite et identité acquise. La première induit héritage et transmission passive, et tend à une « conception substantiviste ». Ce sont les pensées de l’Âge d’or, prônées par les fondamentalistes, les amateurs de pureté et d’intemporalité, qui vont jusqu’à estimer que cette identité doit être intériorisée par l’individu, y compris malgré lui (« Le fils d’un Égyptien est égyptien qu’il le veuille ou non »). Variante relevant de la même logique de négation de la subjectivité individuelle : « traiter d’infidèles, d’impies, d’apostats, des gens qui se considèrent musulmans ». D’un autre côté, l’identité acquise, qui s’inscrit en rupture avec le groupe d’appartenance, est caractéristique des sociétés modernes et dynamiques, permettant à des individus « d’acquérir de nouvelles identités », d’être actif dans ce choix, voire dans leur multiplication. C’est ce que défend Amin Maalouf dans Les identités meurtrières, en plaidant pour le rôle actif de l’individu, créant une combinaison singulière de ses multiples appartenances.
Hassan Rachik s’intéresse enfin à la contrainte produite par l’identité totalitaire, qui « vise à organiser toutes les sphères de la vie en société, familiale, politique, économique, culturelle ». Ainsi du slogan « al-islam kulluh, al-islam wahduh » prôné par Abdeslam Yassine. À l’inverse, l’identité sélective « indique aux gens ce qu’ils sont et ce qu’ils doivent faire à des occasions déterminées et dans des secteurs limités de la vie sociale». Hassan Rachik conclut cet inventaire sur un plaidoyer pour des identités multiples, ouvertes, cumulatives, relatives, choisies, permettant une articulation harmonieuse entre le Je et le Nous. « Le débat public devrait aussi porter sur les formes identitaires et leur compatibilité avec les valeurs que des personnes et des groupes défendent, plaide-t-il. Par exemple : est-ce qu’une conception substantiviste des identités collectives est compatible avec l’autonomie individuelle ? » L’enjeu est de sortir notamment « d’une conception totale du consensus ». Si on est d’accord sur le fond, on se demande si le genre de l’inventaire est le plus efficace dans un but de plaidoyer. Pour aller plus loin sur cette question, l’excellent livre de François Laplantine, professeur d’ethnologie et d’anthropologie, Je, nous et les autres (Éd. Le Pommier, 1999), démonte de façon très efficace, et avec beaucoup d’humour, la dimension idéologique des notions d’identité et de représentation à partir du langage.
Par Kenza Sefrioui
Éloge des identités molles
Hassan Rachik
La Croisée des chemins, 128 p., 70 DH
Zéro-déchet : les mirages de l’économie circulaire
Auteur : Baptiste Monsaingeon
Baptiste Monsaingeon s’inquiète d’un discours sur le recyclage des déchets qui laisse inchangée une économie fondée sur la surproduction.
450 000 à 500 000 tonnes de déchets se retrouvent en mer chaque année, majoritairement issues de la filière de l’emballage agroalimentaire. 275 millions de tonnes de plastique inondent les océans, au point qu’à la fin des années 1990, l’océanographe Charles Moore avait identifié le Great Pacific Garbage Patch, une soupe détritique composée surtout de plastiques et formant un continent vaste comme trois fois la France. Le traitement des déchets constitue un marché mondial de 300 milliards d’euros, dont 150 milliards visent les déchets ménagers qui ne représentent que 4 % de la masse totale. Face à cette menace que représente un volume très lentement dégradable des matières plastiques, un discours alarmiste prétend faire face à la « crise des déchets » et enjoint à chacun la responsabilité du « bien jeter », pour mettre en place une économie circulaire recyclant ses déchets. Le sociologue français Baptiste Monsaingeon, chercheur postdoctoral à l’Institut français Recherche Innovation Société (Ifris), qui a participé en 2009 à la première expédition pour identifier les concentrations de débris plastiques en Atlantique Nord et a été membre du conseil scientifique de l’exposition Vies d’ordures au Mucem de Marseille, revient sur les tenants et aboutissants de ce discours. Pour lui, la masse de déchets est significative de notre basculement dans l’Anthropocène : « C’est plutôt à travers sa comparaison avec l’Homo œconomicusque je propose de réfléchir à ce que pourrait être Homo detritus », explique-t-il, tout en expliquant que son titre est emprunté au sociologue Stéphane Le Lay, spécialiste de la question. « Miroir en négatif de la rationalité humaine, érigée en principe structurel de l’économie de marché, Homo detritus pourrait être devenu l’héritier du « consommateur idéal » imaginé par quelques économistes néoclassiques du XIXème siècle : un « jeteur idéal », en somme. »
Approche gestionnaire
Dans ce bref essai qui mêle approche économique, sociologique et philosophique, Baptiste Monsaingeons’inquiète de l’emploi d’arguments écologiques incitant à « bien jeter », pour masquer le véritable problème : la structure économique, fondée sur la croissance incessante et générant une surproduction risquant d’asphyxier la planète. « Aujourd’hui, ce qui structure l’essentiel de ce « langage d’exhortation réciproque », ce sont ces arguments écologiques, qui, utilisés pour réorganiser nos relations aux déchets, sont devenus des sources déterminantes de coercition morale et politique. » Or « ces arguments ont davantage servi à participer au maintien de l’ordre social, sur le mode de l’adaptation, plutôt qu’à penser les moyens de sa réforme comme de sa critique. » On en arrive même à l’absurde. La Suède, qui a réduit considérablement sa production de déchets, est obligée d’importer des déchets pour continuer à faire tourner de façon rentable les immenses usines d’incinération qu’elle a construites. Depuis les années 1970, observe l’auteur, s’est imposé un « environnementalisme de marché » au détriment de recherches de solution de régulation publique. « Plutôt qu’une véritable écologisation du social, défendant « qu’une existence soutenable et épanouissante présuppose des changements radicaux dans notre relation avec le monde naturel non humain, et dans nos modes de vie sociaux et politiques », l’environnementalisationdes déchets « défend une approche managériale des problèmes environnementaux convaincu par la croyance que ceux-ci peuvent être résolus sans changements fondamentaux dans les valeurs présentes ou dans les systèmes de production et de consommation », explique-t-il, citant le politiste Andrew Dobson. L’obsession de la rentabilité aboutit même à établir une sorte de classement des « bons élèves de la pollution », en encensant les États-Unis, responsables de0,9 % des déchets plastiques mal gérés mondiaux et en vilipendant la Chine, qui en génère 30 %. Pour l’auteur, c’est une politique d’« optimisation duwaste management », alors qu’il faut agir sur deux fronts : optimiser en effet lewaste management dans les pays du Sud, mais aussi réduire la production de déchets au Nord.
Pour BaptisteMonsaingeon, ce discours du « bien jeter » est dangereux car il masque le problème de fond et occulte la question de l’échelle des actions. « Cette politique de petits geste s’inscrit donc tant comme un moyen pour redistribuer les responsabilités propres à l’action publique, au sein même de l’espace domestique, que comme argument pour faire de l’action routinière un acte de socialisation. Pourtant, entre enjeux globaux et pratiques domestiques, un gouffre intermédiaire subsiste : « mettre l’accent sur les « petits gestes » évacue aussi la question des grands choix. » Bien jeter, en somme, pour mieux oublier et se griser à l’utopie d’un monde sans restes.
Mais, s’interroge l’auteur, « de quoi le zéro-déchetest-il le nom ? »Le statut même du déchet est en effet un révélateur des impensés de la société. Baptiste Monsaingeon rappelle que le problème n’existait pas en tant que tel avant l’ère industrielle, avant l’avènement de la civilisation du plastique et du prêt-à-jeter érigé en moteur de croissance. Il souligne le fait que les politiques de régulation et de gestion se sont focalisées sur le plastique, au détriment de la part putrescible du déchet – biodéchet dont se sont emparés des groupes pour développer des alternatives aux approches industrielles centralisées de gestion de l’ordure. Car derrière cette centralisation, demeure l’idée moderniste d’être « maître et possesseur de la nature » : l’éco-citoyen, en s’adonnant au recyclage, prend en charge la disparition de la charge d’immonde. « Rationalisée, optimisée, la gestion contemporaine des rebus peut être vue comme un processus de désenchantement où la souillure tend à perdre sa dimension symbolique et se réduire à sa dimension toxologique. » Un storytelling qui occulte ce que ces pratiques génèrent comme inégalités sociales. La volonté d’éradiquer les déchets semble pathologique : « Le déchet est ce qui pose problème au déploiement, sans limite, de la vie. Vie qui ne se laisse plus définir à travers le prisme de son indépassable finitude. Autrement dit, ici, la mort n’est plus un phénomène naturel : elle est une affection dont il s’agit de guérir. » « Il serait trompeur de réduire l’histoire récente du déchet à celle d’une prise de conscience d’un problème écologique lié aux phénomènes de mise au rebut », conclut Baptiste Monsaingeon, qui énumère les initiatives (freeganisme,gratuiteries, etc.) critiquant la surproduction et prônant un autre rapport à ce qui reste. Afin que l’anthropocène ne se réduise pas au « poubellocène »…
Par Kenza Sefrioui
Homo détritus, critique de la société du déchet
Baptiste Monsaingeon
Seuil, collection Anthropocène, 288 p., 250 DH
Les mirages de la frivolité
Auteur : Michel Clouscard
Le sociologue français Michel Clouscard analysait dans un pamphlet inspiré les fondements culturels de la sociale-démocratie libertaire.
Le livre de Michel Clouscard est un pamphlet, tant dans le style vif et enlevé, que dans la rapidité de son raisonnement. Le sociologue et philosophe français (1928-2009) a développé une œuvre très critique du capitalisme sous sa forme de libéralisme libertaire. Proche du parti communiste, penseur du lien social, il est l’auteur de nombreux essais sur les aliénations propre à ce régime économique et politique et sur les mirages d’une certaine émancipation, comme L’Être et le Code (Mouton, 1972), Néo-fascisme et idéologie du désir (1973), Le Frivole et le Sérieux (Albin Michel, 1978), Critique du libéralisme libertaire, généalogie de la contre-révolution (Delga, 2005). Le capitalisme de la séduction, critique de la social-démocratie, paru aux Éditions sociales en 1981, a été réédité chez Delga en 2006. Il s’agit d’une critique de la société de consommation d’un point de vue sociologique : Michel Clouscard se demande qui consomme quoi et pourquoi ? En préface, le philosophe Aymeric Monville estime que « Clouscard est le seul à avoir analysé la société de consommation et ceci, ni de manière apologétique, ni sous l’angle moralisateur, mais avec une analyse de classe. »Le capitalisme de la séduction se penche sur les codes, les usages et les rituels en vigueur au sein des sociétés capitalistes contemporaines. « Poster, flipper, juke-box… […] Ces petits usages et objets anodins, d’une insignifiance telle qu’ils sont au-dessous de tout soupçon, sont au commencement du rituel initiatique de la civilisation capitaliste. » C’est une « anthropologie de la modernité » que propose Michel Clouscard, en s’attachant à la mode, aux musiques, à la culture des loisirs et de la frivolité. Car pour lui, la mondanité, avec ses codes et ses rythmes, est la clef de voûte de la civilisation capitaliste, qui de libertaire est devenue institutionnelle en accédant au pouvoir.
La première partie du livre est consacrée aux rituels d’initiation au système, que le sociologue décrit comme des « procédures initiatiques », formatant l’intime pour mieux reproduire ce système en rupture avec les sociétés traditionnelle. Il insiste sur la dimension de « dressage » que véhiculent des objets banals comme le flipper ou le juke-box, initiant l’enfant au non-utilitaire, au superflu, au gaspillage. La tenue vestimentaire (jeans, treillis, cheveux longs, guitare) constitue ensuite le formatage du bourgeois en portrait-robot du consommateur. La bande de copains, ensuite, « a quatre fonctions éducatives, quatre vertus initiatiques. Elle doit aider à quitter la tradition (la société victorienne : la morale). Elle doit produire les nouveaux modèles et symboles de l’émancipation. Elle sélectionne les meilleurs sujets et écarte les scories de classe. Elle prépare à la participation, à l’intégration au système. » Une initiation qui tend à faire coïncider « empathie individuelle et profit de classe », dans la constitution de lobbies ou d’intelligentsias. Michel Clouscard s’attarde ensuite sur les rituels : le « cérémonial de la fumette », qu’il interprète comme « l’initiation au parasitisme social de la nouvelle bourgeoisie ». De même, tout en saluant l’immense avancée sociale qu’elle a représenté, il décèle dans un certain apprentissage de la pilule un conditionnement des très jeunes filles à la consommation de masse – reléguant le féminisme à une pratique mondaine, à une idéologie occultant la « ségrégation de classe » qui trace des vies si différentes. Enfin Michel Clouscard décortique l’usage mondain de l’objet technologique (la moto, la guitare électrique…), qui forment la « sémiologie du standing », de ce statut où l’objet n’est plus recherché pour sa vocation fonctionnelle et utilitaire. Tous ces éléments contribuent à un « nouveau contrat social » entre les générations.
Néo-fascisme
Dans la seconde partie, intitulée « La logique du mondain », Michel Clouscard développe la diffusion de ce système dans divers champs des pratiques et expressions sociales. Dans l’art, par exemple, où toutes les formes traditionnelles sont soumises à une esthétisation. Il analyse la mode (et la démode) à la lumière de la psychanalyse, comme banalisation et esthétisation de la libido. Il décrit les lieux de la « consommation mondaine », dont la boîte qui se mue en club, par « l’accumulation des consécrations », décortique l’économie des échanges…
À la suite de Marx, qui s’inquiétait du « caractère fétiche de la marchandise », Michel Clouscard analyse la dimension contraignante de la socialisation dans une société de consommation, servie par les outils informatiques qui donnent à cet impératif de la convivialité une dimension quasi-totalitaire. « Le néo-fascisme sera l’ultime expression du libéralisme social libertaire, de l’ensemble qui commence en mai 1968. Sa spécificité tient dans cette formule : tout est permis, mais rien n’est possible. À la permissivité de l’abondance, de la croissance, des nouveaux modèles de consommation, succède l’interdit de la crise, de la pénurie, de la paupérisation absolue », écrivait-il dans Néo-fascisme et idéologie du désir.Dans Le Capitalisme de la séduction, Michel Clouscard se pose en moraliste, parfois même en moralisateur, qui n’hésite pas à apparaître puritain, notamment lorsqu’il décrit la rupture avec une éthique occidentale traditionnelle opposant l’argent à la beauté, ou lorsqu’il condamne l’arrivisme. La force du propos est atténuée par le ton, d’une ironie envahissante. Mais ce livre, salué par Vladimir Jankélévitch comme un chef-d’œuvre, porte un regard au vitriol sur cette société, et ses analyses d’il y a près de quarante ans apparaissent d’une grande actualité.
Par Kenza Sefrioui
Le capitalisme de la séduction, critique de la social-démocratie libertaire
Michel Clouscard
Éditions Delga, 360 p., 170 DH
Valeur en construction
Auteur : Gilles Marion
Gilles Marion replace objets et consommateurs dans une relation complexe et mouvante qui exclut que la notion de valeur soit un absolu.
Seul, un objet n’a pas de valeur. C’est la thèse de Gilles Marion, professeur émérite à EMLYON Business School. Ce chercheur français, spécialiste de la compréhension de la production de valeurs par le consommateur et des expériences de consommation, propose dans cet ouvrage une stimulante réflexion sur l’axiologie de la consommation. Gilles Marion s’inscrit contre une vision traditionnelle du marketing, faisant de l’objet une simple réponse à un besoin d’un consommateur. Pour lui, la notion de valeur est une construction, qui émerge au moment où l’objet est intégré dans une pratique. Il considère donc l’objet comme indissociable de la relation avec un sujet. Dans le même mouvement, cela implique que le consommateur n’est pas un être passif, mais participe lui aussi à la production de la valeur. Considérer la valeur comme une cocréation, ou une coproduction, ouvre un vaste champ de causes et d’effets possibles, qui évacuent d’emblée l’idée que la notion de valeur soit un absolu.
Notion contingente
Dans un premier chapitre, Gilles Marion revient sur les différentes théories de l’économie et de la sociologie de la consommation. « La philosophie morale n’a pas l’exclusivité du concept de valeur. Ce vocable n’appartient à aucune discipline particulière », précise-t-il. Mais « l’économisme, voire la science économique, est peu capable de rendre compte de la formation de la valeur si on s’en tient aux seules hypothèses qui accompagnent un tel modèle. En revanche, il est beaucoup plus intéressant de mobiliser le contexte du tissu social qui compose nos sociétés et alimente notre relation aux objets. » Gilles Marion retrace l’histoire de la pensée de l’économie politique, pour souligner ce qui a été écarté pour en faire « une « science » mathématisable ». Il revient notamment sur la réflexion d’Aristote sur l’échange, développant à la fois la justice de cette relation et la définition de la valeur. Mais, d’Adam Smith à Marx, c’est surtout la valeur d’échange qui est analysée, au détriment de la valeur d’usage, laquelle s’inscrit beaucoup plus dans une pratique. Par ailleurs, ces principes de la micro-économie classique impliquent que le consommateur soit considéré comme un être rationnel, autonome et informé, effectuant au préalable un calcul du rapport coût/bénéfice en fonction de ses objectifs, pour agir de façon optimale. Gilles Marion fait l’inventaire des études qui nuancent ce portrait type, en soulignant notamment les paramètres du style de vie, des motivations, etc. Et surtout, il souligne qu’on ne saurait isoler le comportement d’un consommateur type, sauf à le considérer, comme Amartya Sen, comme un « demeuré social » ou un « idiot rationnel », tant chaque individu est pris dans un réseau de relations qui influencent ses choix. Gilles Marion s’attarde également sur la sociologie de la consommation pensée par Bourdieu : s’il partage l’idée que « la valeur d’un objet de consommation, en fait d’une catégorie plus qu’un objet précis, n’est pas substantielle mais relative », il interroge les limites des notions d’habitus, estimant que cette analyse est surtout centrée sur les producteurs et ne tient pas assez compte de la capacité critique des consommateurs. « L’activité cognitive d’un consommateur est triplement située et distribuée. D’abord, elle est située dans les contingences de l’accomplissement d’une pratique, ensuite elle est distribuée dans l’environnement et les dispositifs matériels et sémiotiques qui l’accompagnent, enfin elle est située dans le cadre culturel et historique particulier où sont sédimentées des façons de faire, d’agir et d’interagir qui qualifient les personnes. »
Gilles Marion aborde ensuite la question de la qualification des personnes et des objets. Chaland, client, consommateur, acheteur, utilisateur, etc., chaque terme définit un type de relations, ce qui induit une pluralité de motifs d’action (intérêt, passion, conviction, etc.) ainsi que de nombreux dispositifs de jugement (désir mimétique, désir de la nouveauté…). Idem pour la qualification des objets : « Que se passe-t-il lors qu’un objet quitte la scène marchande pour entrer dans la sphère intime ou domestique ? Ces moments où la question n’est plus de choisir mais d’utiliser, de « faire avec » et, parfois malgré, l’objet. » Gilles Marion souligne l’impasse des économistes sur ce point et propose la notion d’expérience pour l’appréhender dans son intensité et sa temporalité. Il évoque également l’approche des linguistes voyant dans l’objet un signe, revient sur la dimension instrumentale de l’objet, discute les notions d’appropriation et de familiarisation.
Le troisième chapitre se penche sur la genèse de la valeur d’un objet, sur le processus de valuation que Gilles Marion préfère au terme de valorisation. Expérience, jugement de valeur, dimension subjective et personnelle ou au contraire publique, régimes de justification des choix, etc., entre en ligne de compte dans la fabrication du storytelling qui doit faire reconnaître la valeur, donc le prix d’un objet. Enfin, Gilles Marion propose une typologie des formes de la valeur. Si celle-ci est vue comme une expérience, interactive, relative, qui peut être extrinsèque ou intrinsèque, active ou réactive, orientée vers soi ou vers autrui, elle peut être envisagée en termes d’efficience, d’excellence, de statut social, d’estime, d’éthique, de jeu, d’esthétique ou de spiritualité. Si la valeur est analysée à l’aune de sa signification, les catégories de pratique, de ludique, de critique ou d’utopique s’appliquent. Si la valeur se base sur sa performance, on l’envisagera du point de vue physique, positionnelle ou imaginative. Chaque typologie produit à son tour des interprétations à évaluer. Et Gilles Marion de conclure : « le consommateur n’existe pas, seules existent ses figures », car la consommation est d’abord un « faire ».
Par Kenza Sefrioui
Le consommateur coproducteur de valeur, l’axiologie de la consommation
Gilles Marion
Éditions EMS, collection Versus, 208 p., 230 DH
Contre un égalitarisme abstrait
Auteur : Amartya Sen, traduit de l’anglais par Paul Chemla
L’ouvrage clef du prix Nobel d’économie indien Amartya Sen a 25 ans et n’a pas perdu de son actualité.
L’égalité oui, mais de quoi précisément ? « L’idée d’égalité se heurte à deux diversités distinctes : l’hétérogénéité fondamentale des êtres humains, et la multiplicité des variables en fonction desquelles on peut évaluer l’égalité », précise Amartya Sen. L’économiste indien, qui a reçu en 1998 le prix Nobel d’économie, rappelait dans cet ouvrage publié en 1992 chez Oxford UniversityPress sous le titre de InequalityReexamined, l’importance, pour ne pas vider la notion d’égalité de son sens, de tenir compte de la diversité des situations et des aspirations humaines. Fortune héritée, milieu social, âge, sexe, vulnérabilité aux maladies, aptitudes physiques et intellectuelles doivent donc être prises en compte, faute de quoi la formule de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, « Tous les hommes naissent libres et égaux », considérée comme la référence en matière d’égalitarisme, peut dissimuler des politiques très inégalitaires, alors qu’« une considération égale pour tous implique peut-être un traitement très inégal en faveur des désavantagés. »L’ouvrage d’Amartya Sen passe en revue ces nombreux paramètres variables qui entrent dans une compréhension large et pratique du concept d’égalité.
Au cœur de sa réflexion, l’auteur insiste en effet sur une approche pragmatique : l’égalité dans la liberté d’accomplir, ou capabilité, et non pas seulement l’égalité prise comme niveau d’accomplissement atteint. Il se distingue également des travaux des « économistes du bien être », dont Bentham, en faisant la différence entre la notion de capabilité et celle d’utilité, trop liée selon lui à l’utilité individuelle et à certains schémas concentrés sur les accomplissements. De même, la capabilité ne se réduit pas à la notion d’égalité des chances, qui renvoie à la théorie sociopolitique et ne prend en compte que certains obstacles spécifiques. Si l’égalité des chances véritable implique nécessairement l’égalité des capabilités, l’égalité doit aussi prendre en compte un autre impératif parfois rival, celui de l’efficacité.
Le travail d’Amartya Sen est une réponse aux thèses de John Rawls, qui considère la justice comme l’équité. Pour Amaratya Sen, « deux individus détenant le même panier de biens premiers peuvent disposer de libertés très différentes pour progresser vers leurs conceptions respectives du bonheur (que ces conceptions coïncident ou non). Juger l’égalité – ou l’efficacité, d’ailleurs – dans l’espace des biens premiers revient à donner aux moyens de la liberté priorité sur toute évaluation de l’étendue de la liberté, ce qui, dans de nombreux contextes, peut être un inconvénient. » Ainsi des variables d’inégalités héritées, de sexe, etc.
Égalité vs liberté ?
Pour Amartya Sen, l’articulation entre liberté et égalité est absolument centrale et tout à fait révélatrice de la position philosophique et politique de tout auteur qui s’exprime sur le sujet. Ainsi, les penseurs libertariens s’avèrent « antiégalitaristes » justement parce qu’ils placent la liberté au-dessus de tout. Or, « la position d’une personne dans un mode d’organisation sociale peut être jugée de deux points de vue différents : premièrement son « accomplissement » ; deuxièmement, sa « liberté d’accomplir » ». Il y a donc une nette différence entre ce que chacun peut effectivement faire en sorte de réaliser et ce qu’il peut réellement faire, l’écart étant nourri par des variables comme l’utilité, le niveau de revenu, le métabolisme, l’âge, etc. Amartya Sen distingue également la liberté et les moyens de la liberté, ceux-ci ne se réduisant pas à un budget mais incluant les choixet les ressources dont dispose un individu. Il insiste sur la qualité d’agent qui peut entrer en ligne de compte dans l’appréciation de l’accomplissement et du bien-être. Il analyse les concepts à l’aune de la justice, des libertés politiques, du bien-être social.Il consacre un chapitre entier à « Richesse et pauvreté » comme facteurs d’inégalité. Il s’y penche notamment sur la mesure du seuil de pauvreté, et montre les limites de la statistique pure, sans prendre en compte la nature de la pauvreté, la question de l’inadéquation des revenus, plutôt que leur faiblesse seule, ou encore le manque de capabilité temporaire lié à une situation déterminée (grossesse, maladie, représentations sexuées, etc.).Amartya Sen développe ensuite les facteurs de diversité humaine générateurs d’inégalité : sexe, accès aux études, etc. Et de conclure : « Les inégalités de répartition des revenus et de la propriété feront très généralement partie du tableau, mais ne seront certainement pas tout le tableau ». Car, insiste-t-il, ce qui caractérise l’humanité, c’est sa diversité et sa pluralité, rendant nécessairement incomplète toute étude de l’inégalité. Au-delà des problèmes liés à la mesure du phénomène, des différences afférant aux questions de liberté effective, des variables décisionnelles, l’égalité demeure une préoccupation sociale majeure, qui appelle une réflexion en profondeur sur les modes d’organisation à adopter. À la libre concurrence et à la méritocratie prônée par John Rawls, Amartya Sen répond par la nécessité de prendre en compte – par la notion de capabilité – ce dont l’individu n’est pas responsable (la fortune de sa famille, ses dons innés, etc.) « Lorsqu’il est question d’adultes responsables, il est plus juste de voir les droits des individus sur la société (ou les exigences d’équité ou de justice) en termes de liberté d’accomplir que d’accomplissements réels. » Ainsi, considérer la pauvreté pas uniquement comme un manque de revenu mais de liberté fonde une approche d’une grande force conceptuelle et aux retombées tout à fait concrètes. Cette vision fine et riche en nuances est porteuse d’une éthique véritablement humaniste.
Par Kenza Sefrioui
Repenser l’inégalité
Amartya Sen, traduit de l’anglais par Paul Chemla
Seuil, Points Économie, 320 p., 120 DH