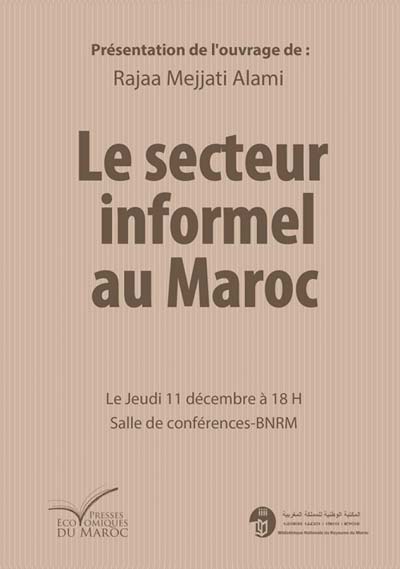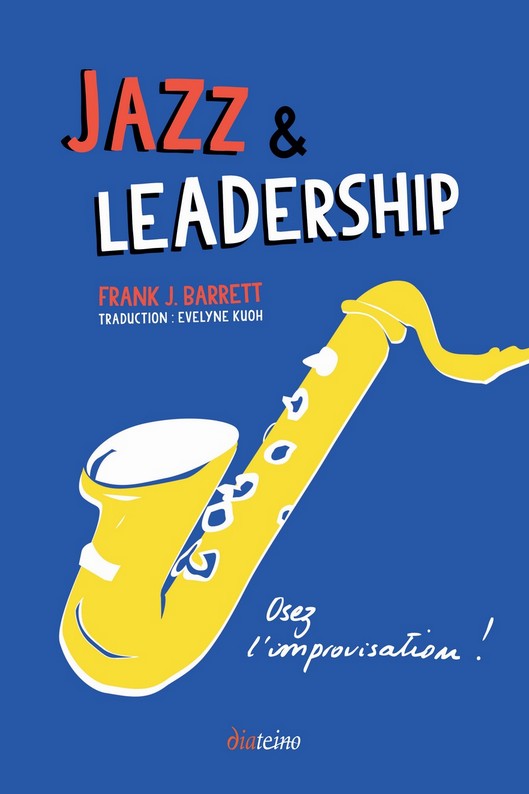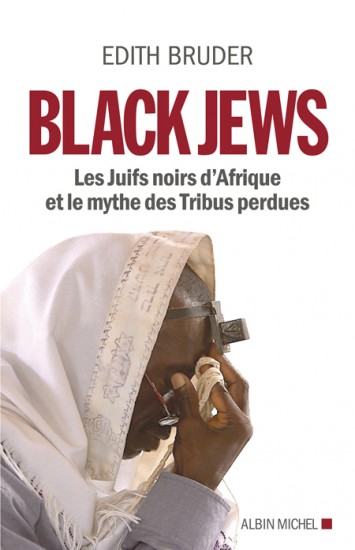2014 Connected World Technology Final Report
Auteur : CISCO
2020 d’après les plus connectés
Quel avenir pour le travail humain ? Cisco Systems, leader mondial des réseaux est une entreprise informatique américaine spécialisée dans le matériel réseau et les serveurs. Avec un résultat net de 10 milliards $ (2013) elle fait partie des mastodontes étatsuniens de ce secteur. Elle répond à cette question par un rapport étoffé, issu d’une grande enquête. Le rapport 2014 sur l’avenir du travail dans les pays « connectés » rend compte des interactions entre technologies d’information et travail dans les 15 pays suivants : Les Etats Unis, le Canada, le Mexique, Le Brésil, la Grande Bretagne, la France, l’Allemagne, les Pays Bas, la Pologne, la Russie, l’Inde, la Chine, le Japon, la Corée Du Sud et l’Australie.
L’échantillon de cette enquête a porté sur plusieurs catégories de cadres ; la première catégorie (Gen X) est composée de 1388 personnes âgées de 18 ans à 30 ans qui travaillent déjà. La deuxième catégorie (Gen Y) de 1524 personnes travaillantes et âgées de 31 à 50 ans. La troisième catégorie (RH) concerne 827 personnes responsables des ressources humaines dans les entreprises. L’ensemble de l’échantillon a été interviewé entre le 22 janvier et le 17 mars 2014.
Que se passe t il chez les plus connectés ?
Lapidairement, le premier constat c’est que le smartphone et les apps sont en train de se substituer à tous les autres équipements, y compris dans leur fonction de base. Le deuxième constat se fait sentir au niveau des mentalités et des compétences. On se dirige vers un modèle de salariés constamment « connectés » et qui sont quelque part « surdoués » .On parle dans cette enquête de « supertaskers » avec des personnes qui arrivent à accomplir simultanément de nombreuses tâches cognitives et peuvent utiliser plusieurs technologies pour gérer des activités simultanées. Troisième constat une tendance forte vers le travail à distance et une flexibilité dans les horaires.
Mais par-delà ces quelques aspects, l’enquête comporte de nombreux enseignements. Six personnes sur dix de l’ensemble de l’échantillon prennent toujours des notes sur papier au cours de leur travail, 13% seulement le font à travers leur Smartphone. Mais la majorité estime que l’usage des Smartphones et des applications faciliterait mieux le travail et économiserait mieux celui-ci en comparaison avec les ordinateurs de bureaux, les bloc-notes et le reste.
La moitié presque de l’échantillon reconnait qu’elle traite des affaires de boulot alors qu’elle est au volant, l’usage du Smartphone pour communiquer est de plus en plus fréquent tant au niveau des contacts à partir du bureau qu’à l’extérieur. Le téléphone fixe du bureau est en perte de vitesse. La moitié affirme aussi qu’elle règle souvent des problèmes du bureau en parlant ou répondant au téléphone en pleine circulation ! Les deux tiers de l’échantillon utilisent au moins 10 applications de leur Smartphone quotidiennement, la plupart des responsables des ressources humaines préfèrent l’usage du Facebook mais les russes s’adonnent à Tumbir et Snapchat , en Chine ce dernier est très populaire. Les interrogés sont prêts à céder l’accès à leurs données privées si leur patron acceptait de leur offrir gracieusement des Smartphones. Et qu’est ce qui serait dramatique pour notre échantillon ? Réponse : le vol de son Smartphone!
Environ 4 sur 10 professionnels croient que les portails vont disparaître et seront remplacés par les applications dans les prochaines années. Près de la moitié des interrogés regardent leurs Smartphone en premier à leur réveil le matin au lit ! (L’échantillon japonais fait exception puisqu’il affirme regarder la télé en premier).Et le comble , l’échantillon se divise presque à égalité entre ceux qui devant l’obligation de choisir acceptent de sacrifier leur vie sexuelle pendant un mois au lieu de renoncer à leur Smartphone pendant la même période. Significativement, la plupart des pays asiatiques n’y trouve rien de surprenant, ils accepteraient de sacrifier le sexe pendant un mois, notamment plus de 7 sur 10 professionnels au Japon choisiraient de maintenir leur Smartphone et de renoncer au sexe !
Le virtuel semble traduire fidèlement les relations humaines
Autre constat est la confiance totale dans les avantages du virtuel. Six sur dix parmi les responsables des ressources humaines se disent, en effet, prêts à embaucher sans entretien direct, se suffisant de vidéo- conférences. 40% considèrent que les qualités personnelles des candidats comptent plus que les autres aspects dans le recrutement mais ces qualités seraient vérifiables par le biais des contacts virtuels.
Un quart des interrogés ont affirmé que leur compagnie les autorise à travailler chez soi. 40% en Inde et aux Pays bas sont autorisés à travailler à partir de leur domicile, alors que le tiers des interrogés ont déclaré préférer travailler à partir de chez eux et pensent mieux épargner leur temps et autres coûts ainsi au lieu de les dilapider dans les transports.
Le rapport nous informe, par ailleurs, que le tiers de l’échantillon se déplace de chez lui au boulot à travers des transports en commun. La plupart se considère joignable professionnellement 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 même si ce n’est pas une norme établie ; au Brésil les interrogés ont affirmé être joignables aussi par mail et par tel. Et tous évoquent un avenir où les salariés doivent l’être comme obligation.
Robots et planète mars se rapprochent de nous !
A propos du travail à distance l’enquête apporte aussi des réponses éclairantes. La majorité estime qu’une entreprise qui adopte un modèle de travail flexible, mobile et à distance, a un avantage concurrentiel sur une organisation qui exige de ses employés de travailler pendant les horaires de travail à l’officine. La plupart des responsables des ressources humaines affirment que leurs employeurs sont déjà engagés pour parvenir à une flexibilité du travail de leurs employés. Le quart de tout l’échantillon croit que la moitié des entreprises auraient déjà pris en charge le travail à domicile dès l’année 2020. Mais Les bureaux physiques vont continuer à exister, la moitié de l’échantillon indiquant qu'il y aura toujours un besoin de ceux-ci dans l'année 2020. Seulement, ils seront des locaux plus petits. Ce sont, dans l’échantillon des interviewés, les chinois qui le disent en majorité ! Fini le temps des sièges fastes et imposants que les décideurs Marocains continuent d’ériger encore aujourd’hui !
Environ 3 sur 10 professionnels pensent que les voitures seront autopilotés en l'an 2020, ce qui rendra leur trajet plus facile car les usagers seront en mesure de travailler dans les voitures comme cela se fait déjà dans les trains ou les bus aujourd’hui. Au moins la moitié des professionnels en Inde et la Chine croient que les voitures seront autopilotées dans un proche avenir. La plupart des professionnels croient que les travailleurs à revenu moyen auront dans le futur des robots pour les aider (avec planification, coordination, gestion de projet, assistance technique, etc.); si 7 sur 10 pensent que 2020 sera encore tôt pour cela en 2030 la probabilité est plus forte selon les réponses d’y arriver. ¼ des interrogés se dit prêt à partir vers une autre planète si la société où il travaille l’exige.
Par : Bachir Znagui
Pensée unique et totalitarisme du marché
Auteur : Richard Brouillette
Tourné en 2008 et d’une totale actualité, le documentaire de Richard Brouillette démonte la préparation idéologique, par le néolibéralisme, au redéploiement de la concentration du capital et du colonialisme.
Une société privée, Channel One, fournit du matériel (ordinateurs, etc.) à des écoles américaines, ne demandant en contrepartie que la diffusion auprès des élèves d’émissions réalisées par elle – bien entendu entrecoupées de publicités. Sous couvert d’apprendre la nutrition, l’environnement, etc. (avec telle ou telle marque), des entreprises prennent les enfants pour une clientèle captive qu’elles livrent aux annonceurs. Cet exemple, un des nombreux évoqués dans L’encerclement, la démocratie dans les rets du néolibéralisme, est une illustration très claire du sens réel du néolibéralisme. Ce documentaire de Richard Brouillette interroge en effet les soubassements idéologiques de ce courant aujourd’hui hégémonique, qui est tout autant un programme économique et politique qu’un mouvement de pensée appuyé sur « un réseau planétaire de propagande ». Le réalisateur québécois confie avoir voulu faire un film « non pas sur la mondialisation de l’économie – comme il y en avait déjà plusieurs – mais plutôt sur la mondialisation d’un système de pensée ». Il lui a fallu douze ans de travail pour boucler cette fresque passionnante, racontée par treize chercheurs, journalistes et militants, parmi lesquels le linguiste américain Noam Chomsky, l’économiste français Bernard Maris, la cofondatrice d’ATTAC, Susan George, ou encore le sémiologue et éditorialiste Ignacio Ramonet. Ce dernier rappelle d’ailleurs la définition des régimes totalitaires, qui ont « vocation à régir tous les aspects d’une société » et remarque que la loi du marché, proposée comme solution unique à tout et qui s’est imposée comme pensée unique, relève de la même logique. Tous ces intervenants, qu’ils rappellent l’histoire de ce courant néolibéral dès les années 1920 – alors même que triomphaient, dans les démocraties comme dans les dictatures, les principes d’une économie planifiée –, qu’ils détaillent les points cruciaux de cette pensée ou se livrent à leur critique méthodique, se posent une même question : comment en est-on arrivé à cette hégémonie qui a conduit à une telle transformation du sens des activités humaines ?
« Socrate serait-il employable ? »
Sur ce sujet abondamment traité, l’apport le plus important du film (outre la clarté et l’efficacité de son récit) est la mise en lumière de la stratégie de prise de contrôle, par les tenants du néolibéralisme, des instances de formation de l’opinion. D’un côté l’école, dévoyée de système d’éducation en système de formation professionnelle. De l’autre les médias, imposant une « société où l’information était devenue reine, mais le développement de la connaissance révolu », remarque Richard Brouillette. Dans les années 1920, l’embryon néolibéral s’est formé autour d’une maison d’édition, la Librairie de Médicis, proche du patronat. Il y a eu ensuite, dans le sillage de la Société du Mont Pèlerin, les think tanks, dont la réussite a été de réunir à la fois des intellectuels, des patrons et des décideurs politiques. Think tanks qui rédigeaient programmes politiques, articles pour la presse, etc., jouissaient souvent du statut d’utilité publique permettant à leurs soutiens d’obtenir des abattements fiscaux, et qui, d’après la loi, n’avaient pas le droit d’exercer une action politique. Or, relève le réalisateur, aucun de ces groupes n’a jamais été ennuyé pour cette confusion… Leur efficacité a même influencé la réflexion d’Hitler sur la propagande.
En ce qui concerne l’école, elle est l’objet de toutes les attentions des néolibéraux depuis trente ans : marché rentable, elle permet de « s’emparer du cerveau des gens », insiste Normand Baillargeon, professeur en sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Montréal. Plus question de former des citoyens capables de penser aux sujets politiques au-delà de leurs intérêts particuliers, en leur donnant une culture et un savoir : il s’agit de former des gens « employables » du point de vue des entreprises. Omar Aktouf, professeur de management à HEC Montréal, donne cette sombre explication du concept d’« employabilité » : « Au niveau supérieur, on forme des technocrates analysant des problèmes, à qui on fait croire qu’ils sont intelligents, alors que l’intelligence consiste à formuler des problèmes appelant des questions. On confond donc penser, et analyser et calculer sans états d’âme, donc sans ce qui fait l’humain. Au niveau intermédiaire, on forme des techniciens producteurs, serviteurs de machines automatisées, dépossédés de la supériorité de l’homme sur la machine. Et au niveau inférieur, on ne forme plus. 45 % de la main d’œuvre des multinationales est analphabète. Un employé sur 4 ne sait ni lire ni écrire, ne pense pas et défend le système qui les broie ». La notion même de « capital humain », s’inquiète Normand Baillargeon, permet d’appliquer les théories économiques à l’humain. Tous s’inquiètent de la perte de sens des activités intellectuelles et de la dictature de chiffres qui masquent autant qu’ils annoncent, par l’omission de données sociales, comme le seuil de pauvreté, l’accès aux soins, le niveau d’éducation, l’environnement…
Cette rhétorique a permis de propager la doctrine néolibérale et de la doter d’un « statut d’évidence ». Les médias la présentent comme un fait accompli, sans demander aux gens leur accord, comme quelque chose d’inéluctable. Naturalisation, donc dépolitisation qui « dissuade le citoyen de croire en son propre vote », s’indigne un chercheur. Le matraquage repose sur l’équivalence fallacieuse entre répétition et vérité, note Ignacio Ramonet, et produit une « anesthésie des consciences ».
Et les conséquences sont bien connues : le sapement de l’État social au profit du marché dans les démocraties occidentales, la violence néocoloniale ailleurs. L’enjeu du néolibéralisme est de permettre la concentration des richesses aux mains d’une minorité, par la persuasion, le jeu faussé des institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale, l’OMC et son Organisation de règlements des différents, ou par la force. En créant des « mosaïques de protectorats » où des banques centrales, comme en Bosnie Herzégovine, sont de simples bureaux d’émission sans possibilité de création monétaire et où les structures sont contrôlées par des étrangers. Donc au prix de la démocratie elle-même.
Le film, sorti en 2008, a reçu de nombreux prix, dont la mention spéciale du jury du Prix Amnesty International en 2009. Les récents développements, avec la crise en Europe et les révolutions arabes, montrent que sa démonstration, limpide et palpitante, est d’une brûlante actualité.
Par : Kenza Sefrioui
L’encerclement : la démocratie dans les rets du néolibéralisme
Documentaire de Richard Brouillette
160 min., 2008, http://encerclement.info
La nouvelle société du coût marginal zéro
Auteur : Jeremy Rifkin
Le prosommateur : le consommateur-producteur est en marche
La nouvelle société du coût marginal zéro, le nouvel essai de l’Economiste Jeremy Rifkin ne manque pas de sous-titres : l’internet des objets, l’émergence des communaux collaboratifs, l’éclipse du Capitalisme... Avant même d’ouvrir le livre, d’entamer la lecture, la couverture nous donne le ton, les orientations de ce nouvel opus économique qui sonne le glas, une fois encore, du capitalisme.
Après, La troisième révolution industrielle, cet auteur revient pour appuyer ses lignes, étayer sa thèse par des exemples très concrets. Un livre catégorique mais nuancé où se côtoient sans difficulté théorie et pratique. Le présent et le passé se rencontrent aussi dans cet ouvrage. Des pratiques anciennes oubliées depuis longtemps, reviennent au goût du jour et Rifkin nous raconte leur histoire.
A ce propos, il dédie tout un chapitre aux communaux collaboratifs et nous emmène à la découverte de ce vieux mode de fonctionnement qui prend aujourd’hui de plus en plus d’ampleur. « Un nouveau système économique entre sur la scène mondiale : les communaux collaboratifs. C’est le premier paradigme économique à prendre racine depuis l’avènement du capitalisme et du socialisme au début du XIXème siècle. Les communaux collaboratifs transforment notre façon d’organiser la vie économique : ils permettent de réduire considérablement l’écart des revenus, de démocratiser l’économie mondiale et de créer une société écologique durable ».
Car qu’on le veuille ou pas, le tandem charbon-pétrole est en décroissance et va vers une disparition totale. La mutation est déjà en marche même si certains refusent de la voir. Rifkin nous propose de retourner vers ce mode de fonctionnement ancien qui a été décriée par Les lumières et quelques économistes, « éclairés ». Il nous propose ainsi de revenir aux communaux d’avant le capitalisme. Lorsque le monde fonctionnait selon un autre principe de gouvernance. « Il existe en dehors de la propriété purement privée et de la « propriété publique » contrôlée par l’Etat, une forme distincte de « propriété publique par essence » qui n’est pleinement contrôlée ni par l’Etat, ni par des agents privés. C’est une propriété « possédée » collectivement et gérée par la société en général, avec des droits d’une autre nature, et en fait plus forts, que ceux d’un quelconque administrateur de l’Etat »
En clair, entre le diktat de la propriété privée (le fait de placer les richesses entre les mains d’une personne ou d’un groupe de personnes), et celui d’un Etat qui contrôle tout, une brèche s’est ouverte à nouveau : celle d’une communauté de partage et le capitalisme va devoir s’en accommoder.
Mais ce n’est pas le seul changement qui s’opère dans la société, nous dit l’économiste.
Aujourd’hui, nous précise-t-il sans ambages, les écologistes et les hackers font cause commune.
Les biologistes sont, en effet, en train de collecter les données les plus gigantesques de l’histoire en matière de génome, s’appuyant sur l’informatique. Combiner biologie et informatique n’a rien de nouveau mais ce qui est révolutionnaire en revanche, c’est le fait de créer des environnements biologiques virtuels et des écosystèmes qui permettent de générer des molécules synthétiques en quelques clics. Des interactions entre les différentes particules s’opèrent en un temps record ! «L’usage du nouveau langage informatique pour restructurer la société a réuni des intérêts variés, notamment les hackers de l’information, les hackers de la biologie, les hackers de la 3D et les hackers du web propre » !
D’ici dix ans, les imprimantes 3D vont se démocratiser. Nous allons construire nos propres voitures, nos propres objets du quotidien… Ces affirmations font toujours sourire. Mais cette « science-fiction » est en phase de devenir une proche réalité. La machine est déjà en marche et nous allons devenir tous….producteurs ! : De la production de masse à la production des masses, se réjouit l’auteur.
Notre société moderne et le capitalisme nous ont inculqué des valeurs d’exclusion.
Une des ses plus emblématiques expressions peut être incarnée par l’invention de l’automobile. Cette machine est devenue synonyme de liberté, le symbole de la réussite. Mais depuis quelques années, la donne est en train de changer. « En 2012, 800 000 personnes aux Etats-Unis avaient souscrit à un service d’auto-partage. Au niveau mondial 1,7 million de personnes partagent des voitures dans 27 pays », « en 2009, chaque véhicule partagé remplaçait 15 voitures de particuliers », «Les revenus de partage de voitures devraient croître encore plus vite en Amérique du Nord, où ils dépasseront les 3 milliards de dollars en 2016 », nous précise encore l’économiste.
Toutes ces statistiques et ces études convergent vers la même conclusion : l’économie de partage est déjà là et nous sommes en train de vivre les débuts du système économique hybride.
Aujourd’hui la société s’organise, crée une dynamique économique interne, change progressivement les choses et déplace les curseurs. 40 % de l’humanité est connectée à internet. Elle sera portée quasiment à 100 % dans les deux décennies qui arrivent. L’internet des objets sera accessible à tous. « Chacun d’entre nous pourra potentiellement devenir producteur d’information, de culture, d’objets… Chacun pourra devenir prosommateur, à la fois consommateur et producteur ».
Tout au long de ce livre, Rifkin semble nous dire une seule chose : l’économie n’est pas une simple théorie mais une pratique de tous les jours. Nous sommes tous acteurs et penseurs de ces changements et il est temps que chacun prenne l’économie en charge. Cette économie que nous produisons tous les jours !
Par : Amira-Géhanne Khalfallah
Jeremy Rifkin
La nouvelle société du coût marginal zéro
Les liens qui libèrent
509 pages
325 DH
Où est passé le droit du travail ?
Auteur : Rajae Mejjati Alami
L’étude de Rajaa Mejjati Alami sur le secteur informel met en lumière la régression du salariat et la montée de multiples formes d’emploi précaires.
C’est un tableau détaillé. La socio-économiste Rajaa Mejjati Alami, consultante en aide au développement, est l’auteure de nombreux travaux sur le marché du travail, les questions de genre, la pauvreté et le travail des enfants. Elle présente ici le fruit de vingt ans de travaux, une étude précise du secteur informel au Maroc. D’emblée, elle insiste sur la complexité du phénomène. Son premier chapitre est consacré aux définitions, tenant compte de la capacité du secteur informel à créer des emplois, des secteurs couverts, de son opposition au « secteur moderne », de ce qu’il représente comme « débrouillardise populaire » et comme solidarité, ainsi que de ses rapports à la légalité. Secteur en voie d’absorption ? Secteur palliant le sous-emploi et le chômage ? Secteur marginal ? Secteur de petite production soumis au secteur formel ? L’informel est tout cela à la fois. « Dans le sens commun, il est synonyme de pauvreté, d’activité de rue, d’absence de cadre réglementaire ». Le propos de Rajaa Mejjati Alami est surtout politique : « Le contexte d’aggravation des équilibres budgétaires et financiers de l’État, la montée de la pauvreté et de l’emploi indépendant, la hausse du chômage urbain au cours des deux dernières décennies réactualisent le débat et font une large place à la lutte contre l’informel. […] Les organismes internationaux et les pouvoirs publics […] redécouvrent ses vertus, le considérant comme la solution miracle à la crise de l’emploi et, de plus en plus, aux déséquilibres budgétaires. » Depuis les années 1980, les thuriféraires des politiques d’ajustement structurel ont applaudi la « flexibilité » du secteur informel, « notamment celle des rémunérations qui permet une baisse des salaires dans une conjoncture difficile, baisse d’autant plus réalisable qu’elle s’opère dans le cadre de rapports familiaux de travail et en l’absence de respect de la législation du travail ».
Rajaa Mejjati Alami rappelle les grandes tendances macro-économiques qui ont déterminé l’expansion du secteur informel : exode rural, « faiblesse de la salarisation » dans un secteur industriel trop peu employant, faiblesse de l’État-providence amenant les citoyens à subvenir par ce biais à leurs besoins sociaux, conséquences de l’ajustement structurel dans les années 1980, puis du post-ajustement et de la mondialisation. Au final, relève la chercheuse, « non seulement l’emploi recule, mais il se complexifie, générant des modes de réinsertion qui se manifestent par la simultanéité de l’emploi dans le secteur formel et dans le secteur informel ». Et de définir le secteur informel comme « une variable d’ajustement pour les travailleurs qui perdent leur emploi, au détriment des normes de travail décentes ». Elle insiste également sur le lien direct entre marché de l’emploi et santé des secteurs d’exportation, eux-mêmes liés aux aléas des marchés extérieurs. Elle souligne d’autre part la « formalisation incomplète de l’emploi déclaré » et le fait que la montée des services et du commerce procède moins d’une transformation de la structure productive que de l’élimination de travailleurs du secteur industriel. Éviction qui s’opère non « sous le même statut de salarié mais sus le statut de non-salarié (indépendant, petit associé ou aide familial) ». Sous la pression du chômage, ce sont donc des formes multiples et de plus en plus précaires de travail qui se banalisent. Et qui touchent d’abord les plus fragiles : les femmes et les enfants. Rajaa Mejjati Alami déplore que le système productif marocain ait pour principale caractéristique « d’entretenir la précarité de l’activité féminine ». De même, elle déplore que malgré une tendance à la régression et malgré le fait que la Maroc ait ratifié plusieurs conventions internationales et dispose d’une législation protectrice, le travail des enfants constitue encore une masse non négligeable.
Des normes multiples
Dans un second temps, l’auteure analyse les dynamiques endogènes du secteur informel : ses formes d’organisation, ses atouts, ses contraintes. Elle utilise les points de repère de la création d’une entreprise classique (création, développement), ainsi que ses critères d’évaluation (financement, processus de production, insertion sur le marché des biens, rapport à la concurrence, sous-traitance, etc.) Elle se penche surtout sur les relations de travail, qu’elle envisage à travers les filtres du nombre, de la qualification, des réseaux de recrutement et des statuts des travailleurs, concluant à « l’instabilité juridique » générée par des rémunérations irrégulières, dépendant de l’appréciation du patron et revêtant « l’aspect d’une récompense plutôt que d’un salaire ». Dispensées sous forme d’avances, elles ont pour but de « dissuader l’ouvrier de quitter l’unité [et de] contrecarrer l’indépendance financière ». Tout ceci va bien entendu à l’encontre du droit du travail… Lieu refuge face au chômage, le secteur informel est donc rarement un choix.
Rajaa Mejjati Alami fait ensuite un tour d’horizon des politiques étatiques et de l’environnement institutionnel (réglementaire, fiscal et social) face à l’informel, et remarque la marginalité du secteur dans les visions de développement. Le chapitre le plus intéressant du livre est celui sur les perspectives de politiques pour le secteur. La chercheuse appelle à des actions différenciées selon les situations, afin de permettre l’accès au crédit, de proposer une fiscalisation progressive, non forfaitaire mais tenant compte « des capacités de production réelles », de réglementer pour lutter contre les inégalités et permettre l’accès à la formation. S’il fallait retenir un mot de ce livre-inventaire, ce serait de renoncer aux approches globalisantes pour adopter une attitude pragmatique, tenant compte de la dimension culturelle du développement et replaçant institutions et valeurs démocratiques au cœur de la problématique.
Par : Kenza Sefrioui
Le secteur informel au Maroc
Rajaa Mejjati Alami
Les Presses économiques du Maroc, 172 p., 70 DH
Sans rupture de développement, le soulèvement dure
Auteur : Gilbert Achkar
A travers son livre, Le peuple veut, Gilbert Achkar propose une exploration radicale du soulèvement arabe. Et par nombre d’aspects, elle l’est, car « le peuple Veut » constitue reconnaissons-le -un travail colossal, très bien documenté, de plus de 400 pages, sur la nature des sociétés, des économies et des Etats de la région.
Quelles sont les modalités particulières du développement du capitalisme dans la région du Moyen orient et de l’Afrique du nord ? C’est à cela que Gilbert Lachkar s’est attelé en premier lieu à travers une analyse exhaustive ; la dernière partie survient toutefois dans un contexte d’immédiateté où les événements sont toujours en cours de déroulement ce qui pourrait affaiblir l’approche méthodologique. Trait particulier aussi, Lachkar se réfère constamment à l’analyse marxiste des forces et des rapports de production. En effet une panoplie de facteurs économiques et politiques ont accouché d’après l’auteur d’une variante spécifique du mode de production capitaliste installée dans ces pays, bloquant le développement de leur économie et celui de leurs populations.
Il retient de son approche marxiste la thèse du conflit entre le développement des forces productives et des rapports de production pour explorer ses expressions et ses effets dans la situation arabe. Il va jusqu’à recourir à Althusser et son concept de surdétermination pour y parvenir ; notamment dans le contexte des « printemps » où il montre les limites du “tsunami islamique” et aborde ces soulèvements comme le point de départ d’un processus révolutionnaire au long cours, non comme une éruption aboutie.
Crise de développement
Une analyse concrète des forces sociales en présence et un bilan d’étape, pays par pays, l’amène à son premier constat : la région Mena est celle qui connait la crise de développement la plus aigue ; avec un faible taux de croissance du PIB/habitant et une forte croissance démographique ; la situation sociale des populations de la région pourrait être résumée selon l’auteur en une triade : pauvreté-inégalités-précarité. Le Qatar, le pays le plus riche de la région en chiffres relatifs à la population n’échappe pas à cette règle, les inégalités de revenu au sein de chacun des pays arabes sont aussi les plus élevée du monde entier. Par des grilles variées allant du poids du secteur informel, de la situation du chômage en général, celui des diplômés en particulier, le sous emploi des jeunes et des femmes… les critères qui illustrent les blocages socio économiques sont étalés.
Le poids des économies de rente dans le monde arabe est considérable ; la plupart des Etats tirent leurs principaux revenus des exportations de ressources extraites de leur sol (pétrole, minerais ….)ou d’autres biais ; les Etats acquièrent ainsi un degré maximal d’indépendance par rapport à leurs populations, de même la nature de leur pouvoir les placent tous ou presque sur une échelle qui les intègre dans les rangs des régimes « patrimoniaux » ou « néo patrimoniaux »,c'est-à-dire de pouvoirs autocratiques, absolus et héréditaires .De même le capitalisme dominant dans la région est « aventurier, spéculatif et commercial » politiquement déterminé par la nature et les structures du pouvoir .
Les particularités du développement socioéconomique de la région arabe seraient surtout le résultat d’une mutation enclenchée dans les années 1970 au sein du système régional formé au cours des deux décennies précédentes. Ce qui amène notamment l'auteur à mettre l'accent sur les retombées des politiques néolibérales et du désengagement de l'Etat dans les pays arabes. Il insiste sur la faiblesse des investissements publics dans la région et sur le caractère moribond du secteur privé local.
Les facteurs non économiques
Gilbert Lachkar consacre des passages de son analyse à la stratégie des industries des armes dans les conflits qui marquent la région. Il aborde aussi les politiques américaines et leurs jeux complexes avec les frères musulmans, l’Arabie Saoudite, le Qatar …Il n’omet pas de mentionner aussi le rôle d’Al Jazira dans ses différents soubassements son impact dans le bouleversement du paysage médiatique de la région et son effet dans l’émergence relative d’une opinion publique autonome dans ces pays.
A la veille du printemps dit arabe, Gilbert Lachkar note l’absence dans la région de forces politiques organisées porteuses de projets révolutionnaires Dans son analyse des nouveaux acteurs qui ont émergé, il a cherché les acteurs du changement jusqu’aux catégories des utilisateurs d’internet et des réseaux sociaux, les implications politiques potentielles, l’inévitable question des « classes moyennes » etc..Ses conclusions découlent de la nature des Etats dont la plupart sont fondés sur des combinaisons du tribalisme, du confessionnalisme et du régionalisme. L’auteur a tenté une explication de la persistance de ces facteurs archaïques dans le contexte d’une intégration dans le système du capitalisme mondial.
Dans son avant dernier chapitre intitulé « bilan d’étapes du soulèvement arabe »,il procède à une analyse transversale des six composantes majeures de celui-ci ; La Tunisie, l’Egypte, le Bahrein ,le Yémen, la Libye et la Syrie. A travers toutes les péripéties des événements, les implications internationales et toutes les contradictions, l’auteur constate que finalement le tsunami islamique a été d’une ampleur limitée. Il écrit « il faut filer la métaphore jusqu’au bout. Le Tsunami est un phénomène provisoire, il aboutit rarement à un engloutissement permanent. »
Perspectives politiques
Qu’en est-il de l’avenir ? Lachkar opère d’abord une comparaison entre les frères musulmans égyptiens et des militants d’Annahda en Tunisie avec l’AKP en Turquie. Ce dernier est le résultat dit-il de la transformation néolibérale engagée par ce pays réalisant la convergence de son capitalisme « périphérique » (la bourgeoisie pieuse) avec la majorité du grand capital turc avec des atouts économiques importants(marché intérieur, exportation,..).Les frères musulmans et Annahda sont loin de partager ces composantes avec le modèle Erdogan. Les forces de l’islamisme dans le monde arabe partant de parcours différenciés et de conditions autres , demeurent des expressions de la crise qui persiste. Le soulèvement arabe est suspendu selon Gilbert Lachkar à l’émergence de forces politiques organisées en mesure de canaliser les aspirations des peuples de cette région à la liberté et au développement. « Pour le moment, la principale réalisation de ce soulèvement est que les peuples de cette région ont appris à vouloir, » et il conclut « le soulèvement arabe n’en est encore qu’à ses débuts, l’avenir dure longtemps, écrivait le General De Gaulle dans ses mémoires de guerre, une belle formule d’espoir » !
Ce livre, écrit avant l’accès du General Sissi au pouvoir et de la nouvelle constitution tunisienne a dessiné surtout les impasses qui prévalaient avant ces développements. Il a cependant noté à juste titre que si les soulèvements ont abouti à un changement de régime en Tunisie ou en Egypte. Ceux-ci demeurent sous la forte influence des économies du Golfe. Les pouvoirs ne proposent toujours pas un modèle de développement économique cohérent en rupture avec le passé.
Enfin, l’ouvrage en lui-même reprend une certaine tradition de la gauche marxiste arabe dans le développement des analyses politiques sur la situation dans la région ; celles-ci se font de plus en plus rares depuis plus de deux décennies avec le recul de la présence des mouvements de gauche sur la scène politique arabe. De point de vue même de la diversité, où du fait avéré de la l’absence des productions de ce genre dans la bibliographie da la région, le travail de Lachkar mérite toute l’attention.
Par : Bachir Znagui, Journaliste-consultant, Cesem-HEM
Le Coran bien loin du dogme et tout prêt de la raison et de la réflexion
Auteur : Mahmoud Hussein
Après Al-Sîra, (le Prophète de l'Islam raconté par ses compagnons -Grasset -2005 -2007) et Penser le Coran, parus chez le même éditeur en 2009, Bahgat El Nadi et Adel Rifaat, alias, Mahmoud Hussein, reviennent avec un nouvel essai : Ce que le Coran ne dit pas.
Un titre qui interpelle, irrite certains et affranchit d’autres.
Le livre s’ouvre ainsi : « Lire le Coran. L’aborder d’un œil vierge. Le découvrir par soi-même. L’explorer au fil de sa liberté ». De prime abord, les Mahmoud Hussein nous préviennent : Il va falloir penser, se défaire de tout ce que l’on sait, renoncer à nos repères habituels et tout ce qu’on a appris par ailleurs ! En contrepartie, ils nous offrent des horizons plus larges, ouvrent de nouvelles voies et proposent d’aller au fond des choses. Refusant tout enfermement de la religion musulmane dans une lecture littéraire qui ne reconnaît ni le temps ni l’espace, les essayistes nous présentent une lecture libératrice !
Un petit livre (110 pages) très riche, dense, foisonnant d’informations et d’explications. Les deux auteurs, amis et complices dans la vie, d’origine égyptienne vivant à Paris depuis quelques années, ont appuyé des lignes qu’ils avaient déjà tracées dans Penser le Coran. Avec ce nouvel essai, ils nous proposent d’aller aux origines de la Révélation. Ils nous conduisent vers un chemin spirituel loin du dogme, nous engagent dans un procédé de réflexion. Là où tout un chacun devient acteur de sa destinée, et maître de ses croyances. Les Mahmoud Hussein nous restituent cette liberté de penser propre à la religion musulmane et qui a longtemps été occultée. A travers cette nouvelle lecture (voie), « Le croyant découvre ainsi qu’il n’est pas tenu de suivre telles quelles les prescriptions que Dieu a destinées à une période désormais révolue. Il retrouve sa liberté intérieure. Et avec sa conscience, entre les versets qui l’obligent et ceux qui ne le concernent plus».
Liberté, libre-arbitre, Ce que le coran ne dit pas est jonché de ces paroles libératrices. Mais si tel est le message de la Parole Divine, pourquoi sommes-nous arrivés aujourd’hui à un tel enfermement ?
Pour comprendre la situation actuelle, il faut suivre les auteurs aux sources du clivage, à ce débat vieux de plusieurs siècles, qui consiste en l’opposition entre les conformistes et les rationalistes. Pour les premiers « l’homme est dépourvu de la capacité de créer des actes » pour les seconds, Dieu a doué les hommes « d’une capacité de jugement rationnel et d’une puissance créatrice, nommée qudra, en vertu de laquelle ils peuvent produire des actes libres. Le libre-arbitre humain ne s’oppose pas à la toute-puissance divine ». Contre les Mu’tazilites (rationalistes), se dresseront Ibn Hanbal et al-Ash’arï, en gardiens de la Tradition et c’est leur lecture de la religion qui l’emportera pendant des siècles.
Le caractère immuable du Coran est ainsi décrété. Il règnera sur le monde musulman pendant de longs siècles.
Une religion où l’intelligence est possible
Ceux qui connaissent les Mahmoud Hussein remarqueront l’évolution de leur écriture. Dans, Ce que le Coran ne dit pas, ils creusent davantage de sillons pour aller à l’essentiel. Les auteurs ont trouvé outil et matière autant dans le coran que dans la vie du prophète sur laquelle ils se sont penchés pendant de longues années. Ils nous livrent le résultat de leurs recherches et l’énoncent clairement en trois constats.
Premier constat : « la parole de Dieu ne se confond pas avec Lui. Dieu est éternel, mais Sa parole épouse souvent les préoccupations d’une époque historique déterminée, celle de l’Arabie du VIIème siècle, en se référent à des personnes, à des événements, à des problèmes, inscrits dans le temps terrestre ».
Ils confortent ainsi la thèse du Coran « créé ». Pour cela, ils s’appuient sur des versets coraniques, se réfèrent à l’histoire même de la Révélation qui a pris 22 ans. « Les incroyants ont dit : Si seulement le Coran avait été révélé d’une seule traite ! Nous l’avons ainsi révélé pour que ton cœur en soi affermi. Et nous l’avons scandé mot à mot ». XXV 32.
Selon Les Mahmoud Hussein ce verset est la preuve même du caractère évolutif du Coran. Dans ce chapitre, d’autres exemples viennent étayer cette thèse.
Deuxième constat : « La parole de Dieu ne « descend » pas sous forme de monologue, mais sous forme d’un dialogue entre ciel et terre ». Nous entrons alors dans l’Arabie du 7ème siècle et les préoccupations du moment. Dans ce chapitre, les auteurs reviennent sur les circonstances de la révélation, le contexte de l’époque pour resituer certains versets à leur juste valeur. Toute l’organisation sociale de l’Islam s’inscrit dans le circonstanciel. Cela ne veut absolument pas dire que les versets qui s’y affairent sont à renier. Mais seulement à placer dans leur contexte, qu’ils nous servent d’exemple dans leur esprit et essence « Le croyant peut toujours y trouver une leçon à méditer, une inspiration à suivre, une réflexion à déployer », précisent les auteurs.
Troisième constat : « Dieu n’a pas donné à tous les moments de Sa Parole la même portée. Il prononce des vérités d’ordres différents, entrelaçant l’absolu et le relatif, le perpétuel et le circonstanciel. Un grand nombre de versets revêtent une portée qui déborde le cadre temporel où ils ont été révélés, qui touche au fondements spirituels, métaphysiques, eschatologiques de l’Islam ».
Aussi, la question des versets abrogés y est relevée pour dire l’aspect évolutif du message divin, le situant ainsi dans l’espace et le temps.
Les essayistes nous transportent vers un autre niveau de compréhension, là où chacun est autorisé à utiliser son intellect pour trouver sa voie, là où la raison et la réflexion l’emportent, là où les mots ne sont pas dépourvus de leurs sens cachés, là où l’intelligence est possible.
Prendre acte, c’est ainsi qu’on pourrait résumer cet essai plein d’amour, précis sans lourdeur et fluide sans légèreté.
Par : Amira Géhanne Khalfallah
Ce que le Coran ne dit pas
Mahmoud Hussein
Grasset
110 pages
9 euros
10 scénarios catastrophes pour sauver la planète
Auteur : Alain Grousset
Alain Grousset nous livre des fictions documentaires pour nous alerter des dangers imminents qui guettent la planète. Un florilège de textes, doux-amers, regroupant 10 auteurs qui nous racontent dix histoires effrayantes dans une très belle écriture.
Glaciation, inondations, pollution, guerre atomique, disparition de la faune et de la flore, manipulations génétiques, guerre avec les machines, guerre avec les insectes…sont autant de thématiques abordées dans ce recueil de nouvelles, sous le titre : 10 façons d’assassiner la planète, comme 10 recettes faciles à exécuter pour en finir au plus vite avec la terre. Des focus si proches de la réalité et de la caricature qu’on se demande comment est-ce possible ? Alain Grousset, responsable des littératures de l’imaginaire dans le magazine Lire, a joué le rôle d’anthologiste et nous propose une fiction basée sur des prévisions bien réelles. « En explorant dix possibles souvent très noirs, les dix grands auteurs de cette anthologie ont tous la volonté d’attirer l’attention sur ce qui risque à coup sûr d’arriver si l’on ne réagit pas dès aujourd’hui », avertit l’anthologiste.
Comme nous le savons tous, la science fiction s’accommode si bien des scénarios apocalyptiques et catastrophiques. Mais l’anticipation nous donne à voir davantage la réalité et le présent, qui du coup, paraissent si grossiers.
Lee Hoffman le célèbre auteur de science fiction nous prête quelques réflexions à propos de la surpopulation de la terre. Tandis que Christophe Lambert choisit l’humour pour nous parler de la disparition de la faune et la flore. Une lecture à faire de préférence en dégustant une salade bien croquante, avertit Grousset ! Le héros de cette nouvelle est visité par un homme qui vient du XXIIème siècle «d’où je viens, explique le visiteur, la nature n’est plus qu’un souvenir lointain...(…) on a bien essayé de faire pousser des arbres, des légumes et des fleurs dans des serres, à l’abri des poisons sécrétés par l’industrie et la circulation, mais un virus a terminé ce que l’homme avait commencé. La dernière plante, une marguerite pourtant très résistante, est morte le 18 janvier 2167. Ce fut un jour de deuil mondial ».
« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ! », disait le petit prince de Saint-Exupéry. La disparition de la dernière fleur de la planète en est la démonstration.
Disparition de fleurs, d’animaux… mais aussi inondations. Le jour où la planète se mettrait à pleurer, nous dit poétiquement Grousset, ce jour-là, même Noé ne pourra y échapper !
Aquella de Donald A. Wolheim, nous raconte ce désastre. Cette nouvelle a la particularité d’avoir été écrite par le célèbre auteur de science fiction en 1942. Une histoire qui fait sourire malgré tout, lorsqu’on apprend que la planète Aquella s’appelait : La terre, il y a bien longtemps !
Chez Robert Bloch, Le jour se lève. Dans cette nouvelle proche de la fin du monde où la bombe atomique a tout détruit, l’auteur reste contemplatif et s’interdit tout propos moralisateur. Le narrateur raconte seulement ce qu’il voit dans des descriptions détachées et sans état d’âme, comme pour dire que même chez ce survivant, la mort s’est bien introduite, excluant toute émotion «dans un sous-sol, un studio d’artiste ouvert en plein ciel ; ses murs étaient encore intacts et couverts de toiles abstraites. Au centre de la pièce se dressait un chevalet, mais l’artiste avait disparu. Ce qui restait de lui était étalé en une masse dégoulinante sur le tableau, comme si l’artiste avait réussi à mettre quelque chose de lui-même dans la peinture ». Si la science-fiction aime les catastrophes, notre réalité semble bien s’en accommoder. Les OGM sont déjà dans nos assiettes et on n’a pas fini de découvrir leurs effets néfastes sur nos corps et leur impact sur la faune et la flore. Allons vers le futur alors pour voir un peu ce qui s’y passe. On lit cette nouvelle, comme on regarderait à travers une serrure, l’air effrayé. Pourtant, ces fictions sont aussi, autant de scénarios que l’on pourrait encore éviter. La science-fiction engagée est aujourd’hui un outil dont on peut se servir pour réaliser nos contradictions.
La guerre avec les insectes est la plus récente nouvelle, très douloureuse car tellement imminente. On se sent si proche du gouffre en lisant la projection, Le sacrifié de Philip K. Dick. Grousset s’amuse à nous introduire chaque thématique par des commentaires dont la gravité n’empêche pas l’humour et la légèreté. « Les insectes s’adaptent à l’environnement humain, ironise-t-il, Les cafards adorent nos cuisines ! Dès qu’un nouvel insecticide est trouvé, les insectes mutent aussitôt et deviennent encore plus résistants. Ils sont patients, ils savent que nous ne sommes qu’une parenthèse dans leur longue histoire. Chaque jour, ils gagnent un peu de terrain : une nouvelle maison infectée de termites par-ci, l’agrandissement d’une fourmilière par-là, les insectes nous tolèrent pour l’instant ! »
A la fin de cette lecture, on finit par se demander si avant tout, l’homme ne serait-il pas en guerre contre lui-même ? Pour les amoureux de la science-fiction ce livre est un petit bijou, pour les écolos, il est un outil de travail, pour ceux qui ne seraient pas encore conscients du danger, c’est une source d’information très riche. Il y a à boire et à manger dans ces dix façons d’assassiner notre planète. N’hésitez pas, tant que c’est encore possible !
Par : Amira Géhanne Khalfallah
10 façons d’assassiner la planète
Alain Grousset
Flammarion
142 pages
94 DH
Houellebecq et la pensée économique
Auteur : Bernard Maris
L’économiste Bernard Maris propose une lecture de l’œuvre de Michel Houellebecq en soulignant la dénonciation qu’il fait du capitalisme.
« Aucun écrivain n’est arrivé à saisir le malaise économique qui gangrène notre époque comme lui », s’enthousiasme l’économiste et journaliste français Bernard Maris à propos du romancier Michel Houellebecq. Compétition, destruction créatrice, productivité, travail parasitaire versus travail utile, argent… tous ces thèmes sont présents dans son œuvre, depuis son essai sur Lovecraft (Le Rocher, 1991), jusqu’à La Carte et le territoire (Flammarion, 2010), couronné du prix Goncourt. « Extension du domaine de la lutte parlait du libéralisme et de la compétition, Les Particules élémentaires du règne de l’individualisme absolu et du consumérisme, Plateforme de l’utile et de l’inutile et de l’offre et de la demande de sexe, La Possibilité d’une île de la société post-capitaliste ayant réalisé le fantasme des « kids définitifs » que sont les consommateurs, la vie éternelle. Et chaque roman reprenait le refrain des autres : la compétition perverse, la servitude volontaire, la peur, l’envie, le progrès, la solitude, l’obsolescence, etc., etc. » Mieux, souligne l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation en économie, dont le très piquant Antimanuel d’économie (Bréal, 2003), Houellebecq fait référence à de nombreux penseurs de l’économie : Fourier, Proudhon, Orwell, William Morris… Bernard Maris relève notamment cinq grands économistes dont les idées phares sont en dialogue avec cette œuvre littéraire comparée à Balzac pour son réalisme et à Céline pour sa noirceur.
D’abord Alfred Marshall (1842-1924), penseur de la question de la valeur économique et de la loi de l’offre et de la demande. Houellebecq, lui, y voit le triomphe absolu des individus et l’effritement de la société en une infinité de « particules élémentaires » flottant, en l’absence de corps intermédiaires, dans un « univers de transactions généralisées » qui débouche sur un cauchemar : « le bonheur quantifiable ». Le héros de La Carte et le territoire, Jed, étend cette réflexion sur la loi de l’offre et de la demande à la production artistique : « Jed connaît sa valeur de marché. Mais ce qu’il vaut vraiment, il l’ignore », note Bernard Maris. Houellebecq ne cesse de condamner dans le capitalisme cet « état de guerre permanente » (Plateforme) et déplore que la société occidentale repose sur le fait d’« augmenter les désirs jusqu’à l’insoutenable tout en rendant leur réalisation de plus en plus inaccessible » (La Possibilité d’une île).
« Darwinisme social »
Joseph Schumpeter (1883-1950) voyait dans l’innovation et le progrès technique les moteurs de l’économie. Houellebecq pointe le « terrorisme de l’obsolescence » programmée des marchandises. Ses personnages sont souvent des cadres dont la « fonction unique » (La Poursuite du bonheur) est de consommer. « L’entreprise est le royaume de l’asservi volontaire, explique Bernard Maris. Le cadre n’a pas le pouvoir. Il est condamné à servir son maître pour maintenir un niveau de salaire destiné à satisfaire son unique moteur, la consommation ». D’où des pages terribles sur la « rivalité mimétique » de cadres à l’insatiable « soif de pacotilles ». Tel est le « domaine de la lutte ». Quant à l’innovation, elle est un outil de déstabilisation et d’asservissement par la peur, puisqu’« il s’agit le plus souvent de démoder aux yeux du public des objets auxquels il aurait le tort de s’habituer, et auprès desquels il acquerrait une certaine sécurité ». Les seuls personnages positifs ceux qui « ne réagissent pas mécaniquement aux stimuli de l’argent – bref, les anti-homo-oeconomicus », conclut Bernard Maris.
Avec John Maynard Keynes (1983-1946), Houellebecq met en cause « cet aspect infantile, puéril du capitalisme et de la société de consommation (l’impossibilité de s’arrêter, d’être saturé, de ne pas en demander plus) ». Agitation tragique, s’il en est, insiste Bernard Maris : « Pourquoi les hommes s’agitent-ils, sinon pour ne pas voir ce qui les attend, la maladie et la mort ? […] La consommation perpétuelle n’est-elle pas la forme suprême du divertissement pascalien ? » Tablettes, consoles, Smarphones…, « le monde moderne est un monde de jouets » où, sous l’injonction de la publicité, l’homme s’abîme solitaire, oublieux de liens collectifs qui dérangent un marché « abolissant tout lien autre que monétaire ». Dans ce système, la culture n’est tolérée qu’en tant que moment de pause évitant « la suffocation dans le travail et la consommation ».
Karl Marx (1818-1883) et Charles Fourier (1772-1837) réfléchissaient à la dignité des travailleurs, Houellebecq s’interroge sur l’utilité du travail produit. « Les ouvriers, les techniciens ont son respect », note Bernard Maris. « Les autres – commerciaux, publicitaires, stylistes, cadres administratifs privés ou publics – sont simplement des « parasites » ». En effet, « ce n’est pas parce que l’on fait de l’argent que l’on crée de la richesse ». Les romans de Houellebecq décortiquent les mécanismes de domination et d’asservissement à l’œuvre sur le marché du travail. Ils déplorent la césure étanche entre les deux parties de la vie humaine, entre son travail et le temps où il reconstitue sa force de travail – Marx rêvait, rappelle Bernard Maris, d’une société abolissant la distinction entre travail manuel et travail intellectuel.
Enfin Thomas Malthus (1766-1834), témoin de la dureté de la condition ouvrière, développait une thèse sur l’élimination « naturelle » des pauvres. Michel Houellebecq, lui, peuple ses romans d’êtres faibles « que la nature se chargera d’éliminer ». « Le thème du suicide occidental au terme du capitalisme » est, selon Bernard Maris, un leitmotiv de cette œuvre, où une happy end est réservée aux happy few. Pour les autres, c’est la misère affective et sexuelle (Plateforme). « A la baisse tendancielle du taux de profit, ajoute Michel Houellebecq, correspond la baisse tendancielle du taux de désir : cette société ne sait plus comment attiser le désir, exciter les sens ». Dans La Possibilité d’une île, Michel Houellebecq écrivait : « Toute civilisation pouvait se juger au sort qu’elle réservait aux plus faibles ». Une lecture stimulante pour relire un écrivain majeur.
Par : Kenza Sefrioui
Houellebcq économiste
Bernard Maris
Flammarion, 160 p., 14 €
Management : osez le jazz !
Auteur : Frank J. Barrett, traduit de l’anglais par Evelyne Kuoh
Le jazz repose sur une forme d’organisation souple, ouverte et responsable qui peut être un modèle pour les entreprises innovantes.
Miles Davis, Duke Ellington, Sonny Rollins... Ces géants du jazz sont rarement cités dans les travaux sur l’entreprise et le management. Pour Frank J. Barrett, c’est un tort. Ce professeur en management et en comportement organisationnel en Californie est aussi pianiste de jazz. Et c’est avec sa sensibilité de musicien qu’il pense les questions de développement humain et organisationnel. Son livre naît du constat largement partagé que le monde du travail a changé. Au XXème siècle, l’organisation se faisait de façon rigoureuse. Aujourd’hui, il faut « accroître notre vision du leadership au-delà de ces modèles hiérarchiques, afin de mieux apprécier le pouvoir du relationnel ». Au XXIème siècle, « l’accent doit être mis sur les équipes plutôt que sur les individus, et l’on devrait encourager l’apprentissage et l’innovation en continu plutôt que le respect de plans préétablis ». Pour éclairer le monde de l’entreprise, l’auteur s’inspire d’exemples tirés du monde du jazz. Il entend ainsi « montrer comment certains de ces principes sont déjà mis en pratique dans de nombreuses entreprises ».
Premier principe : « bousculer les routines, maîtriser l’art de désapprendre ». Dans un environnement « de plus en plus chaotique et turbulent », les modèles de commandement et de contrôle sont dépassés et le management doit évoluer de l’art de la planification à celui de l’improvisation. Face aux crises, il faut savoir abandonner les routines pour répondre dans l’instant et « une trop grande confiance dans les schémas appris (pensée familière ou automatique) a tendance à limiter la prise de risque nécessaire au développement du génie créatif, de la même manière que trop de règles et de contrôles freinent l’interaction des idées ». Mais, précise Frank J. Barrett, improviser n’est pas le fait de génies autodidactes, c’est « un art très complexe, le résultat d’un apprentissage implacable et d’une imagination domptée », supposant des années de pratique et d’imprégnation de schémas.
Deuxième principe : « oser le chaos, dire oui à l’inconnu ». « Bien que les musiciens de jazz soient surtout connus pour leurs solos, le jazz est en définitive un processus permanent d’intégration par le groupe », insiste Frank J. Barrett : le dialogue et les échanges sont permanents et reposent sur le fait que « les musiciens se disent implicitement « oui » », acceptent le jeu du bricolage, se mettent dans un « état de totale réceptivité ». De même, un manager doit pouvoir « imaginer, suspendre le doute et faire un saut dans l’action, même s’il ne sait pas où ses choix vont le mener ».
Briser les carcans
Troisième principe : « expérimenter dans l’action, transformer les erreurs en apprentissages ». La logique est ici une « esthétique de l’imperfection », reposant sur « le courage de l’effort » et la « culture de l’erreur constructive ». Il s’agit de créer une « zone psychologique de confort » où les individus se sentent libres d’expérimenter pour apprendre, de prendre des risques en zone de sécurité, de s’engager dans l’action mais aussi d’évoquer leurs erreurs et d’y réfléchir.
Quatrième principe : « équilibrer liberté et contraintes, une structure minimale pour une autonomie maximale ». Le mot clef est ici « autonomie sous contrôle ». Les orchestres de jazz sont des systèmes « chaordiques », combinant ordre et chaos, créant « des carrefours de décision pour éviter de se laisser gouverner par des règles stériles, tout en optimisant la diversité [et] encourageant l’exploration et l’expérimentation ». Les organisations innovantes aussi. Comme dans les systèmes complexes décrits par les sciences physiques et la biologie, qu’une pensée linéaire ne peut appréhender et où l’action émerge en situation de déséquilibre, et non d’ordre, il faut donc une normalisation minimale pour garantir l’équilibre entre autonomie et interdépendance. Au modèle classique des trois R (Règle, Rôle, Responsabilité), Frank J. Barrett préfère celui de l’auto-organisation soutenue par des liens souples et non étouffants, adopté par les communautés comme Wikipédia.
Cinquième principe : « improviser, partager les expériences ». Dans les jam sessions, « on apprend en faisant », en jouant, au hasard. Il faut reconnaître la richesse des pratiques, au-delà des fiches de postes conventionnelles, multiplier les collaborations selon le processus du crowdsourcing, comme l’a fait Linux, car « les grandes idées sont souvent générées dans des environnements favorables à la convivialité et à l’échange. »
Sixième principe : « le véritable accompagnement, alterner followership et leadership ». Au PDG rock star, considéré comme le créateur de la richesse de l’entreprise, le jazz oppose le leadership tournant et l’art du comping, reposant sur l’écoute généreuse, véritable source de créativité. Dans les entreprises, plaide Frank J. Barrett, « l’accompagnement – le fait d’aider les autres à réfléchir tout haut et à exprimer le meilleur d’eux-mêmes – devrait être un art plus souvent reconnu et récompensé », car il suppose de savoir défendre sa position en même temps que donner aux autres l’espace pour expérimenter.
Septième principe : « l’art de provoquer, insuffler l’envie de se dépasser ». Il s’agit d’encourager un état d’esprit créatif, en considérant que le confort de la compétence peut devenir un piège et en cultivant la réactivité et le dynamisme. Ainsi Miles Davis, en travaillant avec son quintet sur l’album Kind of Blue, a-t-il jeté à l’eau ses musiciens, leur faisant expérimenter leur vulnérabilité mais en les soutenant. « Le travail d’un leader est de créer la divergence, la dissonance qui va provoquer les gens et les faire sortir de leurs postures habituelles et de leurs schémas comportementaux répétitifs ». Pour Frank J. Barrett, les leaders doivent avoir la « capacité de discipliner leur imagination de façon à voir le potentiel d’un individu ou d’un groupe, même s’il ne s’est pas encore réalisé ».
Huitième principe : « maîtriser l’art du chaos ». En conclusion, Frank J. Barrett récapitule les étapes d’implantation d’une culture valorisant l’improvisation, en insistant sur le fait que le jazz est une source de responsabilité et de créativité. Frais et stimulant.
Par : Kenza Sefrioui
Jazz et leadership, osez l’improvisation !
Frank J. Barrett, traduit de l’anglais par Evelyne Kuoh
Diateino, 224 p., 19,90 €
Le Royaume juif d’Afrique renaîtra-t-il de ses cendres ?
Auteur : Edith Bruder
De plus en plus d’Africains se revendiquent juifs. Les ethnies et les origines sont diverses et les rites religieux se confondent dans une Afrique à la spiritualité abondante. Mais qui sont-ils ? Quelles sont leurs origines ?
Edith Bruder est chercheuse associée à la prestigieuse School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres. En 2008 elle publie, The Black Jews of Africa. History, Religion, Identity, chez Oxford University Press. Et en 2014, c’est Albin Michel qui reprend ses recherches et décide d’éditer l’adaptation française de l’étude universitaire. L’anthropologue a mené une minutieuse enquête pour remonter aux origines de quelques ethnies et à leurs pratiques religieuses. Mais qui sont ces juifs d’Afrique ? Et surtout, comment se revendiquent-ils du judaïsme ?
La chercheuse s’est attelée à croiser les paramètres, les informations pour trouver des réponses. « En faisant le choix d’ancêtres hébreux, quelques sociétés africaines ont ré-imaginé- ou peut être retrouvé- au XXème siècle une identité religieuse les associant au peuple juif. L’impact de la Bible sur l’imaginaire généalogique des Africains et des Afro-Américains, les mythes et leurs interrelations avec le colonialisme, les bouleversements de l’histoire sont autant d’axes de clivages autour desquels s’est structuré ce nouvel ordre religieux ».
Bruder s’est intéressé plus précisément aux Africains sub-sahariens et à leurs pratiques religieuses. Son livre commence par se référer aux mythes fondateurs de ces peuples. La plus part de ces Juifs, se considèrent enfants de Salomon et de la Reine de Saba et ils incarnent le Royaume juif d’Afrique. Une origine fantasmée, embellie de génération en génération jusqu’à la totale confusion ! Pour arriver à démêler l’imbroglio, la chercheuse est allée au-delà des sources historiques officielles pour extraire « les indices dont l’histoire conventionnelle n’a pas enregistré les péripéties », prévient-elle de prime abord.
Les communautés juives africaines sont très diverses. Aujourd’hui on ne peut affirmer leur nombre. On dit qu’il s’agit de dizaine de milliers. Les plus connues sont les Zakhor au Mali, House of Israël au Ghana, les Igbo au Nigeria, les Baluba au Congo, les Abayudaya en Ouganda (phénomène unique de conversion massive qui a été vécu comme une révélation communautaire) …Il y a aussi les Lemba au Zimbabwe et en Afrique du Sud, les Tutsi Hebrews of Havilah au Rwanda, Les juifs de Tombouctou, (qui pourraient être des descendants des juifs du Touat qui ont fuit des exterminations au XVème siècle)…On peut recenser également, les Beth Yeshouroun au Cameroun (reconnus par le rabinnat en seulement quatre ans) contrairement aux Falashas qui n’ont été reconnus que tardivement, dans les années 80… aujourd’hui, une nouvelle communauté se revendique juive, il s’agit des Beta Abraham.
Ces communautés sont aussi diverses du point de vue ethnique que dans leurs pratiques religieuses et spirituelles.
Dans cette masse hétéroclite, les amalgames sont aussi nombreux. Et les missionnaires de l’époque coloniale en sont pour quelque chose.
Ces derniers ont associé les rites qu’ils ne connaissaient pas à ceux de l’ancien testament. C’est ainsi que certains peuples ont été identifiés comme Hébreux. Ce qui a été réintégré chez ces derniers. Pourtant, dans certaines communautés identifiées comme juives, on reconnaît des pratiques qu’on pourrait qualifier de « peu orthodoxes ». En effet, les juifs d’Afrique pratiquent un judaïsme mélangé à des rites africains. D’autres fois, les croyants vont également à l’église ou à la Mosquée !
C’est le cas de certaines tribus de l’Afrique australe. L’exemple des Lemba semble édifient. « L’observation de ces groupes révèle que leur système de croyance se situe aux frontières de plusieurs traditions religieuses et inclut, entre autres, des règles strictes caractéristiques du judaïsme concernant la circoncision, l’alimentation, la pureté, l’endogamie. L’affirmation de leur ascendance juive repose sur une forte tradition orale concernant un exil antique, au VIème ou VII ème siècle avant notre ère, lorsque leurs ancêtres juifs émigrèrent comme marchands depuis le nord du Yémen où il s’étaient installés après l’exil Babylonien »
Les origines juives des tribus africaines ont surtout été apportées par la tradition orale. Il n’y a pas de source directe pour les établir. Et l’Afrique comme on le sait, ne s’écrit pas, elle se dit !
Par ailleurs, la colonisation a été un facteur important et déterminent des pratiques religieuses en Afrique. Les esclaves ont dû suivre la religion de leurs maîtres sans trop savoir pourquoi. Aux îles Canaries un certain Lucien Wolf a recueilli un ensemble de témoignages d’esclaves indiquant un fort prosélytisme au XIX ème siècle. Un esclave noir affirmait que « ses employeurs ont tenté de lui faire adopter leurs coutumes (juives) sous la menace ». Tandis qu’un autre affirmait qu’il ne travaillait pas le samedi parce que son maître lui avait ordonné de ne rien faire…
Ce phénomène reste très peu étudié. On a toujours porté plus d’intérêt à suivre les conversions chrétiennes que juives en terre d’Afrique. Seulement quelques témoignages donnent à voir cet aspect.
Si les Israélites de la Bible avaient pour ancêtres les douze fils de Jacob, aujourd’hui il est difficile d’établir la filiation de ces milliers d’Africains qui se disent des dix tribus perdues d’Israël. Le mythe a la peau dure et la science n’a pas dit son dernier mot.
Par : Amira-Géhanne Khalfallah
Edith Bruder
Black Jews
Albin Michel
315 pages
297 DH.