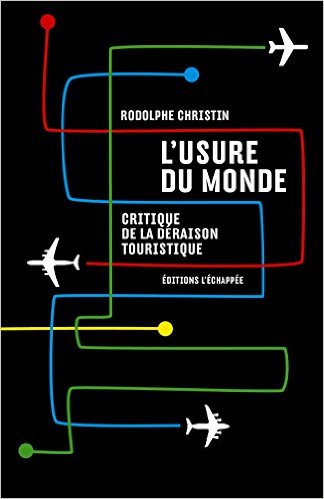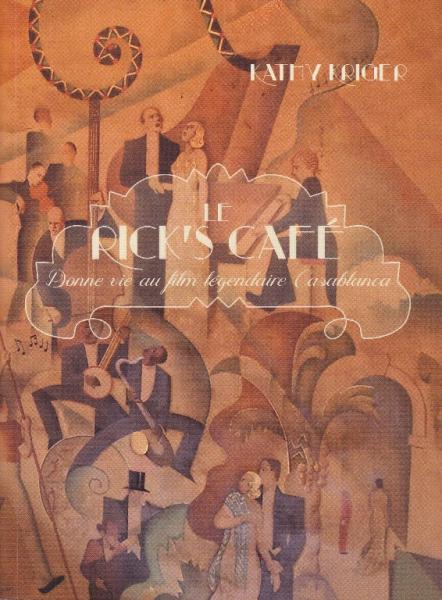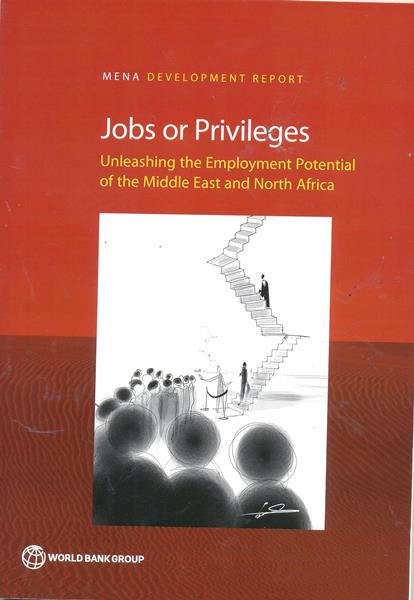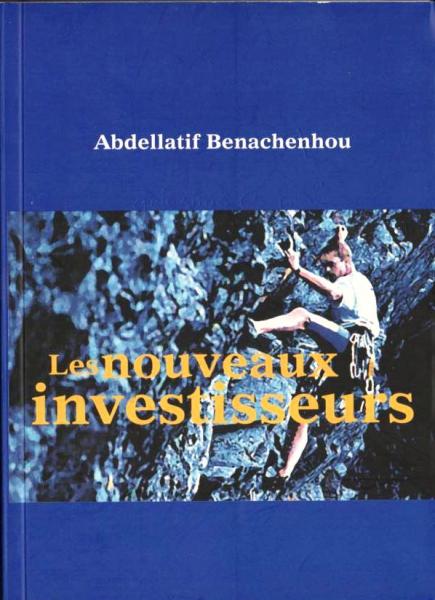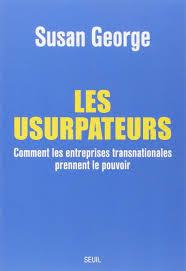Pour dialoguer avec les philosophes oubliés
Auteur : Ali Benmakhlouf
Le philosophe Ali Benmakhlouf se penche sur l’héritage oublié des philosophes arabes médiévaux à la lumière de la philosophie contemporaine.
Al-Fârâbî, Al-Ghazâlî, Al-Kindî, Al-Râzî, Averroès, Avicenne, Ibn Bâjja, Ibn Khaldûn, Ibn Ridwan, Al-Shafi’î, Sohrawardî, Ibn Taymiyya ou encore Ibn Tufayl… Ces grands noms de la pensée classique de langue arabe sont aujourd’hui trop souvent cantonnés à des études spécialisées. Ali Benmakhlouf entend les sortir de ce cloisonnement tant géographique qu’historique.« [Leur] engagement s’inscrit dans une vaste histoire commune à tous les hommes : non pas celle des Arabes ou des musulmans seulement, mais une histoire qui intègre des Anciens, des païens, des non-Arabes, des non-musulmans. La langue arabe a unifié durant plus de sept siècles une production philosophique que la « tradition de l’humanité », autrement dit la transmission d’un legs commun de l’humanité, n’a pas toujours intégrée en tant que tel. » Philosophe spécialiste de logique, qui enseigne à l’Université Paris-Est et à Sciences Po Pariset a consacré plusieurs ouvrages à Averroès, Al-Fârâbî, Montaigne et aux logiciens Russell et Frege, il estime en effet que ces penseurs appartiennent au patrimoine de l’humanité et, en tant que tels, doivent être relus dans un dialogue avec la pensée contemporaine.
Pourquoi lire les philosophes arabes est un essai stimulant qui adopte un cheminement thématique. Ali Benmakhlouf a voulu en effet se démarquer des anthologies et des ouvrages d’histoire de la philosophie.Philosophie politique, médecine, droit, histoire, vérité, religion sont en effet des thèmes qui ont interpellé les penseurs d’hier comme d’aujourd’hui. Aussi l’auteur propose-t-il un rapprochement entre les travaux anciens et contemporains, afin de déceler les points communs de doctrine et de méthode. Les classiques sont donc relus dans un dialogue avec Ali Abderrazek, Mohammed Arkoun, Muhsin Mahdi ou Mustapha Safouan, pour les penseurs arabes, mais aussi avec Michel Foucault, Henri Corbin, Jean Jolivet, Paul Ricoeur ou encore Paul Veyne. Il est question de l’art d’organiser la cité, de penser la civilisation, de légiférer, de gouverner et de conseiller les princes. Plus loin, on se penche sur les pratiques de santé, la connaissance du corps humain, la médecine en ce qu’elle porte de « souci de soi et soin des autres ». « Civilité et histoire », porte sur les « rationalités historiques et discursives », avec de belles analyses sur la « méthode sceptique et continuiste » d’Ibn Khaldûn. Un autre chapitre est consacré à la philosophie du droit, aux fondements du droit et aux fondements du pouvoir, aux rôles respectifs du philosophe et du jurisconsulte. Ali Benmakhlouf développe à ce sujet les enjeux contemporains de la charia, dont le terme même« porte avec lui un ensemble de déterminations fantasmatiques : régimes de terreur où les mains sont coupées, les femmes répudiées, revendications extrémistes de groupes terroristes, droit archaïque des premiers âges de l’islam, ensemble de sanctions incompatibles avec les droits de l’homme, etc. », alors que « en dehors des rapports de pouvoir, comment peut-on véritablement dire ce qu’est la charia ? » Et d’appeler à sortir de cette indétermination du mot, prétexte à « l’immuniser contre tout changement historique », pour refaire le travail critique d’Ibn Khaldûn, Ali Abderrazek, Mohammed Arkoun et Wael B. Hallaq.
Réfuter les préjugés
Ali Benmakhlouf insiste, dans les deux premiers chapitres du livre, sur l’« engagement en vérité » des philosophes arabes médiévaux. Un engagement non univoque : « Si tous insistent pour dire que la vérité est une et la même, ils reconnaissent cependant que les accès à une telle vérité sont multiples et stratégiques. » Au cœur de ce rappel, la volonté de réfuter un préjugé fortement ancré par Ernest Renan à l’égard de ces philosophesen qui il voyait une « pâle copie de la philosophie grecque », en opposition avec la charia. « D’un côté, dans le domaine de la pensée, les Arabes n’auraient rien inventé, d’autre part, ils auraient des normes à part, trop spécifiques pour être comparables aux autres normes, et leur tradition philosophique ne les inscrirait pas dans l’histoire commune de l’humanité. Ce stéréotype revient à penser que la charia, conçue comme spécifique, est anhistorique, et que la philosophie arabe, vue comme imitative, n’a servi que de relais à la philosophie grecque pour passer d’Athènes à Paris, puis à Oxford et Padoue ». Argument infondé, symptomatique de la réception de la philosophie arabe au XIXème siècle… Or, rappelle Ali Benmakhlouf, « la contradiction qui se construit alors entre philosophie et religion est un produit de l’histoire, elle est purement contingente ». Il insiste sur le fait que la philosophie arabe s’est constituée « comme une parole argumentée et non comme une parole inspirée » et s’est donc appuyée sur la poétique et la rhétorique pour « valider ses raisons philosophiques », faisant de ces disciplines un enjeu autant cognitif que religieux.Si la vérité « ne saurait être multiple, ce sont les accès à la vérité qui le sont », d’où le double effort de conciliation qui oriente les travaux de ces penseurs : « d’une part une conciliation de la loi divine avec les philosophies païennes de Platon et d’Aristote, d’autre part une conciliation de ces philosophies païennes entre elles ». Ainsi, la dualité entre la foi et la raison est construite a posteriori, et ce qui prime, ce sont les multiples moyens que la connaissance offre d’accéder à la vérité.
À propos d’Al-Fârâbî, Ali Benmakhlouf conclut : « Si humanisme il y a, dans cette philosophie, il est d’abord rapporté à la manière dont l’homme prend place au sein d’un monde qu’il se doit de connaître ».Certes, les catégories modernes ne recoupent pas exactement les catégories médiévales, explique-t-il : « Notre recherche s’inscrit dans une optique délibérément non subjectiviste de la connaissance, où l’intelligence scientifique d’un Charles Sander Peirce, le trésor des pensées d’un Gottlob Frege ou le réseau des intelligibles d’un Averroès sont convoqués en lieu et place de la réflexivité d’un sujet, fût-il transcendantal. On ne s’étonnera pas de voir se relativiser dans ce travail le parti pris subjectiviste de la philosophie moderne. Au « je pense », notre perspective substitue un « ceci est pensé ». Et le médiéval se trouve rejoindre le contemporain ».Au final, ce livre est une belle et érudite invitation à replonger dans les classiques.
Par : Kenza Sefrioui
Pourquoi lire les philosophes arabes
Ali Benmakhlouf
Albin Michel, 208 p., 210 DH
Tourisme : l’envers du décor
Auteur : Rodolphe Christin
Le tourisme, un des avatars de la mobilité, idée néolibérale par excellence, induit un rapport conformiste et consumériste au monde.
Je voyage, donc je suis libre ? Pour Rodolphe Christin, rien n’est moins sûr. Le sociologue français est l’auteur de L’imaginaire voyageur ou l’expérience exotique (L’Harmattan, 2000) et du Manuel de l’antitourisme (Ecosociété, 2014), ouvrages dans lesquels il s’intéresse à la contradiction entre le mythe du voyage et les réalités touristiques. Dans L’Usure du monde, il met en question l’adéquation, dans les discours contemporains, entre mobilité et liberté.« Avec la télévision, les antidépresseurs, le football, la fête de la musique et les somnifères, le départ en vacances a rejoint la panoplie des anesthésiants et des défouloirs institutionnels que la société de consommation administre à ses citoyens. Une rétribution compensatoire, à la manière de la permission concédée au soldat pour supporter le casernement. Nécessité plutôt que liberté. »Si le voyage est un élément structurant pour l’humanité, « engageant la pensée pratique autant que l’imaginaire, le mouvement physique autant que la conscience symbolique », le tourisme, lui, estla « dégradation de la portée symbolique du voyage » : mettant l’accent sur sa portée économique, il est « la réponse que la culture du capitalisme apporte afin de canaliser le fond subversif à l’origine de la recherche d’une transformation de sa condition. »
Rodolphe Christin rappelle que la mobilité a pendant longtemps été imposée par les circonstances économiques – d’où l’exode rural – et que les voyageurs qui s’aventuraient hors des sentiers battus, comme London ou Cendrars, étaient des exceptions, tant ils prenaient de risques. Du reste, c’est bien parce que le voyage était l’exception qu’il méritait d’être raconté. Aujourd’hui, la mobilité est devenue un « modèle comportemental », une norme, voire « une manière de contenir chacun dans une fonction ou dans des espaces sociologiquement prédéfinis ». Les avancées sociales qui ont marqué l’histoire du salariat, telles que les congés payés, ont libéré un temps vite devenu la cible de « nouvelles formes de contrôle social » : d’où « la normalisation touristique du temps libre », jetant les fondations d’un mode de vie « consubstantiel à la société de consommation ». C’est ainsi que le touriste est devenu « le type même de l’individu moderne « libéral », la version en mode loisir du techno-nomadisant professionnel », « un « nomade » sans territoire, technologiquement connecté et affectivement seul », allant chercher à l’autre bout du monde une convivialité qu’il peine à construire chez lui, bref, un consommateur dans un monde organisé en gigantesque magasin. Un être dont « l’apparente liberté de mouvement » a deux contreparties : « les « clouds » virtuels supposés briser les amarres du lieu au profit de liens technologiques étrangement passés sous silence » d’une part, et de l’autre, la nécessité de sans cesse passer à la caisse.
Fausses libertés
Cette idéologie de mobilité généralisée demeure pourtant un slogan « au regard des processus de néosédentarité et de relégation d’ordre économique, social et culturel ». Le voyage d’agrément suppose en effet un niveau de richesse hors de portée du plus grand nombre, puisque « le tourisme concerne moins de 5 % de la population mondiale ». Malgré la faiblesse de ce chiffre, les dégâts sont immenses. La mobilité induit en effet un rapport destructeur au monde, par une standardisation déshumanisante des lieux et des rapports entre les gens. Le monde du tourisme obéit en effet aux lois du management de multinationales « peu sensibles aux modèles culturels vernaculaires ». Résultat : « Lieux de loisirs et lieux de commerce tendent toujours à se confondre, pris sous la pression de la modélisation managériale associée à la surenchère du marketing ». Le tourisme et les loisirs sont devenus une industrie dont le pouvoir d’enchantement est précisément de faire oublier son caractère industriel. « La plupart du temps, le touriste ignore la main invisible des managers des dispositifs touristiques ; cette inconscience est d’ailleurs la condition pour que fonctionne l’enchantement des lieux. »
Rodolphe Christin analyse l’articulation, dans la galerie commerciale, entre les fonctions de consommation et de déambulation. Il salue dans les œuvres de Michel Houellebecq la peinture lucidede ces êtres dépourvus de leur dimension de citoyen et réduits à des consommateurs blasés et opportunistes, profitant, comme en revanche sur son milieu, « d’un statut économique revalorisé par la différence des niveaux de vie ». Car le tourisme, surtout dans le cas du tourisme sexuel, tend à « masquer les rapports asymétriques et les contraintes, économiques notamment, qui sous-tendent et animent les relations humaines en jeu » : « les coulisses doivent rester dans l’ombre ». Par cette dissimulation s’élabore une réalité artificielle. L’enjeu du tourisme n’est plus la découverte de l’autre, mais l’échange calibré, qui a pour conséquence de mettre fin à la tradition d’accueil, « ce don coutumier » réservé à l’étranger. Là où il y avait des hôtes, il y a à présent des interlocuteurs professionnelsgarantissant un service calibré, et un monde ravalé « au rang de simple décor ». La réalité vernaculaire s’en trouve « muséographiée, folklorisée, réhabilitée ou sauvegardée, imitée même, c’est-à-dire transformée en signes standardisés renvoyant à des usages et un temps révolu. » Même la nature est enrôlée dans ce projet, tant le tourisme s’avère être « une entreprise de déracinement à des fins de conversion du réel à l’économie marchande ».
Cette virulente critique de l’homo touristicus est une invitation à reconsidérer nos rapports aux gens et aux lieux, pour restaurer des relations plus dignes et plus responsables, et retrouver ce qui donne sens à la vie et au voyage.
Par : Kenza Sefrioui
L’usure du monde, critique de la déraison touristique
Rodolphe Christin
Éditions l’Échappée, 112 p., 10 €
Plus vrai que la légende
Auteur : Kathy Kriger
Kathy Kriger témoigne du parcours du combattant qui a été le sien pour donner une existence réelle au Rick’s Café à Casablanca.
Il n’avait existé que dans les studios de la Warner Bros, lors du tournage du film de Michael Curtiz, Casablanca, sorti en 1942. Depuis 2004, le Rick’s Café est une réalité à Casablanca, grâce à la volonté de fer de Kathy Kriger. Cette femme d’affaires, qui avait tenu une agence de voyages avant de se lancer dans la diplomatie et a été conseillère commerciale au consulat des États-Unis à Casablanca, a en effet eu ce rêve d’ouvrir « un « vrai » Rick’s Café ». Mais du rêve à la réalité, c’est un véritable parcours du combattant qu’elle a mené avec obstination. Ce livre, d’abord écrit en anglais à destination d’un public anglophone, puis adapté en français sans épargner au lectorat marocain certaines généralités, est le témoignage brut d’une entrepreneuse aux prises avec les réalités économiques et sociales du Maroc.
Le projet, d’abord. Du film que Kathy Kriger appréciait à un projet qui a constitué pour elle une « obsession » au point de renoncer à sa carrière diplomatique, il a fallu un déclic : le choc provoqué par les attentats du 11 septembre 2001 à New York. « Je fus saisie par la peur de voir les Américains – effrayés et incertains de l’avenir, comme les réfugiés dans le café de carton-pâte – retomber dans l’intolérance et la xénophobie, puis une réaction anti-arabe engloutir cette ville que j’aime. […] L’ouverture d’un Rick’s Café pourrait peut-être rappeler aux Américains les vertus dont ils avaient su faire preuve, au cours de la Deuxième Guerre mondiale : sacrifice pour le bien général, sympathie pour l’opprimé, volonté de prendre position. » Marquée par l’esprit cosmopolite de la Casablanca des années 1940, l’ouverture d’un tel endroit était pour elle le symbole d’un vivre ensemble et du refus de l’intolérance. Les attentats de Casablanca le 16 mai 2003 l’ont renforcée dans cette vision. Autre élément du storytelling : une femme étrangère seule dans un pays arabe et musulman peut faire revivre le lieu mythique et donner une réalité à un film devenu classique qui a fait connaître la ville, et le Maroc, dans le monde entier. Cette dimension culturelle a amené Kathy Kriger a s’intéresser de près, en plus des aspects directement liés à la restauration, aux aspects esthétiques : décoration d’intérieur, ameublement, lampes, mais aussi musique.
Storytelling et pragmatisme
Puis il a fallu convaincre des investisseurs de s’associer à ce projet. Kathy Kriger rend un hommage appuyé à Driss Benhima, alors wali de Casablanca : « Il m’a appris énormément sur la façon dont les affaires se font – ou ne se font pas – au Maroc. » Ce dernier la dissuade d’installer son restaurant sur la Corniche et l’oriente vers l’Ancienne Medina, pour laquelle il a des projets de réhabilitations qu’il formule crument : « ça attirera d’autres investisseurs, et nous aurons une chance de plus de nettoyer cet endroit ». Si assez rapidement, le local est trouvé, la maison Ghattas, réunir les financements nécessaires à son acquisition, à sa rénovation et aux transformations nécessaires s’est avéré plus compliqué. « Ici, l’entrepreneuriat individuel est rare, explique Kathy Kriger, et la plupart des banques accordent leur préférence aux amis ou aux clients familiaux. En l’absence d’un sponsor au sein de la banque, autant oublier son projet ». Forte de son carnet d’adresses tissé dans les réseaux diplomatique, elle a pu approcher plusieurs personnes, mais s’est heurtée à leur indifférence, voire à leur incompréhension de la dimension artistique. Jusqu’à l’idée d’inviter ses amis à prendre des parts dans une société, nommée toujours d’après le film, The Usual Suspects. S’ensuit la question de l’enregistrement du nom « Rick’s Café » auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et des négociations pour son rachat – le nom était en effet déjà enregistré. C’est ensuite le dossier des garanties pour obtenir un prêt bancaire, du non classement de la maison pour obtenir l’autorisation d’y faire des transformations, puis celui des négociations pour en faire partir les locataires, puis encore des interlocuteurs incompétents ou de mauvaise foi à la banque, puis les sociétés de capital risque… Kathy Kriger cite une expression de ses anciens collègues pour désigner les accords qui capotent et les signatures qui ne se font jamais : « se faire couscousser ». Sic. Le livre prend du reste parfois des allures de règlement de compte.
Viennent ensuite les travaux. Si Kathy Kriger salue le travail de l’architecte Bill Willis, elle abonde surtout sur les procédés des sous-traitants, des artisans incompétents laissant le puits de lumière de la coupole centrale non étanche ou branchant l’aération des toilettes dans la prise d’air de la climatisation… et autres « vautours » en quête de bakchich. Les pages consacrées aux procédures administratives pour l’obtention de la licence d’alcool, avec tentatives d’extorsion d’argent et prétextes fallacieux, sont rocambolesques.
Enfin elle raconte la mise en route et la vie du restaurant : la recherche d’un personnel qualifié et fiable pour les différents postes : celui, stratégique, de chef, mais aussi l’équipe de cuisine, l’équipe de salle. Kathy Kriger salue le rôle décisif de Issam Chabâa, recruté comme pianiste et devenu directeur général. Là encore, c’est le récit d’aléas allant parfois jusqu’au tribunal. Droit du travail, protection sociale, négociations salariales, hygiène, éducation, relations avec les comptables plus ou moins compétents et honnêtes, ainsi qu’avec des clients indélicats… la légende s’incarne dans des aspects très concrets. Outre ce récit détaillé d’une aventure nécessitant autant de pragmatisme que de pugnacité, Kathy Kriger partage quelques recettes, ouvre son album photo, et raconte même la rançon du succès : en 2012, quelques mois avant la sortie de son livre aux Etats-Unis, elle a été approchée par un agent et un producteur pour la réalisation d’un film sur son aventure. Mais elle a refusé leur relecture, qui aurait abouti, 63 ans après Michael Curtiz, à « une tentative inepte de retour à la fiction ».
Par : Kenza Sefrioui
Le Rick’s Café, donne vie au film légendaire Casablanca
Kathy Kriger, adapté de l’anglais par Jean-Pierre Massaias et Natasha Bervoets
Senso Unico, 304 p., 280 DH
Le don comme méthode de management
Auteur : Alain Caillé et Jean-Edouard Grésy
Le don comme méthode de management
C’est un livre né d’une rencontre, celle du sociologue et économiste Alain Caillé et de l’anthropologue et juriste Jean-Edouard Grésy. Une rencontre improbable à priori mais qui a fait un livre généreux et original. C’est autour de la pensée de Marcel Mauss que se sont réunis les deux auteurs de ce livre intitulé : La révolution du don .Il y est question de donner, recevoir et rendre.
Neveu et héritier scientifique d’Emile Durkheim, Mauss publie en 1925 le texte : Essai sur le don, dans lequel il explique que dans « les sociétés archaïques, dans ce qu’on pourrait appeler
« La société première », les rapports sociaux ne reposent pas sur le contrat, le marché, le troc ou le donnant-donnant, mais «sur le don/contre-don», c’est en acceptant de donner et de se donner les uns aux autres, et donc d’entrer dans le cycle du donner, recevoir et rendre que les humains façonnent leurs sociétés, en attestant par le don qu’ils se font, se reconnaissent mutuellement et s’accordent leur confiance. ».
Contrairement donc aux idées reçues ce n’est pas seulement le commerce qui a tissé les relations humaines mais davantage le don. Le but de ce livre est d’exposer aux lecteurs/lectrices « les lois de l’efficacité organisationnelle, respectueuse de la dignité des salariés, en montrant comment elles s’étayent sur un substrat anthropologique ».
On n’a malheureusement pas l’habitude d’aborder la question du don et encore moins de la développer dans le monde du travail. Même si notre société s’est construite sur la troïka : donner, recevoir et rendre. Autour du don ont évolué les sociétés, se sont maintenues. Le don est au centre de nos vies mais encore faut-il y prêter attention ! N’est-il pas d’ailleurs au cœur de tous les sports collectifs ? L’exemple du football peut être le plus concret. « Un bon joueur, à l’avant, est celui qui fait des appels. Sans cesse en mouvement, il demande la balle. Encore faut-il que les autres la lui donnent, au lieu d’ignorer le partenaire démarqué qui a couru comme un fou afin de se mettre en état de recevoir. Après des dizaines de courses inutiles, d’appels faits en vain, il est probable que, lorsque celui-ci aura enfin le ballon, il ne sache pas le recevoir et ne le donne plus ou ne le rende pas. A son tour, il sera tenté de jouer « perso ». Et ce, d’autant plus que, comme l’équipe joue mal, qu’elle est en train de perdre et que rien ne semble pouvoir permettre d’éviter la défaite». Voici donc une métaphore que l’on pourrait transposer à toute la société et surtout au monde du travail. Si chaque individu « jouait » seul, toute la société perd la partie !
L’efficience est basée sur ce trio. Mais selon Mauss « le contre-don doit être plus important ou de plus grande valeur que le don initial ». Une équation pas toujours facile à tenir. Quel est le dosage parfait ? Comment rendre à la hauteur de ce qu’on a reçu ?
Il ne s’agit pourtant pas de tenir des comptes ou un rapport de réciprocité mais plutôt d’équilibre et de pérennité des rapports. Cet équilibre n’est pas une recherche d’égalité mais d’équité, disait Mauss. « Le don part certes d’un élan de générosité sincère où l’intention porte sur la création , l’entretien du lien et où il serait très mal vu de vouloir tirer profit ou marchander des éventuels biens qui circulent dans les dons et contre-dons »
Peut-on donner sans rien attendre en retour ?
S’il est une notion indissociable de celle du don, ce serait celle de la liberté.
« Le principe de Mauss éclaire l’énigme de la bonne volonté, l’essence de la convivialité dans les organisations. ». Les entreprises fidèles aux principes de Mausse sont celles qui font confiance à leurs employés. Des modèles se déploient un peu partout dans le monde. Chez L’Oréal par exemple, chaque nouvelle recrue se voit octroyé « quatre semaines de formation rémunérées au terme desquelles une prime de départ de 2000 dollars est offerte à ceux qui ne partagent pas la vision de l’entreprise ».
En Belgique on ne se plaint pas : on innove. On ne travaille pas : on se fait plaisir, on ne motive pas : on accorde sa confiance.
Au Brésil, (Semco) on a plutôt joué sur les privilèges. « Tous les privilèges ont été abolis afin que chacun soit traité sur pied d’égalité ». La plus belle expression du don entreprise a été résumée par Isaac Getz &Brian Carney. Il s’agit de passer de : comment motiver les gens à comment élaborer un environnement où les salariés s’automotivent.
Finalement, « il n’y a pas de one best way en matière de don et d’abonnement, et donc pas de solution miracle en terme de management , ni de recette immuable… il est possible d’atteindre une productivité avec des systèmes de répartition des tâches, de pouvoir et d’autorité extrêmement différents. En privilégiant le contrat (la négociation) aux Etats-Unis, le consensus aux Pays-Bas et l’honneur du travail en France ».
La confiance et la liberté demeurent les maîtres mots. Comme dirait Jonathan Hait dans son livre, La redécouverte de la sagesse ancienne dans la science contemporaine : « retirez-leur (les employés), leurs réseaux sociaux (facebook, Linkedin, Twitter…) et ils deviennent malheureux car ils ont compris que le bonheur n’est pas en « soi » mais entre « soi » ».
Par : Amira Géhanne Khalfallah
La révolution du don
Alain Caillé et Jean-Edouard Grésy.
Le Management repensé
Economie humaine
Le seuil
249 pages.
238 dirhams.
Pour repenser l’universel
Auteur : Kenza Sefrioui
Le dernier essai de Sophie Bessis montre que le tout marchand comme le fondamentalisme religieux sont deux versions d’une même idéologie reposant sur la haine de l’individu.
Ce sont deux images présentées comme opposées. « D’un côté, Prométhée s’est placé au service de Mercure, dieu du commerce et des voleurs, pour asseoir le règne d’une dictature marchande mondialement vendue sous l’étiquette de civilisation technique. De l’autre, en écho plutôt qu’en réponse, les troupes du Dieu unique, qui ordonne et punit, veulent replacer le monde sous sa coupe. » Pour l’historienne tunisienne Sophie Bessis, il n’en est rien. « Les deux tiennent en horreur cet individu libre forgé par la modernité, capable de s’agréger en collectif politique. Le marché lui préfère un individualiste solitaire et glouton prêt à suivre à la lettre son injonction à la consommation. Le gouvernement terrestre organisé autour du religieux a toujours tenté, pour sa part, de fondre la personne dans un corps organique dont il serait impossible de se déprendre ». Ce qui est en cause, c’est donc la possibilité pour l’individu de faire ses choix, d’exister en tant qu’individu – ce qui est un acquis de la modernité et de toute la pensée des Lumières.
Sophie Bessis analyse ces questions tout à fait contemporaines à travers l’expérience du monde arabe, où les débats sont d’une acuité particulière. En cause, la question de l’universel, à une époque où les discours différentialistes font florès et où « se revendique sur tous les tons et parfois dans les formes les plus virulentes un droit en quelque sorte inaliénable à la spécificité ». Or, rappelle l’auteure, la tradition n’existe plus qu’à l’état résiduel, vu les évolutions sociales, et ce terme ne désigne plus que « la nostalgie du passé » : il n’y a plus d’opposition entre tradition et modernité, mais entre « des identités reconstruites par la postmodernité » et « des aspirations trouvant leur argumentaire dans des lectures nouvelles de l’universel ». Le monde arabe, qui est le lieu d’un vif affrontement entre « défenseurs du spécifique et ceux d’une appropriation des universaux de la modernité », vit en effet dans « trois temporalités simultanées » : celle de la tradition, souvent réinventée, et servant de soubassement à des expressions politiques et sociétales ; celle de l’islam politique, idéologie postmoderne ; et celle de la modernité à laquelle aspirent des populations qui en souhaitent une autre version que celles, dévoyées, de la domination coloniale ou de la modernisation instrumentale par les régimes postcoloniaux.
Revaloriser l’individu
L’enjeu de cet essai est de définir la possibilité d’un projet d’émancipation. Or, pour Sophie Bessis, la mondialisation, qu’elle soit néolibérale ou religieuse, vise à « présenter sous un jour acceptable des servitudes d’un genre nouveau ». Fondamentalisme marchand et fondamentalisme religieux sont donc des ennemis complémentaires, qui s’affrontent mais surtout qui s’accordent sur le fait que « le destin des hommes est d’obéir à des lois indiscutables, l’une révélée par Dieu, l’autre par un dogme économique lui aussi érigé en théologie ». Dans l’un comme dans l’autre, il n’est pas question de se battre pour « une société égalitaire ou, au moins, attentive à l’humain ». Chez les évangélistes comme chez les djihadistes, pas de « prophètes des pauvres » dans un monde « où l’argent ne s’oppose pas au salut mais y contribue » : la religion est devenue un marché mondialisé. Quant à la civilisation technique, qui ne propose comme horizon qu’une « accumulation infinie de biens », elle s’oppose à quiconque réclame un partage des richesses plus juste et une gestion plus prudente.
Dans la première partie, Sophie Bessis relève le rétrécissement du champ de l’action politique et l’invasion des logiques marchandes, faisant du centre commercial « l’espace « culturel » des nouvelles couches moyennes urbaines » de Dubaï à Casablanca. Dans une passionnante deuxième partie intitulée « Révolutions et contre-révolutions », elle revient sur l’histoire complexe de la modernité dans le monde arabe, générant « une modernisation sans repères, aux références puisées dans le passé » et non « une modernité ouvrant le champ des libertés et porteuse d’un nouveau sens collectif ». L’auteure met notamment en cause l’usage de la religion comme source de légitimation, le mythe de « l’islam des Lumières » comme « modernité arabo-musulmane philosophiquement autarcique », reposant sur ce qu’Arkoun appelait une « clôture dogmatique » et réduisant la modernité occidentale non à une histoire de la pensée, mais à une évolution purement technique. Par cette synthèse sur l’impasse de la pensée contemporaine arabe, elle explique les ambiguïtés des révolutions de 2011, avec la convergence un temps des modernistes et des islamistes, puis avec les tensions entre islam national et islam mondialisé, tensions ouvrant sur le débat de la démocratisation et des libertés. « L’inachèvement du processus d’individuation se lit dans cette tension entre le désir de liberté collective et la difficulté de consentir à celle de la personne », remarque Sophie Bessis, qui éclaire cette problématique à la lumière d’un contexte complexe, « où le culturalisme postmoderne a succédé aux ambitions émancipatrices de la modernité et où le mondial a remplacé l’universel comme horizon de l’humanité ». La troisième partie du livre met en cause vertement le rôle de l’Occident, qui émet en direction du monde arabe des messages ambigus : « une assignation identitaire prenant le religieux pour seul paradigme, mais un religieux compatible avec la mondialisation, et une injonction à la démocratie se déployant à l’intérieur du cadre marchand qui en est la négation. » Néo-orientaliste dans sa propension à figer les réalités en stéréotypes, il adopte lui-même des attitudes opposées à ses principes dès que ses intérêts sont en cause, qu’il justifie au nom d’une « lecture relativiste du monde ». Or, martèle Sophie Bessis, « le regard différentialiste dit de l’Occident deux choses qu’il refuse de voir de lui-même. D’abord que, réduite au discours, privée de son versant émancipateur par le triomphe du Dieu marchand auquel tout est sacrifié, sa modernité se noie dans un monde où tout se vaut. Ensuite que, s’il n’est plus le centre du monde, alors l’universel pour lui n’existe plus, il sombre avec la puissance perdue ». Conséquences : le retour de pensées réactionnaires, visant à réprimer les femmes « une fois de plus sommées de porter à elles seules les marques de l’identité du groupe », les démocrates, les libéraux, les universalistes… tous ceux qui, refusant les « identités closes », « s’obstinent à vouloir ouvrir les prisons ». Un ouvrage essentiel.
Par Kenza Sefrioui
Emplois ou privilèges : Comment libérer le potentiel de l’emploi dans la région Mena ?
Auteur : WORLD BANK GROUP
Un rapport opportun pour comprendre les mécanismes qui empêchent l’épanouissement des économies d’une région où sont réunis trop de paradoxes. Les responsables politiques des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) répètent sans cesse, vouloir stimuler la croissance du secteur privé et créer plus d’emplois. Ce discours se trouve pourtant aux antipodes des réalités économiques de la région où des systèmes de privilèges bien installés bloquent littéralement ces options. Le rapport de la Banque mondiale est fondé sur une étude réalisée par l’une de ses équipes de chercheurs et consultants, rendu public en l’automne 2014, il analyse les facteurs de la demande qui réduisent l’accélération de la création des emplois et leur lien avec les défaillances de la compétitivité et les privilèges qui bénéficient à certaines entreprises.
Focalisé sur les pays importateurs de pétrole dans la région MENA, la plupart des analyses de ce rapport excluent les pays du Golfe et autres grands exportateurs de pétrole et de gaz. Le modèle et les politiques spécifiques qui faussent les dynamiques des entreprises et de création d’emplois dans les pays exportateurs de pétrole de la région MENA pourraient être différents. Mais La capture des privilèges des politiques par les entreprises liées aux dirigeants politiques ou aux familles princières est une source de distorsion des politiques existant à la fois dans les pays importateurs et exportateurs de pétrole dans la région MENA. Ainsi les auteurs de ce rapport estiment que les principaux résultats et les implications politiques sont pertinents pour l’ensemble de la région.
Quels types d'entreprises créent-elles plus d'emplois dans la région MENA? Sont-elles différentes de celles des autres régions du monde ? Quelles sont les politiques dans la région MENA qui empêchent le secteur privé de créer plus d'emplois? Comment ces politiques affectent-elles la création de la concurrence et de l'emploi? Comment ces politiques sont-elles associées aux privilèges bénéficiant aux entreprises politiquement connectées?
La conjoncture politique a permis à l’équipe de recherche l’accès à des données souvent inaccessibles ainsi que la collecte de témoignages et d’informations de terrain de grand intérêt. Ce rapport atteste de l’impact durable des politiques conçues pour protéger les rentes de monopole de certaines élites dans la région. Il présente une analyse des effets négatifs provoqués par les privilèges accordés aux entreprises liées aux pouvoirs politiques. Recensant les distorsions qu’elles entraînent il démontre que dans la région , une entreprise connectée politiquement dans un secteur a de 11 à 14 % plus de chances d’acquérir des terrains de la part du gouvernement par rapport aux autres entreprises , un dirigeant d’entreprise connecté politiquement réduit la moyenne du temps d’attente pour l’obtention d’un permis de construire de 51 jours et que la prévalence des inspections par les services locaux est de 20% plus élevée pour les entreprises non connectées. D’ailleurs là où s’installent les entreprises connectées les investisseurs préfèrent ne pas y aller et l’entrée est de 28% inférieur par rapport aux secteurs non connectés !
Le premier chapitre analyse les dynamiques et les facteurs déterminants de la création d’emplois dans la région MENA et compare ces caractéristiques à celles observées dans les économies en développement rapide et les pays à revenu élevé. Un premier constat est la faiblesse de la croissance de la productivité dans la région par rapport aux autres régions du monde sur toute la période de la vingtaine d’années précédente.
Le changement démographique représente environ 50 pour cent de croissance du PIB réel global par habitant au cours des 20 dernières années, lequel taux est le plus élevé du monde. La plupart des pays de la région ont fait l'expérience de changement structurel en matière d’emploi en raison d'un déclin de la part du travail agricole.
La croissance de la productivité globale a cependant été, la plupart du temps, entraînée par la croissance de la productivité à l’intérieur des secteurs, lesquels comparativement demeuraient toutefois à la traîne par rapport à d'autres régions du monde.
L’analyse des données recensées montre que la plupart des travailleurs de la région MENA sont employés dans les petites entreprises à faible productivité. Les secteurs privés des pays de la région MENA se caractérisent par de faibles chiffres d’affaires et la lente croissance de productivité. Cela s’explique par une combinaison de facteurs intra-entreprise et une mauvaise répartition du travail et du capital entre secteurs. Selon les auteurs, la mauvaise réallocation des ressources au sein des entreprises et des politiques publiques de la région , handicape le développement de la compétitivité.
Et à travers l’examen de la croissance et des performances en matière d’emploi dans ces pays et en comparaison aussi avec les pays d’Asie de l’Est, on relève que les mécanismes de création d’emplois dans la région sont identiques à ceux qui s’opèrent dans d’autres régions de la planète et que celles-ci, comme ailleurs, reposent largement sur la création d’emplois par des entreprises jeunes et productives.
Au Liban, quelque 177 % de la création nette d’emplois entre 2005 et 2010 est le fait de petites start-up alors qu’en Tunisie, celles-ci ont créé 580 000 emplois entre 1996 et 2010, soit 92 % du total de la création nette.
Toutefois le rapport constate que la place de ce type d’entreprises reste faible dans le tissu global marqué par des entreprises peu dynamiques, souvent liées aux gouvernements, avec de faibles chiffres d’affaires et de faibles taux de croissance de la productivité.
En Égypte, 71 % des entreprises liées au pouvoir contre 4 % seulement des entreprises sans relations politiques commercialisent des produits protégés par au moins trois barrières à l’importation. En Tunisie, ce sont 64 % des firmes proches du régime et seulement 36 % des autres qui opèrent dans les secteurs peu ouverts aux investissements directs étrangers. En Égypte, la croissance de l’emploi diminue d’environ 1,4 % par an lorsque ces entreprises politiquement « connectées » font leur entrée dans de nouveaux secteurs qui auparavant étaient libres de toute influence politique.
Les règles en vigueur tendent davantage à protéger les initiés bien établis qu’à encourager de nouvelles entreprises. En moyenne, 6 entreprises à responsabilité limitée sont créées par an dans la région pour 10 000 personnes en âge de travailler. Un chiffre à comparer aux résultats de 91 pays en développement (20/10 000) et, surtout, à ceux du Chili (40/10 000) et de la Bulgarie (80/10 000).
Au lieu d’occuper des emplois qualifiés et hautement productifs, à l’instar de ce que peut offrir l’industrie du logiciel, les demandeurs d’emploi relativement instruits sont contraints de gâcher leur talent dans des métiers peu productifs, où les perspectives de carrière et de rémunération sont limitées. Pénalisées par des obstacles culturels, les femmes de la région MENA affichent les taux de participation à la population active les plus faibles du monde, le rapport présente notamment le cas du Maroc à ce propos. Les résultats montrent que le changement structurel n'a pas profité de la même façon aux femmes et aux hommes. Les communications et les finances et l'immobilier comme secteurs à forte productivité ont augmenté la part de l’emploi pour les femmes et les hommes, mais le nombre de nouveaux emplois dans ces secteurs est très faible en proportion et il bénéficie principalement aux femmes et aux hommes instruits et citadins. Le fait est qu’au Maroc environ 60 pour cent des femmes de la population active travaillent dans l'agriculture -la quelle représente 39% des emplois - plus de 77 pour cent d'entre elles comme aides familiaux, et 44 pour cent à temps partiel.
Le chapitre 2 se penche sur l’influence de diverses politiques publiques mises en œuvre dans les pays de la région MENA en matière de concurrence ; il met en relief l’impact qui en découle sur le plan de la dynamique des entreprises et de l’emploi.
Ces politiques prennent des formes différentes selon les pays et les secteurs mais partagent plusieurs caractéristiques communes: Ces politiques apportent des handicaps au libre accès au marché intérieur, excluent certaines entreprises de programmes gouvernementaux, augmentent le fardeau réglementaire et des incertitudes pour les entreprises non connectées, protègent certaines entreprises et secteurs de la concurrence étrangère sur le marché local , et découragent les entreprises nationales d’aller à la concurrence sur les marchés internationaux.
Le rapport définit les entreprises gazelles au Maroc comme étant celles ayant au moins 10 employés et dont le nombre d’emplois est doublé chaque 4 années d’exercice. A ce propos, 34% de ces gazelles n’ont finalement que quatre ans d’âge, et 55 % d’entre elles ont moins de dix ans d’existence. Les Gazelles par la création nette d'emplois dans le secteur manufacturier au Maroc ont compensé les emplois détruits dans tout le secteur industriel formel. Mais la situation est assez complexe, la croissance de l'emploi est la plus forte dans les quatre à cinq premières années suivant l'entrée en activité et tend à se stabiliser par la suite. En Jordanie, les établissements de tous les secteurs économiques non agricoles doublent leur taille dans les cinq premières années de leur activité, au Maroc les entreprises industrielles sont 1,7 fois plus grande sur la même période.
Parmi les pays non membres du CCG, la Tunisie et le Maroc avaient le plus haut taux d'entrée aux secteurs économiques par habitant; l’Algérie, l'Irak, l'Egypte, la Syrie le plus bas. Les densités d'entrée dans de nombreux pays en développement à croissance rapide comme la Serbie, le Brésil, la Croatie, le Chili, et la Bulgarie sont pourtant entre deux et huit fois plus élevées qu'au Maroc et en Tunisie (les Deux pays non-GCC de la région MENA avec la plus grande entrée densités).
L’efficacité de la répartition des ressources est par ailleurs plus faible au Maroc et en Egypte qu'au Chili, la Colombie, ou l’Indonésie.
Le chapitre 3 revient sur les politiques industrielles mises en place dans la région MENA par le passé et met ces expériences en parallèle avec celles de pays d’Asie de l’Est. Les nuances se présentent comme suit : Les politiques engagées en Asie ont généralement été liées à des performances et résultats, ainsi qu’à des moyens et des systèmes d’évaluation, ce qui manque aux politiques dans la région Mena. En outre, les politiques asiatiques étaient favorables à une concurrence transparente pour tous, une égalité de chances dans l’accès aux marchés locaux et des incitations pour aller vers des marchés extérieurs.
Dans le cas marocain par exemple il cite le manque de transparence, les contraintes règlementaires, juridiques et fiscales imposées aux entreprises et dont les startups et les entreprises jeunes et productives souffrent en particulier. Ce constat se renforce à travers des comparaisons avec d’autres régions, en particulier l’Asie de l’Est et la Turquie voisine ainsi que les enquêtes de terrain parmi les entrepreneurs. Citant l’expérience marocaine et le programme émergence le rapport note l’absence de réformes administratives d’accompagnement des programmes industriels ; ainsi que la faiblesse des moyens engagés par l’Etat en comparaison avec les programmes des pays asiatiques en la matière.
Ce chapitre s’interroge sur les causes qui ont fait réussir l’expérience coréenne dont le décollage s’est effectué relativement dans des conditions similaires à celles des pays de Mena. Il semble ainsi que plusieurs facteurs ont joué en faveur de la mutation coréenne, en premier le choix de l’Etat de soutenir des activités nouvelles au niveau productif n’existant pas auparavant. Figure en second lieu le fait que le soutien était fermement lié pour tous -y compris pour les proches au pouvoir- au critère des performances à l’export. Par ailleurs l’Etat coréen a entrepris des réformes administratives et organisationnelles fermes au niveau des administrations et des secteurs public et privé pour appuyer les politiques industrielles. Enfin, autre indicateur, les grandes entreprises coréennes publiques et privées ont assisté également le secteur privé dans ces politiques. On peut résumer cela par la présence d’une volonté politique convergente chez tous les intervenants, ce qui semble faire défaut dans la région.
Le chapitre 4 explicite comment les privilèges et avantages des politiques économiques finissent par être accaparées par une minorité de bénéficiaires connectés au pouvoir politique et comment les privilèges conférés à ces entreprises aboutissent à des distorsions qui sapent la concurrence et entravent la croissance du secteur privé et des emplois dans la région MENA.
L'accès limité au financement externe réduit la croissance de la productivité parmi les entreprises manufacturières les plus grandes et âgées au Maroc.des charges administratives excessives, moins de transparence et de prévisibilité des autorités fiscales, plus d'obstacles dans le système judiciaire, et des niveaux de corruption élevés et moins de concurrence nationale réduisent les opportunités de croissance pour les jeunes petites entreprises au Maroc. La période de croissance sans emploi au cours de la dernière décennie semble liée aux contraintes rencontrées par les jeunes entreprises, ayant un potentiel de croissance élevé.
Plus de 50 pour cent des entreprises interrogées de la région Mena considèrent l'incertitude politique économique et réglementaire comme un obstacle à la croissance de leurs entreprises, et presque 35 pour cent la considèrent comme «grave» ou qualifie d’obstacle «majeur».En vérité, c’est la question de la mise en application des politiques publiques qui perturbe le plus les promoteurs, pas les politiques en elles mêmes. Et ce sont ces questions qui amènent les connections politiques ou les déploient.
Les exemples flagrants de cette situation sont apportés par les cas égyptien et tunisien.
Les privilégiés sont soustraits à la compétition à travers la mise en place de nombreuses barrières d’accès, et parmi les aspects cités pour l’ensemble de la région on trouve l’application discrétionnaire sur le terrain par les gouvernements de leurs politiques publiques en matière économique.
Concernant les effets de ces politiques on s’aperçoit que les moyennes et grandes entreprises liées au pouvoir politique et qui monopolisent les privilèges finissent par ne créer que peu d’opportunités d’emploi, alors que les petites entreprises non connectées et employant une certaine main d’œuvre productive , harcelées par les différentes barrières immigrent vers l’informel .Une analyse qualitative d’ensemble montre que les outils dissuasifs en usage sont surtout des mesures étatiques non tarifaires et la corruption qui leur est liée.
Le rapport s’achève sur la proposition d’une feuille de route pour le système de prise de décision en matière de politiques économiques ainsi que les principaux domaines et axes de réforme à inscrire au programme d’action pour le développement du secteur privé et de l’emploi dans la région MENA.
par : Bachir Znagui
L’Algérie entre retards et avancées
Auteur : Abdellatif Benachenchou
L’universitaire et chercheur Algérien, Abdellatif Benachenchou revient sur les investissements de cette dernière décennie en Algérie. Il y énumère les différentes avancées et révèle les innombrables écueils.
L’Algérie est un pays qui a la réputation d’être fermé à l’investissement. Les réputations ont la peau dure mais se vérifient souvent ! Entre lois protectionnistes et enfermement dans une économie dépassée, qu’en est-il des investissements étrangers au pays de Boutefllika ? Quelles entreprises osent s’aventurer dans ce pays aux lois austères ?
C’est à ces questions qu’essaye de répondre l’universitaire et chercheur Abdellatif Benachenchou dans son essai : Les nouveaux investisseurs.
Les réponses sont du moins, inattendues. Contre toute attente, l’Algérie semble renaître de ses cendres et on sent un air de renouveau malgré un coma économique apparent !
Aujourd’hui, et sans surprise aucune, le secteur des hydrocarbures reste le plus attractif. La reprise de 2004 semble avoir donné un coup de fouet à l’économie notamment grâce à l’installation du norvégien Statoil et de l’espagnol Repsol.
Des projets structurants sont en route (malgré les innombrables scandales de la Sonatrach : société nationale des hydrocarbures)
Parmi les grandes réalisations de l’énergie : le gazoduc Medgaz, qui reliera Béni Saf à Almeria en Espagne pour transporter « 8 milliards de mètres cubes par an, avec une extension à 16 milliards dans un second temps ». Le partenariat avec l’Espagne semble prendre un nouvel essor et ne se limite pas aux hydrocarbures. Un consortium algéro-espagnol a été également mis en place dans le domaine du dessalement des eaux (le groupe Enima Aqualia a décroché le contrat de réalisation de l’usine de Mostaganem d’une capacité de 100 000 mètres cubes, la société Ridesa associé au Canadien SNC Lavalin, va quant à elle construire l’usine de dessalement de Zéralda).
De toute évidence, des projets structurants pour l’Algérie sont en train d’être pris en charge par les Espagnols. La péninsule ibérique est en phase de devenir un partenaire privilégié pour le pays.
L’Algérie semble sortir d’une longue hibernation, après des années de terrorisme où des pans entiers de l’économie ont été mis à terre, il devient urgent de développer aujourd’hui les autres secteurs : banques, médicaments, ciment, électricité ports, etc…
Selon Benachenchou « la poursuite de l’ouverture économique pour attirer des investisseurs performants et une bonne régulation sont les seuls moyens de lutte durable contre la pauvreté et la croissance de l’emploi : l’efficacité de la politique économique et sociale ne dépend pas de la taille du secteur public mais de l’attractivité de l’économie et des performances des entreprises ».
Des lois en évolution, des marchés à prendre
La percée chinoise en Algérie est devenue un cas d’école. « En 2005 alors que La Chine se hisse à la 4ème place de fournisseurs, elle s’empare de 6,2% de parts du marché contre 5% en 2004 », détrônant ainsi les Etats-Unis pourtant partenaire bien implanté au pays.
Aujourd’hui le pays du soleil couchant se positionne sur le marché des hydrocarbures, s’est emparé du celui des travaux publics et d’équipements, et grignote, également, une bonne part du secteur des télécommunications. L’Empire du milieu semble avoir retrouvé tout son panache au cœur du Maghreb.
Par ailleurs, Benachenchou nous apprend que la banque marocaine Attijari Wafa Bank se dit prête à investir « 100 millions d’Euros en Algérie. Attijari Wafa Bank attend maintenant des autorités algériennes la réponse aux demandes d’agrément qu’elle a déposées pour la création de trois entités ». Benachenchou parle également d’implantation de la BMCE qui a présenté une demande d’agrément.
Une affaire à suivre de près…
Mais que se passe-t-il pour les investisseurs locaux ? S’il est un exemple à suivre et à étudier, ce serait sans aucun doute celui de Cevital, une PME devenue un empire industriel.
Pour satisfaire les besoins de croissance Cevital, la banque d’Algérie a mis en place (récemment), une loi qui permet le financement à partir de l’Algérie des opérations extérieures d’entreprises algériennes ! Une première dans ce pays aux lois protectionnistes tant de fois décriées.
Dans cette Algérie qui se dit prête à l’ouverture, tout n’est pourtant pas rose. L’auteur énumère également les innombrables dysfonctionnements et les manques à gagner.
Il pointe du doigt le sous développement du tourisme qui demeure un grand handicap pour le développement du pays.
Pourtant, l’Algérie pourrait profiter de niches touristiques telles le tourisme thermal (le pays dispose de 202 sources), le tourisme d’affaires, les déplacements religieux (l’Algérie compte quelques lieux saints pour les chrétiens : tombeau de Saint-Augustin, le père Foucault (18 000 visiteurs en 2005), le pèlerinage des Tijani (Laghouat) etc…)
La faiblesse de la capacité hôtelière en constitue le principal écueil. Pou y remédier quelques projets phares sont en route. Le Saoudien Sedar compte construire des complexes touristiques d’une capacité de 20 000 lits à l’Ouest d’Alger. Le groupe touristique Accord a, par ailleurs, un projet de construction de 36 hôtels dans différentes régions du pays. Les Allemands comptent s’emparer de la zone d’Al Qala (frontière tunisienne) et les Américains la région de Jijel. (à 350 Km à l’est d’Alger)…
Chacun semble vouloir sa part du gâteau. Malheureusement, ces projets ne font partie d’aucune stratégie structurante et trainent depuis pas mal d’années…
Par Amira-Géhanne Khalfallah
XXIème siècle, et encore « primates sociaux »
Auteur : Paul Seabright
Paul Seabright analyse les rapports entre hommes et femmes à la lumière de l’évolution de l’espèce depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours.
Elles n’auraient d’yeux que pour leur porte-monnaie, ils ne s’intéresseraient qu’à leurs formes voluptueuses. C’est sur le récit d’un malentendu sentimental de ce genre que le philosophe et économiste britannique Paul Seabright entame son essai. Sauf que, contre toute attente, il ne s’agit pas ici d’humains, mais de mouches. L’auteur prend un malin plaisir à entretenir la confusion sur une page et demi, avant de révéler le pot aux roses. Mouches ou homo sapiens sapiens, « mâles et femelles utilisent tous deux des stratégies économiques à des fins sexuelles ». Certes, d’une façon qui varie selon le sexe et l’époque. Mais « depuis la nuit des temps » a lieu une « négociation systématique de biens économiques – l’argent, la nourriture par exemple – ou de ressources non monétaires comme le temps, l’effort ou l’estime de soi ». C’est donc à la lumière de l’économie que Paul Seabright propose de relire, à travers l’histoire, les relations entre les sexes. Ce brillant petit livre plein d’humour, fait appel aux ressources de la biologie, de l’anthropologie, de la psychologie et bien sûr de l’histoire. « Les mouches mâles accaparent la nourriture non pas pour la manger mais pour mieux contrôler le choix sexuel des femelles. De la même façon, les hommes thésaurisent les ressources économiques pour pouvoir faire pression sur les choix des femmes. Comme pour les mouches, les points les plus sensibles des relations économiques entre hommes et femmes concernent moins ce qu’ils consomment que ce qu’ils contrôlent ». S’ensuit une démonstration par la mouche, la punaise, l’éléphant de mer, le paon, le lion, le chimpanzé et autres bonobos, au terme de laquelle Paul Seabright admet que l’espèce humaine se distingue par la « forme particulièrement complexe » de ce conflit entre hommes et femmes, en raison de la dépendance extrême du nouveau-né humain, qui implique que son arrivée déclenche tout un réseau d’alliances entre les acteurs concernés. À l’origine, le rapport entre abondance (des mâles, des spermatozoïdes) et rareté (des femelles, des ovules), qui a façonné tout au long du « tunnel évolutif », la sexualité humaine. Mais le propos de Paul Seabright n’est pas de se livrer à un exercice de sexologie comparée. Pour lui, pour parvenir à dépasser les inégalités entre hommes et femmes, il est indispensable de « comprendre les traces psychologiques laissées par le tunnel ».
Les séquelles de l’évolution
Autant le dire tout de suite : malgré les conquêtes, le cerveau de l’homo sapiens sapiens est toujours configuré pour les besoins du chasseur-cueilleur de la Préhistoire, car le cerveau évolue plus lentement que les mœurs et les représentations sociales. Le lecteur doit faire abstraction de son amour-propre pour comprendre la démonstration.
Le livre est organisé en deux parties. La première retrace l’histoire de la reproduction sexuée et des stratégies, des rôles et des politiques propres aux genres. Paul Seabright étudie, avec un regard acéré, l’économie des relations qui définissent cet « héritage biologique ». « Sexe et techniques de vente » énumère ainsi l’art des signaux et des processus de séduction, voire de manipulation, car « le sexe a besoin de publicité ». « Séduction et émotions » analyse le rapport entre l’émotion et le simple calcul rationnel pour la reconnaissance sexuelle : il y est question de séduction et de soupçons, de Darwin, bien sûr, et du Rouge et le Noir de Stendhal. Puis Paul Seabright nous assène, en troisième chapitre, que nous sommes encore des « Primates sociaux » : il évalue l’héritage des primates, mais aussi ce qui nous en distingue : volume du cerveau, allongement de la durée de l’enfance, donc division du travail.
Dans la deuxième partie, Paul Seabright nous transporte aujourd’hui, et interroge l’empreinte des comportements archaïques dans nos sociétés modernes. Sa réflexion part du constat que, malgré les avancées considérables concernant la participation des femmes à divers secteurs de la vie économique et sociale dans les sociétés industrialisées, leurs revenus stagnent toujours autour de 80 % de ceux des hommes et que les hommes occupent toujours la plupart des postes de pouvoir. Dans « A la recherche du talent » et « Que veulent les femmes ? », il se penche sur la disparité des talents et des motivations entre hommes et femmes – aucune ne justifiant cependant la sous-représentation des dernières à des postes de pouvoirs ni leur assignation à un rôle – toute recherche de lecture essentialiste est ici vouée à l’échec. Dans « Conjonctions d’intérêts », l’auteur analyse le fonctionnement des réseaux : « Alors que les réseaux des hommes leur donnent accès à des postes de pouvoir économique, ceux des femmes n’ont pas les mêmes effets ». Le chapitre suivant, joliment intitulé « Un charme rare », s’intéresse aux modalités de coopération humaine, et notamment aux risques de « ne pas pouvoir coopérer avec ceux dont nous valorisons le plus la collaboration ». Paul Seabright établit justement un parallèle entre l’exclusion des femmes aux postes de pouvoir économique et la surreprésentation des hommes parmi les marginalisés (chômeurs, sans-abris, détenus). « Si la biologie peut parfois nous donner l’impression que nous sommes victimes de notre héritage, l’économie montre que nous pouvons adapter cet héritage pour façonner notre avenir », conclut-il, avec un certain optimisme. Et d’appeler à l’invention de nouveaux modèles, reposant sur une meilleure coopération et une plus grande justice : « Hommes et femmes peuvent donner plus de poids à leurs responsabilités domestiques lorsque le coût pour leur carrière est moindre. […] Le sexe libéré de la dépendance économique est souvent meilleur, l’économie libérée de la dépendance au sexe sera probablement meilleure aussi ». Un ouvrage stimulant, qui évoque la question du genre avec beaucoup de subtilité, sans tomber dans les stéréotypes.
Par Kenza Sefrioui
Hold up sur la démocratie
Auteur : Susan George
Susan George alerte sur les agissements de lobbyistes bataillant dans l’ombre pour les intérêts du secteur privé. Au détriment de l’intérêt général et du bien commun.
« Bill Clinton, à bord du Boeing présidentiel Air Force One, confie à des journalistes qu’il est plongé dans la lecture d’un ouvrage passionnant, Global Dreams[1], qui montre comment une poignée d’entreprises transnationales ont pris le contrôle du monde. À un journaliste qui lui demande ce qu’il a l’intention de faire à ce propos, Clinton répond : « Moi, rien. Que voulez-vous que je fasse ? Je ne suis que le président des Etats-Unis. Je ne peux rien à propos des grandes entreprises. » Sur le mode de l’autodérision, ou en reconnaissant ce fait, le président des États-Unis avoue son impuissance. Or, si le chef du gouvernement du pays le plus riche et le plus puissant du monde se trouve démuni face aux ETN [Entreprises transnationales], qu’en est-il des hommes politiques moins influents ? » Cette question de fond a lancé l’universitaire franco-américaine Susan George dans la rédaction de ce livre, une enquête à charge contre les attaques des lobbyistes à la solde de grandes entreprises privées contre les États et les organisations internationales. Après plusieurs essais à grand succès, dont Comment meurt l’autre moitié du monde (1976) et Leurs crises, nos solutions (2010), la présidente d’honneur d’Attac-France se penche sur un nouvel aspect des effets dévastateurs de la mondialisation capitaliste. Cette fois-ci, elle s’intéresse à ces individus et entreprises « qui n’ont pas été élus, qui ne rendent de comptes à personne et dont le seul objectif est d’amasser des bénéfices » et dont l’action tend à « orienter la politique officielle, qu’il s’agisse de santé publique, d’agroalimentaire, d’impôts, de finance ou de commerce ». Groupes de lobbying, soi-disant « comités d’experts » ou autres organes créés de toute pièce sont à l’origine d’une mutation politique, notamment en Amérique du Nord et en Europe, en s’arrogeant un « statut quasi officiel » et faisant émerger ainsi une autorité illégitime, que Susan George qualifie de « corporatocratie ». « Le gouvernement au sens où on l’entendant habituellement, celui qui est dirigé par des responsables clairement identifiables et élus démocratiquement, se trouve aujourd’hui affaibli, voire supplanté par des crypto-gouvernements auxquels la classe politique a fait des concessions délibérées, forcées, ou tout simplement irréfléchies ».
« Autorités illégitimes »
Dans un premier chapitre, Susan George rappelle l’horizon démocratique défini par le modèle des Lumières, sa philosophie de la représentation, sa protection des droits et libertés individuelles et collectives – modèle menacé par le néolibéralisme, dont la doctrine et l’application ont montré qu’il ne défendait que les intérêts des puissants et se sont avérés « préjudiciables à l’immense majorité d’entre nous ». Susan George s’attelle ensuite au fonctionnement des lobbies et méga-lobbies. Abondamment documenté, ce livre ouvre au lecteur les coulisses des négociations ayant trait à l’industrie agroalimentaire, à l’industrie pharmaceutique, à l’environnement ou encore aux traités de libre échange, qu’elles prennent place à Washington, Bruxelles, Davos, etc. Non sans un humour grinçant, Susan George brosse un portrait du parfait lobbyiste et en dévoile la panoplie de techniques et d’arguments : discrétion, temporisation, et art d’énoncer des contrevérités, du moins d’instiller le doute : « Si vous représentez les intérêts de l’industrie du tabac, des boissons alcoolisées, des produits chimiques ou des industries polluantes, vous devez apprendre à ignorer et à déformer la science. » Elle attire également l’attention sur le rôle, identique mais moins connu, d’organisations sectorielles « de plus en plus nombreuses à représenter les intérêts de vastes secteurs industriels » : instituts, centres, fondations, conseils… basés à Bruxelles ou Washington, financées par les entreprises qui ont besoin de ces vitrines. Susan George pointe d’ailleurs du doigt le système de « porte tambour » entre ces structures et le pouvoir politique, permettant « aux hauts fonctionnaires d’une agence réglementaire, de la Commission ou du Parlement [européens] d’être recrutés par le secteur privé, ou inversement », créant d’évidentes situations de conflits d’intérêts. Les activités de ces personnes et structures portent essentiellement sur la définition des normes comptables et fiscales, sur le marketing du tabac et de l’alcool, sur le climat, pour dicter des lois conformes à leurs intérêts. Susan George se penche particulièrement sur les traités internationaux et alerte sur le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre les États-Unis et l’Europe, préparé dès 1995 par le Dialogue commercial transatlantique et ce slogan qui se passe de commentaire : « «Approuvé une fois, accepté partout ». Traduisez : « Si nous, les ETN de part et d’autre de l’Atlantique, donnons notre feu vert, le reste du monde n’a plus qu’à suivre. » » Au terme d’une enquête rigoureuse, elle traque l’opacité entourant la composition des groupes de travail, réexplique les enjeux globaux : principe de précaution, normes et droit du travail, et surtout souveraineté et respect des institutions. Et de s’indigner d’une négociation visant à établir des exceptions pour la santé, pour l’environnement, pour la culture, etc. « La seule option décente serait de quitter la table des négociations, de refermer poliment la porte derrière nous et d’appliquer la politique de la chaise vide ». Susan George attire enfin l’attention sur l’Initiative de restructuration mondiale, lancée par le Forum économique mondial de 2009, visant à « opérer une fusion entre les Nations Unies et les transnationales, avec la participation éventuelle de quelques figurants issus de la société civile », c’est-à-dire à « confier aux renards la charge du poulailler ». En exergue de cet ouvrage d’utilité publique, cette éloquente citation de Tonny Benn lors de son discours d’adieu au Parlement britannique : « Au fil des ans, j’ai mis au point cinq questions démocratiques [à poser à une personne influente] : « De quel pouvoir êtes-vous investi ? Par qui ? Dans quel intérêt l’exercez-vous ? À qui êtes-vous tenu de rendre des comptes ? Et comment faire pour se débarrasser de vous ? » S’il n’est pas possible de se débarrasser de ceux qui nous gouvernent, c’est qu’il ne s’agit pas d’un régime démocratique ». CQFD.
Par Kenza Sefrioui
[1] Global Dreams. Imperial Corporation and the New World Order, Richard Barnet et John Cavanagh, New York, Simon & Schuster, 1994.
Des terroristes en quête de territoires
Auteur : Alexandre Adler
Les noms changent mais l’horreur est la même : GIA, AIS, Al-Qaëda, AQMI, DAESH (ISIS), Boko Haram… ont tous commis des meurtres ou commandité des assassinats au nom de Dieu.
Sous ces noms différents, une même idéologie a semé la terreur, justifiant, viols, assassinats, déplacements de populations… Dans son livre, Le Califat du sang, le journaliste Alexandre Adler, nous fait voyager du Maghreb à l’ Orient, d’Afrique du Nord jusqu’en Afrique Centrale pour suivre ces fous de Dieu.
Pour commencer il nous conduit à la genèse d’Al-Qaëda qui, nous révèle-t-il, est d’inspiration …. marxiste. Aussi incroyable que cela puisse être : «Son père fondateur, Abdullah Azzam, était un universitaire d’origine palestino-jordanienne qui enseignait dans l’université la plus prestigieuse d’Arabie-saoudite. Sa réflexion portait sur la transposition du marxisme à l’islam politique de manière à féconder celui-ci. Il affirmait qui la doctrine marxiste, qui était fausse dans son principe puisqu’elle niait Dieu, avait malgré tout élaboré des solutions pratiques et techniques dont tout mouvement d’émancipation devait s’inspirer ».
Mais le mouvement et l’idéologie d’Azzam sont vite récupérés par un radicaliste devenu célèbre : Oussama Ben Laden. Ce dernier commence sa propagande en aidant les pauvres, en construisant des autoroutes ... Au Soudan, le cheikh est vénéré. Ils est synonyme de bienveillance et accède au statut de grand sage.
Forte de ses nombreux adeptes, Al-Quëda essaye de s’installer au Soudan, au Tchad et au Centre-Afrique. Elle y trouvera sa plus belle expression en Afghanistan grâce à l’aide et la complicité de l’armée pakistanaise. Aussi, l’Arabie Saoudite et sa complicité lui ont fait le plus grand bien. Mais le royaume des Al-Saoud se retira après le 11 septembre, Al-Qaëda échappant à leur contrôle. « C’est le moment où Al-Qaëda rompt le cordon ombilical avec l’Islam conservateur saoudien et du golf persique, qui, non sans une certaine inquiétude, l’avait accompagné dans son mouvement ascendant ».
Mais on parle de moins en moins aujourd’hui de ces terroristes qui ont accompagné notre quotidien pendant de longues années. Al-Qaëda a été affaiblie. L’arrivée, d’autres « méchants » sur la scène médiatique l’a éclipsé. Aujourd’hui, Daesh effraie, défraie la chronique avec son drapeau noir et ses avancées spectaculaires.
Les rêves d’expansion du Califat sont bien plus précis: l’Etat Islamique en Irak et au Levant, l’a bien compris, il faut territorialiser le djihad et instaurer la Califat perdu en 1923 (à cause de Mustapha Kemal Atatürk).
Le califat tant souhaité par Ben Laden, sera-t-il finalement réalisé par Al-Baghdadi ? Rien n’es moins sûr !
L’Afrique et la route du pèlerinage
A l’heure où l’on se sent cerné de toutes parts par le terrorisme, Adler ose affirmer pourtant : « Jamais les islamistes n'ont été aussi faibles à l'échelle de l'Orient islamique. On est en train d'assister aux spasmes d'un mouvement entraîné dans une décadence irrémédiable ». Toujours selon l’auteur de cet essai, si les Daesh entrent dans l’Irak chiite ils se feront massacrer. Et pour cause, l’Iran fait aujourd’hui écran à Daesh et les Etats-Unis ont tout intérêt à composer avec. On en voit déjà les prémices et les négociations du nucléaire iranien vont bon train depuis quelques temps. L’ennemi d’hier devient l’allié d’aujourd’hui. L’Iran tire profit du conflit et va entrer par la grande porte, après des années d’embargo, dans la communauté internationale !
Au Maghreb, Al-Qaëda a récupéré une fraction de l’AIS en Algérie. Aqmi est né avec cette même idée de territoire en s’alliant à des anciens de la branche armée du FIS. Ces dissidents qui ont œuvré sous l’emblème du GIA ont refusé la réconciliation nationale prônée par le président algérien Bouteflika. Aujourd’hui Aqmi, continue de manœuvrer –à plus faible échelle- en Algérie et revendique toujours des assassinats dans le pays.
L’Afrique n’est pas en reste et les nombreux conflits qui secouent la terre-mère portent l’étendard du religieux. Mais toutes les tueries et les massacres que nous vivons aujourd’hui, trouvent leurs origines dans des politiques mises en place depuis de nombreuses années.
Le dictateur lybien Kaddafi dans ses délires hégémoniques avait, par exemple, entrainé des groupes Touaregs et a formé les cadres du « mouvement de libération de l’Azwad ». Ce mouvement est composé essentiellement de Touareg maliens. Par ailleurs, « Un certain nombre de pouvoirs et de personnalités du Moyen-Orient donnent de l’argent à Aqmi, afin de soutenir l’aile radicale du mouvement de l’Azwad. C’est ainsi qu’Ag-Ghali, fort du soutien politique et militaire qui lui est accordé, ouvre les portes de ce territoire malien du Nord en train de se décomposer, à des djihadistes venus de toute la région ».
Cette pénétration africaine de mouvements islamistes radicaux soutenus par les pays du Moyen Orient n’est qu’un premier opus. Très vite Le Boko Haram (l’instruction occidentale est impie), arrive à la rescousse. Le Califat africain est en marche. Selon l’auteur, le mal du Nigéria vient de la disparition de l’animisme africain. Dans les années 50 l’Islam et le christianisme étaient des religions assez minoritaires dans la région. Mais des campagnes de prosélytismes soutenues ont laissé progresser des formes agressives des deux religions monothéistes donnant naissance à des mouvements radicaux comme le Boko Haram qui actuellement « possède ses bases vitales dans le Nord-Est du Nigéria, lesquels mordent sur le Cameroun voisin et sur le Tchad, zones qui permettent d’accéder à la route de pèlerinage, vers la Soudan d’abord, puis vers La Mecque ensuite » mais les voies du Boko Haram restent, malheureusement, impénétrables…
Par : Amira Géhanne Khalfallah
Le califat du sang
Alexandre Adler
Grasset
125 pages . 176 DH