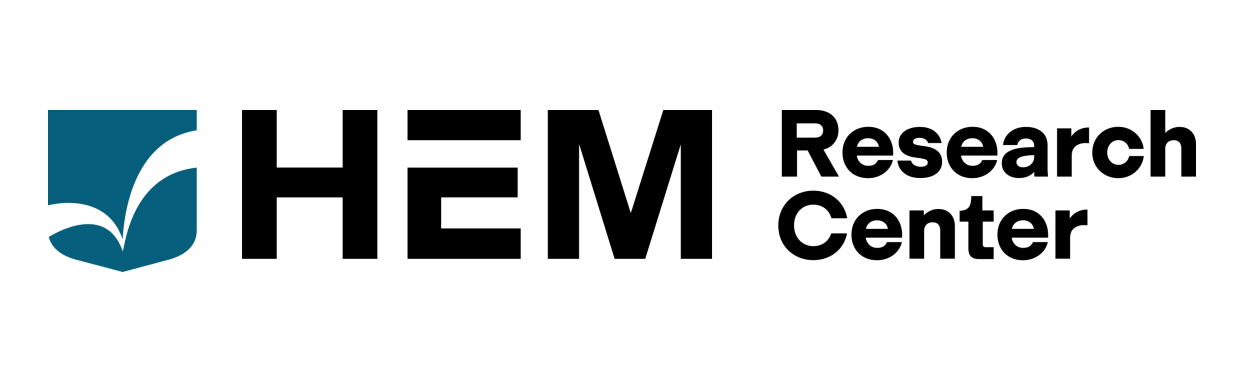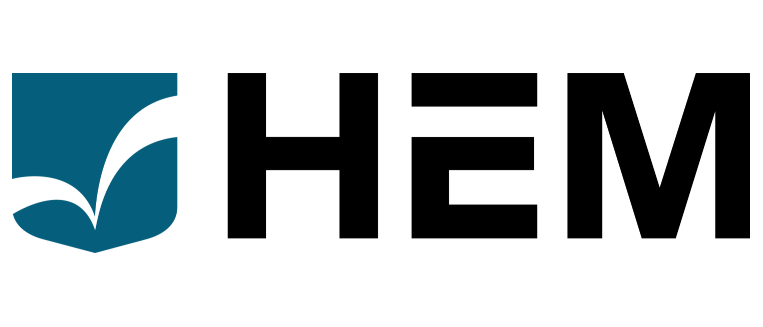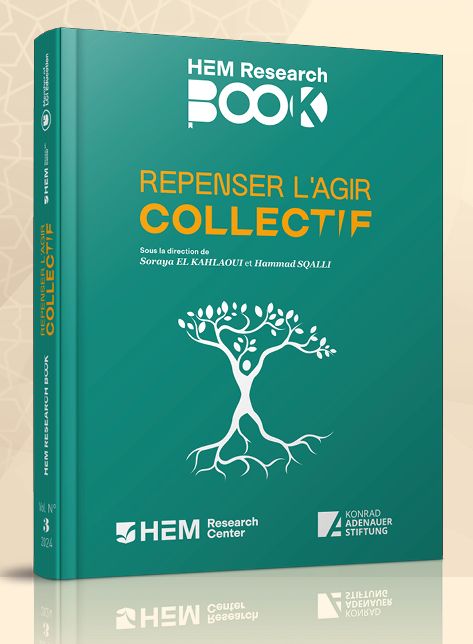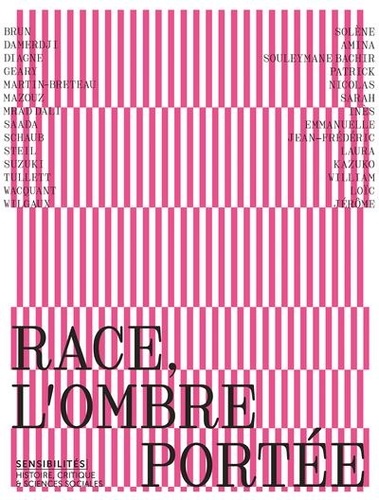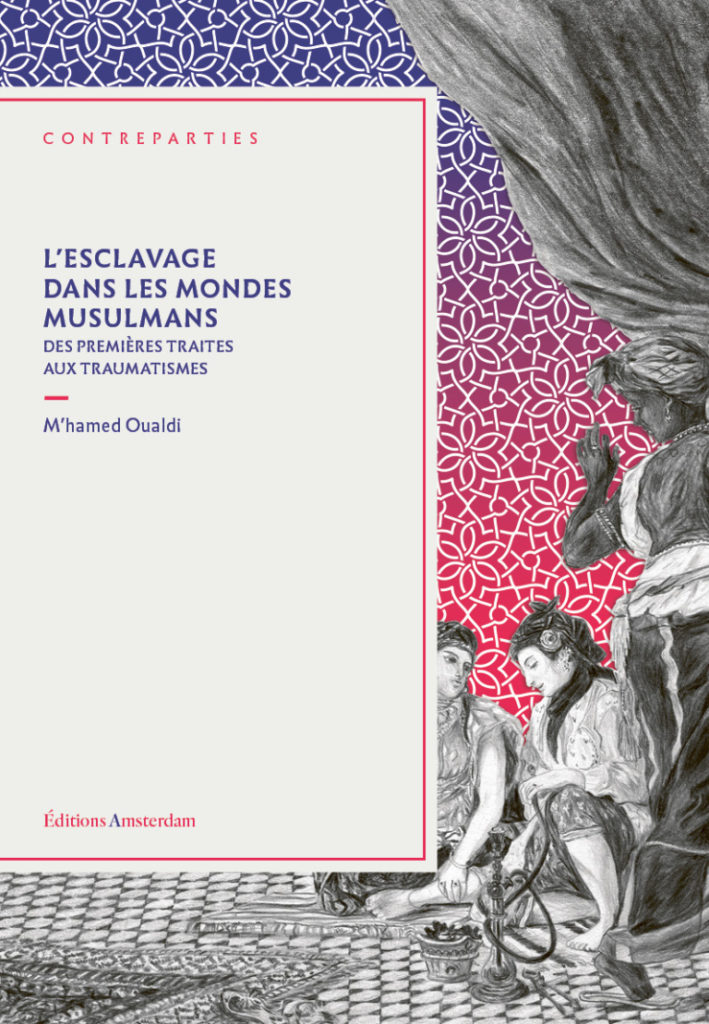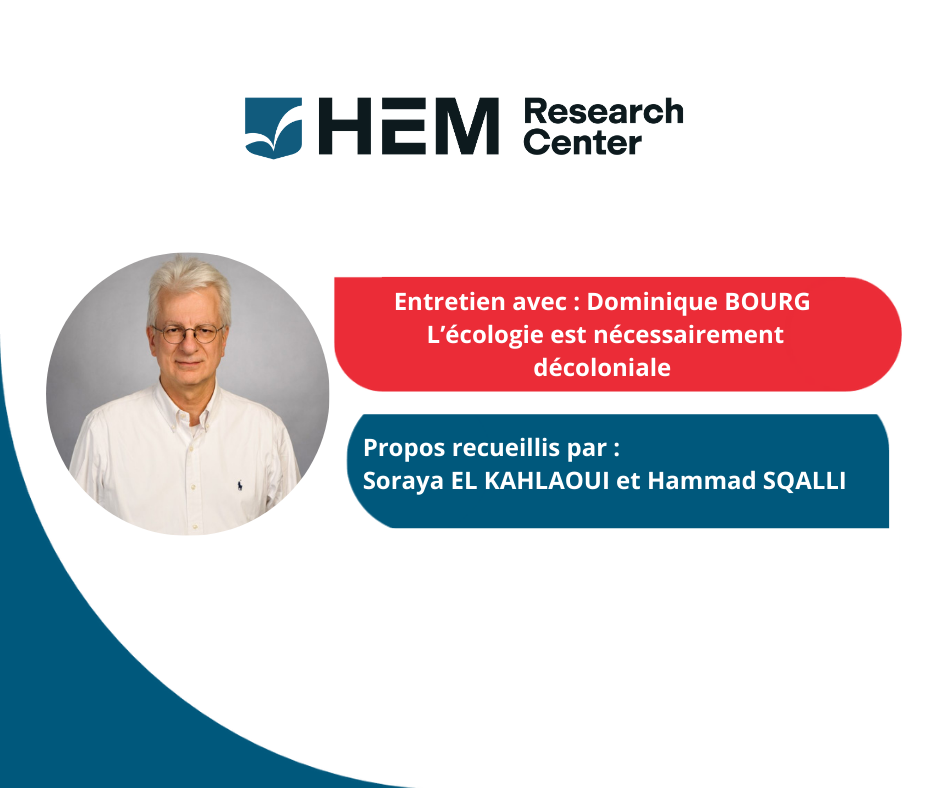
Entretien avec : Dominique BOURG L’écologie est nécessairement décoloniale
Cet entretien avec le philosophe et militant écologique Dominique Bourg s’inscrit parmi les éléments de contextualisation de la question du collectif, thème principal de cet ouvrage. Nous y trouvons, formulé en survol des interrogations majeures soulevées par la notion et le concept de l’Anthropocène – phase incontournable de notre ère géologique, succédant à l’Holocène –, le voeu d’un avenir meilleur pour l’humanité, fondé sur un collectif responsable et en phase avec la nature.
HEM Research Book : Repenser l’agir collectif
Numero : 3
HEM Research Center, en partenariat avec la Fondation Konrad-Adenauer, est heureux d'annoncer la sortie de la 3ème édition de HEM Research Book, intitulé "Repenser l’agir collectif".
HEM Research Book que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton ci-après.
Revues Sensibilités n°12 – Race, l’ombre portée
Auteur :
Le dernier numéro de la revue Sensibilités, invite à penser la manière dont les systèmes de domination élaborent la notion de race.
Le numéro 12 de la très belle revue annuelle Sensibilités se penche sur la « Race, l’ombre portée » et revient sur la « construction historique, politique et sociale dont le contenu varie précisément selon les contextes sociaux ». Dans l’éditorial, la sociologue Sarah Mazouz explique l’usage du mot au singulier « parce qu’il désigne par là un rapport de pouvoir » et qu’il s’agit d’en étudier, selon les mots de Césaire, « l’ombre portée » pour en « souligner la persistance et le caractère diffus des effets de la race ». Au cœur du numéro, les rapports entre race et corps « à des fins de des-essentialisation et de dénaturalisation », en s’interrogeant sur ce qui contribue à faire passer ces éléments pour naturels. « Travailler de manière critique sur la race, c’est donc montrer que la race est un rapport de pouvoir abstrait créant également une condition sociale ». Donc les marqueurs corporels découlent (et ne préexistent pas) « aux logiques de racialisation ».
Dans la première partie de la revue, consacrée aux travaux de recherche, la sociologue Solène Brun étudie « l’adoption comme trajectoire corporelle » : elle montre comment l’apparence et les différences physiques entre enfants non-blancs et parents blancs sont traitées, en se focalisant notamment sur la question du soin aux cheveux – dont la coupe imposée, quand ils sont crépus, est perçue comme un abus. Nicolas Martin-Breteau revient sur la publication, à la une du magazine africain-américain The Messenger, en mai 1923, du Penseur de Rodin en homme noir, sous le titre de « New Negro ». Pour l’historien, il s’agit d’une « résistance corporelle, à la fois physique et vigoureuse, à ce qu’on n’appelait pas encore le racisme » : le combat pour l’égalité, la dignité et la justice passe d’abord par le corps, en proposant une autre représentation que l’imagerie raciste. Cependant, demeure la question de l’efficacité de cette démarche de subversion des références culturelles majoritaires : « On ne démolira jamais la maison du maître avec les outils du maître », selon les mots de la poétesse Audre Lorde. L’historienne et anthropologue Inès Mrad Dali revient, elle, sur la « racisation en Tunisie au XIXème siècle » et sur les catégories de noirs et de blancs, en soulignant « la présence d’une multitude d’identités et donc d’identifications comme Noir » : elle fait l’inventaire des paramètres qui contribue à la construction de « cet enchevêtrement identitaire » mouvant, et conclut : « Il est improductif voire absurde d’essayer de situer des origines – qui plus est culturelles – au racisme ». L’historien des mondes américains Jean-Frédéric Schaub, étudiant « la pureté de sang à l’âge moderne » dans les redoutables écrits de l’Inquisition, insiste sur la primauté des études empiriques des politiques de ségrégation sur l’étude des théories raciales. Enfin, l’historien Jérôme Wilgaux, lui, s’intéresse à la description, à la hiérarchisation et à la stigmatisation des corps et des peuples en Grèce ancienne, afin de marquer « les “infâmes” au sein même des communautés ». Son florilège, qui montre le lien fait entre traits physiques et qualités morales est édifiant.
Approche multidisciplinaire
Dans la partie Expérience, une partie dédiée à des formes expérimentales d’écriture ou à la présentation de texte oubliés, Sarah Mazouz note, croquis à l’appui, comment se construit un discours de racialisation des pieds plats en danse classique. Dans « Délires », l’anthropologue Laura Steil décrit le caractère politique des « soirées afro » en racontant comment, dans ces moments festifs (les « délires ») partagés par de jeunes Français noirs, ces derniers retournent l’expérience racialisante et stigmatisante en un élément valorisant. L’historien William Tullet interroge, lui, les préjugés antisémites à travers « le racisme olfactif », tandis que le sociologue Kazuko Suzuki montre comment au Japon la race se construit « sur de l’invisible », à travers le cas des Coréens Zainichi. Enfin, l’écrivaine Amina Damerdji revient sur l’amour hors cases de ses grands-parents en contexte colonial, entre l’Algérie et la France : « Si je vous dressais leur portrait séparément vous ne donneriez aucune chance à leur couple. Et pourtant ils se sont aimés pendant soixante-dix ans. » Une belle et touchante mise en cause de l’absurdité des cases.
La partie Dispute se focalise ensuite sur le débat sur la race aux États-Unis. Trois articles, traduits de l’anglais, en éclairent différents aspects. Il y a d’abord celui de l’historien Patrick Geary sur les travaux en paléogénomique, qui « mettent en lumière les migrations et mélanges et parviennent ainsi à contrer toute tentative de réification des identités culturelles ». Puis l’historienne Emmanuelle Saada s’intéresse à la race comme catégorie d’analyse complexe, « à cerner dans sa dimension processuelle de racialisation ». Quant au sociologue Loïc Wacquant, ses travaux portent sur le lien entre race et ethnicité : la race constitue pour lui le « sous-type et négation de l’ethnicité », puisqu’« il s’agit là d’une “forme d’ethnicité qui s’enveloppe dans le manteau de la nature tout en révélant son enracinement historique dans cette dissimulation même.” »
La dernière partie de la revue, « Comment ça s’écrit ? », espace d’introspection, accueille un beau texte de Soulaymane Bachir Diagne, qui s’interroge non sans humour sur la portée de la question : « Comment ça s’écrit une autobiographie, c’est-à-dire comment ne pas se prendre au sérieux dans le projet de se peindre et garder avec la matière qui est soi-même la distance que permet l’humour. »
Un numéro profond, qui apporte, à travers des approches multiples et richement documentées, un éclairage précieux sur une question qui continue d’empoisonner notre vie sociale et politique.
Kenza Sefrioui
Revues Sensibilités n°12 – Race, l’ombre portée
Collectif
Anamosa, 160 p., 23 €
L’esclavage dans les mondes musulmans, des premières traites aux traumatismes
Auteur : M’hamed Oualdi
Pour repenser l’esclavage
L’essai remarquable de l’historien M’hamed Oualdi invite à repenser les cadres conceptuels de l’esclavage dans les mondes musulmans.
C’est à un profond changement, et à un vrai élargissement des perspectives que nous invite M’hamed Oualdi, professeur à Sciences Po Paris et historien du Maghreb et de l’empire ottoman. Son essai érudit, qui se veut introductif à la question de l’esclavage, revient sur de nombreux clichés. D’abord sur celui qui voudrait que l’esclavage soit un tabou – véritable « lieu commun » qui occulte de nombreux travaux universitaires (ceux de Mohammed Ennaji, Behnaz A. Mirzai, etc.), qui, même si leur diffusion est entravée par les difficultés de publication, existent bel et bien. Il ne tient pas compte de la récurrence du sujet en littérature (Béchir Khraïef, Abdelkrim Ghallab, Fatima Mernissi…). Ce cliché invisibilise une recherche faite à partir de sources en arabe, en turc, en persan, en haoussa et qui sont des biographies d’esclaves, des suppliques, des lettres, des récits de vie, qui remettent l’humain au cœur de ce sujet. S’il tient à la barrière linguistique, au décalage institutionnel voire à la « compétition sociale ou de quête éthique » qui amène des auteurs à prétendre être les premiers à publier sur le sujet, il laisse croire qu’il faut « des justiciers et des justicières venus d’Europe et d’Amérique du Nord » pour révéler cette histoire. Or M’hamed Oualdi souligne l’importance de l’idéologie dans le choix des termes par des historiens occidentaux retenant islamique, arabe voire oriental alors qu’ils ne parlent pas de traite catholico-protestante ni latino-chrétienne, encore moins d’occidentale. « Il est aussi remarquable que ce soient avant tout les traites au sein des mondes musulmans qui aient été comparées à la traite atlantique, en en laissant d’autres de côté, comme les traites internes aux sociétés africaines, celles internes aux empires chinois depuis les temps antiques jusqu’aux premières mesures d’abolition des années 1905-1910, ou bien encore les structures de dépendance de la société indienne, qui se superposaient au système de castes. »
Une multiplicité de situations complexes
M’hamed Oualdi revient sur la nécessité de sortir de la grille de lecture occidentale, notamment nord-américaine, pour penser les concepts à partir des mondes musulmans. Du reste, souligne-t-il, il n’y a « pas de définition unanime » de l’esclavage : le critère de la liberté n’est valable que dans les sociétés (musulmanes et occidentales) qui ont « mis en valeur cette notion de liberté » ; il y a aussi d’autres critères comme le « droit de propriété », les « traitements de forte exclusion, de perpétuelle domination physique et psychologique, de désocialisation et de déshonneur »… Et il faut tenir compte de tout l’éventail des réalités sociales dont le vocabulaire témoigne (‘abd, fata, ama, jariya, ghulam, mamluk, wasif, khadim…).
La première partie retrace les origines et les routes de l’esclavage, en identifiant trois types : l’esclavage domestique, l’esclavage administratif et militaire, et enfin l’esclavage rural, dont l’esclavage de plantation est une dimension. M’hamed Oualdi analyse les différents critères de rang et de fonction des esclaves, qui ne tenaient pas seulement à la couleur de leur peau, mais à leur sexe, à leur origine et à leur âge, et insiste sur le fait qu’en temps de crise (famine ou épidémie), « la frontière entre liberté et servitude se révèle être très mince ». Là encore, il revient sur le cliché du XIXème siècle selon lequel l’esclavage, étant domestique, est « moins violent que l’esclavage de plantation pratiqué à large échelle dans les Amériques colonisées par l’Occident » : l’esclavage doux n’existe pas. L’auteur réfute la concurrence mémorielle et les tentatives de comparaison en termes de nombre de victimes, l’instrumentalisation des chiffres tendant à « disculper l’esclavagisme “européen” » et dissocier le Maghreb et l’Afrique.
Dans une seconde partie, il propose des portraits d’esclaves selon leurs rôles économiques : eunuques, servantes, mamelouks et concubines, paysans… il insiste sur les paradoxes des situations, sur leur instrumentalisation dans un système de domination « pour accumuler des ressources et enrichir des patrimoines » sur les deux rives de la Méditerranée. Il s’intéresse au cas, resté rare, de la révolte des Zanj à la fin du VIIIème siècle en Irak, et évoque les nombreuses formes d’organisation d’esclaves, les négociations, les pétitions.
La troisième partie interroge les abolitions au XIXème siècle. « Fin de l’esclavage ou renouveau du capitalisme ? », se demande M’hamed Oualdi. Il souligne l’instrumentalisation de ce combat moral par les Européens pour justifier leur politique coloniale, conteste le cliché « du libérateur européen et de l’esclavagiste musulman » et rappelle que les missionnaires qui rachetaient les esclaves leur imposaient la tutelle de l’Église, « donc de nouvelles contraintes ainsi que d’autres formes d’obéissance », dans une époque qui réaffirmait « des hiérarchies raciales visant à maintenir une forte distinction entre des populations libres, d’une part, et des hommes et des femmes noirs libérés, d’autre part ». La pensée abolitionniste n’est pas seulement le fait d’idées européennes, mais des figures comme Muhammad Bayram V, Ahmad Shafiq Bey, Ahmad Ibn Khalid al-Nasiri al-Slaoui mais aussi Fatima Mernissi et Amina Wadud plus récemment n’ont pas juste été une « réaction aux politiques abolitionnistes puis aux politiques coloniales européennes », mais « s’enracinent aussi dans les longues histoires de luttes contre l’asservissement des populations locales ». Et d’insister : c’est « la transformation profonde des économies sous domination coloniale qui a rendu le recours aux esclaves d’abord nécessaire puis de moins en moins utile, voire impossible ». Ces transformations économiques ont paupérisé les travailleurs colonisés « qui ont comparé leur condition de dominés à celle des esclaves des époques médiévale et moderne ».
M’hamed Oualdi se penche dans la dernière partie sur les survivances et les situations de post-esclavage. L’enjeu est de « penser conjointement ce qu’il reste des esclavages des musulmans en Europe, de celui des Européens et des Africains subsahariens au Maghreb » pour insister sur le trafic d’êtres humains et sur les situations d’oppression, « y compris la prostitution, les mariages forcés, etc. », et sur « la chaîne de dominations qu’engendre le capitalisme » avec l’adhésion de gouvernements au néolibéralisme « qui restreint toute possibilité de protection des travailleurs, et notamment des travailleurs migrants ». Cette réflexion doit tenir compte de la multiplicité des identifications superposées (donc sortir de la lecture occidentale d’un « esclavage “en noir et blanc” »). Elle doit prendre en compte l’hybridation des cultures (neggafates, gnaoua…) et les trajectoires des descendants d’esclaves, dont l’oubli des origines serviles pour les convertis à l’islam et pour les descendants d’esclaves musulmans en Europe. Il met en garde contre les manipulations mémorielles, comme l’histoire des esclaves chrétiens par les suprémacistes blancs colonialistes. De même, les résurgences violentes, avec Boko Haram ou dans le Golfe, de formes contemporaines d’esclavage, différentes de ses formes historiques, peut contribuer « à culturaliser des situations d’exploitation économique diverses ».
Le propos de l’auteur est donc de souligner, au-delà du déni du racisme anti-noir, envers à la fois les citoyens et les migrants, le « lien fort, évident et crucial entre l’histoire longue de l’esclavage et la profondeur historique du racisme anti-noir » et de montrer « comment les sociétés musulmanes ont dominé et utilisé des esclaves et comment, dans le même temps, ces sociétés ont été façonnées jusqu’à nos jours par l’esclavage, selon les hiérarchies que ce système de domination produits ». C’est donc à une mise en place de cadres de pensée pertinents au sein des mondes musulmans qu’il invite. Un ouvrage remarquable et nécessaire.
Pour aller plus loin, écouter l’interview de M’hamed Oualdi sur « Paroles d’histoire » le 24 mars 2024 : https://parolesdhistoire.fr/index.php/2024/03/24/2580/
Kenza Sefrioui
L’esclavage dans les mondes musulmans, des premières traites aux traumatismes
M’hamed Oualdi
Éditions Amsterdam, 256