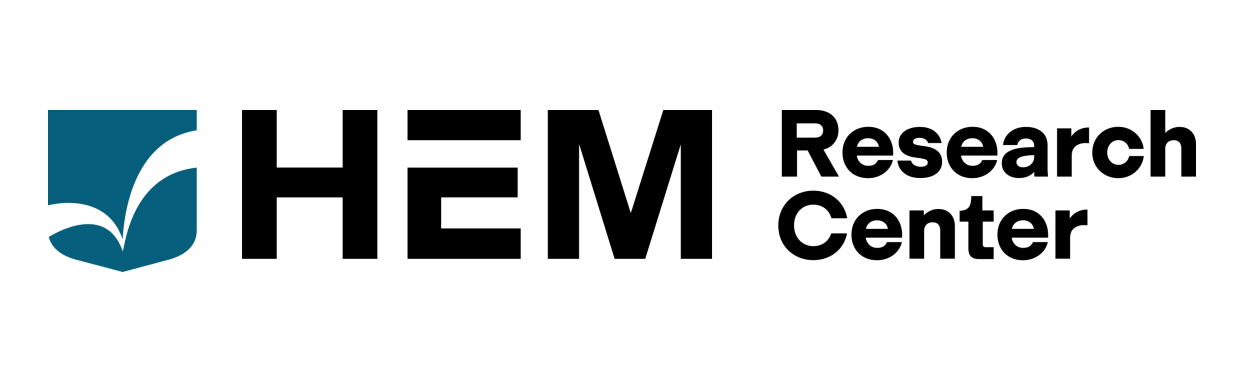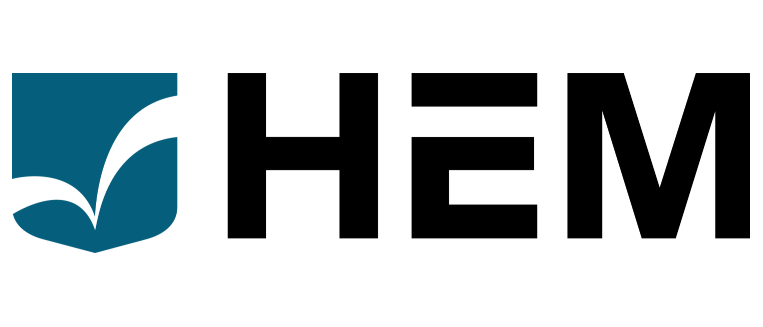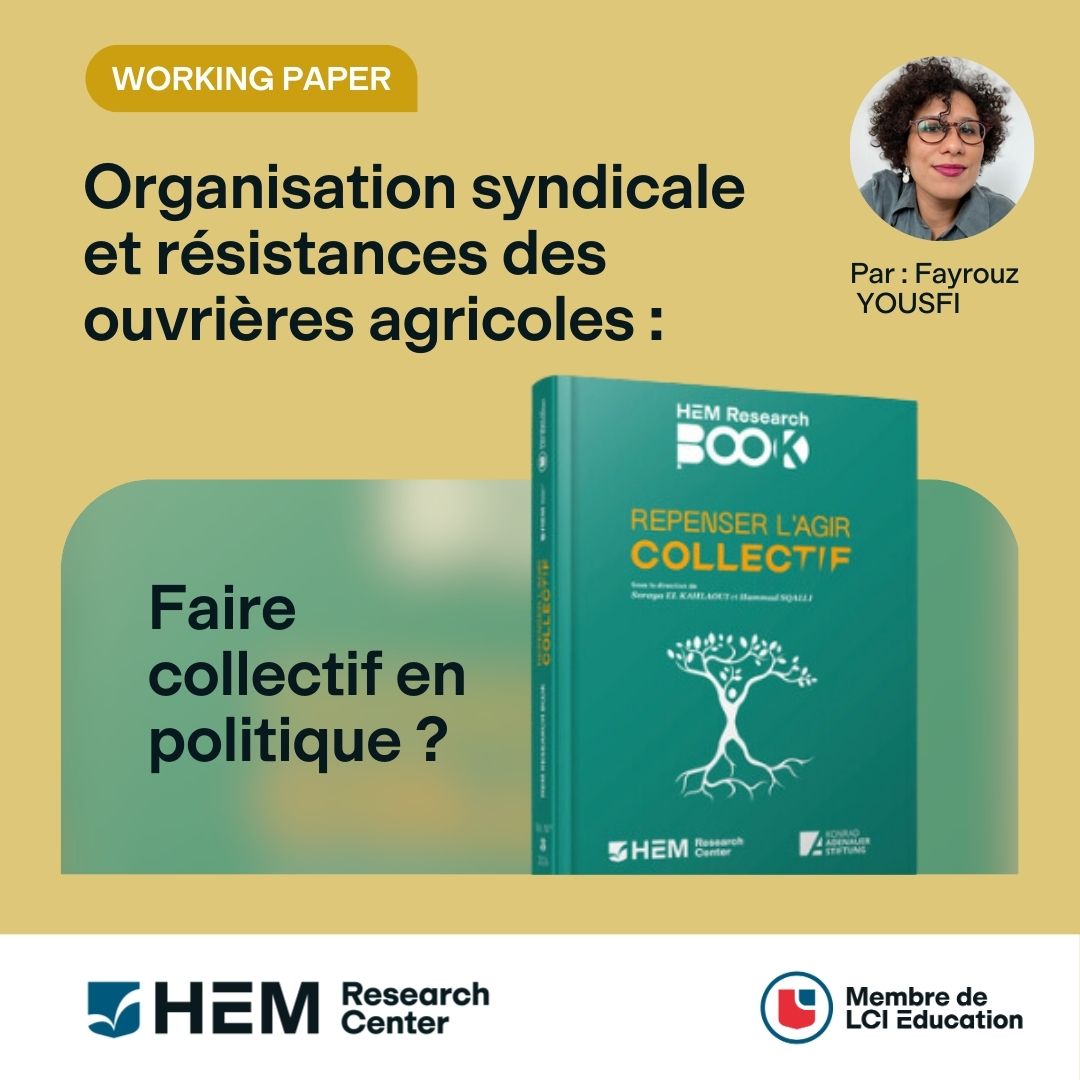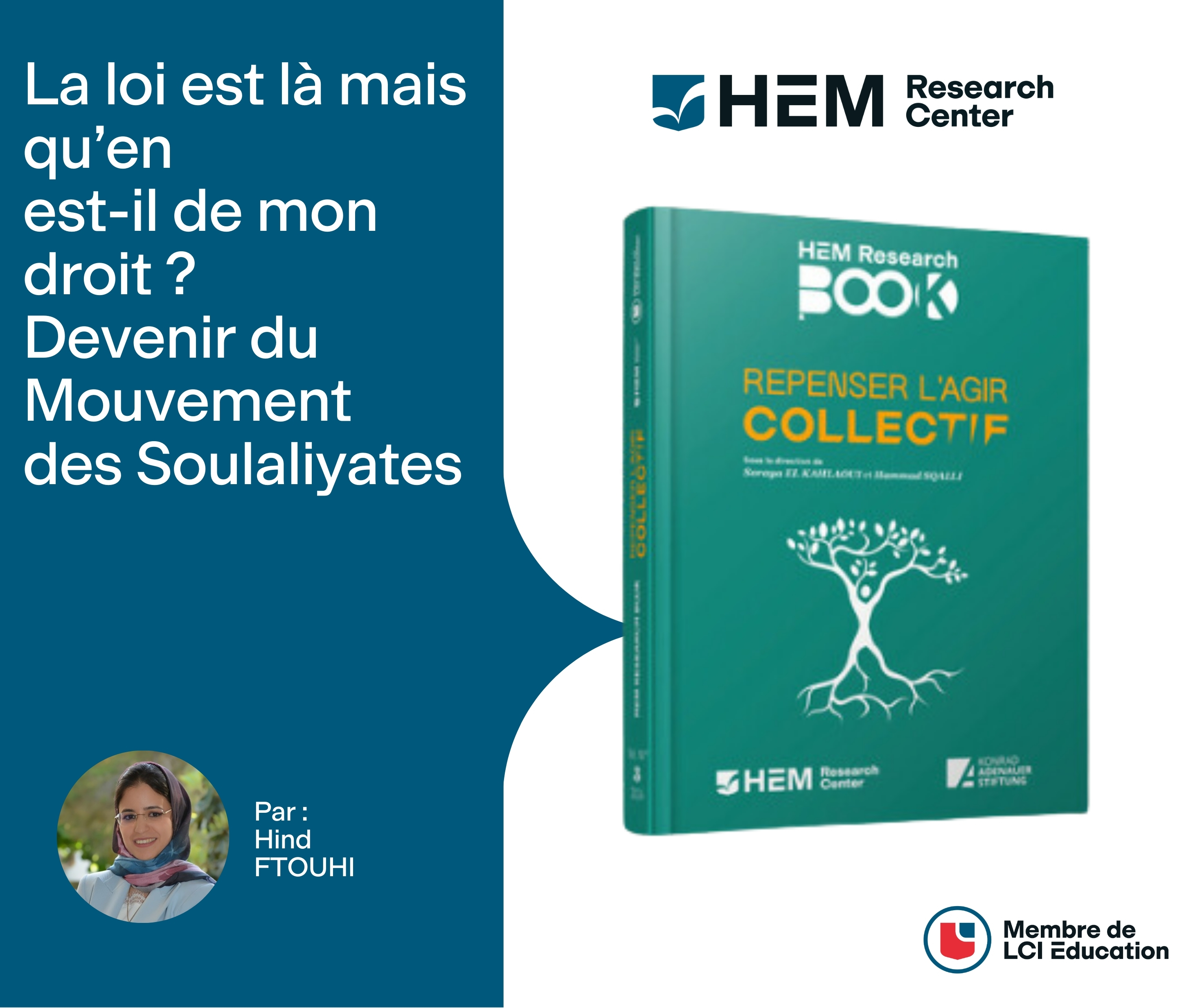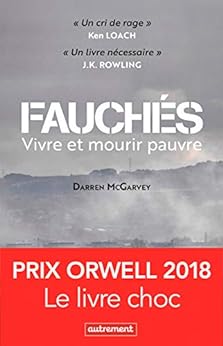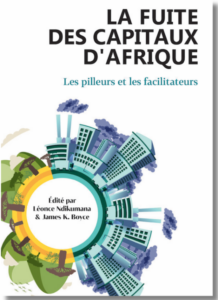
La fuite des capitaux d’Afrique :Les pilleurs et les facilitateurs
La fuite des capitaux d’Afrique étudie la dynamique de fuite des capitaux d’Afrique du Sud, d’Angola, et de Côte d’Ivoire, pays qui ont, ces dernières décennies, enregistré des sorties illicites de capitaux à grande échelle. Pour chacun de ces pays, l’analyse quantitative, qualitative et institutionnelle est utilisée pour examiner le modus operandi de la fuite des capitaux.
Fayrouz Yousfi
Fayrouz Yousfi est doctorante à l’Université de Gand et membre du MENARG (Middle East and North Africa Research Group). Sa recherche se concentre sur le rôle crucial des femmes ouvrières agricoles dans les mobilisations pour les droits du travail dans le Sud du ...
Voir l'auteur ...Organisation syndicale et résistances des ouvrières agricoles : Faire collectif en politique ?
Ce chapitre examine les mobilisations des travailleuses agricoles dans la vallée du Souss au Maroc, mettant en lumière l’impact des transformations structurelles induites par les politiques néolibérales sur les pratiques et manières de mobilisations. À travers le cas des ouvrières agricoles, nous avons tenté d’analyser les capacités de ces femmes à former un collectif en politique. En effet, cette contribution vise à comprendre comment les mobilisations des travailleuses agricoles s’inscrivent dans le champ politique et l’espace de contestation marocains.

Dia BARGHOUTI

Laïla MERNISSI
Simon PIERRE

Fayrouz Yousfi

Hamza ESMILI
Hind Ftouhi
Hind Ftouhi est ingénieur agronome de l’Ecole Nationale d’Agriculture et docteur en sociologie rurale de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc (2021). Dans ces recherches, elle s’intéresse au rôle des jeunes ruraux dans les processus des changements agraires et terri...
Voir l'auteur ...La loi est là mais qu’en est-il de mon droit ? Devenir du Mouvement des Soulaliyates
Ce chapitre est une contribution à l’étude de l’évolution du Mouvement des Soulaliyates à la lumière des récentes réformes apportées par la loi 62-17 relative à la tutelle administrative sur les communautés soulaliyates et la gestion de leurs biens, promulguée en 2019. Nos résultats mettent en évidence l’existence d’un décalage entre la loi promulguée et son application effective sur le terrain. Dans ce contexte, les femmes développent plusieurs stratégies pour négocier l’accès à une part de la terre collective, et doivent faire face à plusieurs contraintes.
Fauchés. Vivre et mourir pauvre
Auteur : Darren McGarvey, traduit de l’anglais (Écosse) par Madeleine Nasalik
Pauvreté : autoanalyse
Dans un poignant témoignage, le rappeur écossais Darren McGarvey analyse les mécanismes de marginalisation et de destruction des exclus.
« La dignité, c’est un truc de riches », relève amèrement Darren McGarvey. Né à Glasgow et élevé dans les quartiers pauvres, le rappeur porte dans Fauchés, vivre et mourir pauvre un témoignage d’une terrible lucidité sur l’école de la misère. « Dans les bas-fonds de ces quartiers, entre l’alcool et la drogue, des gens tâchaient d’élever des enfants. L’un d’eux était ma mère. » Ce livre choc, paru en anglais en 2018 sous le titre de Poverty Safari, a obtenu le prix Orwell la même année – un prix qui salue des œuvres susceptibles de rapprocher le grand public de la politique, par le biais de la littérature et du journalisme. À l’heure où les laissés-pour-compte du néolibéralisme se portent vers l’extrême droite, ce livre place la focale à hauteur d’enfant puis de jeune, pour en montrer les conséquences dévastatrices.
Ce livre est bouleversant non pas seulement pour sa dimension autobiographique, mais pour la force de l’analyse politique qu’en tire Darren McGarvey. Raconter pour lui, c’est décrypter, mettre en perspective. Le détail n’est pas ici anecdotique ni égocentré. Il est une preuve de la distorsion des perceptions en contexte de perturbation, de manque, de handicap, d’humiliation et de violence.
Conditionnement toxique
« Les types comme moi n’écrivent pas de livre – en tout cas, c’est ce que mon cerveau me répète à longueur de temps », écrit l’auteur en préface. Dans Fauchés, il retrace, à chaque étape de sa vie, le décalage entre les données d’un réel ne produisant que des assignations, et ce qu’il a pu réaliser pour devenir rappeur, puis écrivain. C’est d’abord un livre adressé, qui veut partager cette expérience de réussite et ses clefs : « Quand j’écris, j’ai en tête des gens qui me ressemblent : ceux-là ne viennent pas spontanément à la lecture, et je les invite à se servir au hasard à piocher des bouts dans le désordre ou à s’attaquer aux chapitres isolément. » Il insiste sur la fidélité à soi et à ses origines, il témoigne de son propre parcours mais aussi de ce qu’il a appris au cours de son métier d’éducateur dans les prisons, ce qui lui permet justement cette adresse et le ton juste avec lequel il évoque le « handicap social » et les facteurs de blocage. Darren McGarvey s’intéresse à la dimension de victime de personnes qui ont été poussées dans la délinquance : « Sans essayer d’inverser les rôles, on ne peut s’empêcher de constater qu’une grande partie du comportement antisocial et destructeur des délinquants s’enracine dans leur enfance. […] Si vous déroulez la pelote de leur existence, la probabilité est grande qu’ils aient été victimes enfant d’une forme ou d’une autre de violence. »
La grande force de ce livre est son sens de la nuance, mais aussi le fait qu’il évoque la misère non pas seulement en termes économiques, mais dans tout ce qu’elle affecte au niveau psychique, au niveau de l’égalité des chances entravée, au niveau des possibilités non offertes. « La pauvreté est avant toute chose un champ gravitationnel qui englobe des forces hétéroclites- la culture, la politique, la santé, le mental, l’économique et le social ».
Darren McGarvey commence par le plus évident : les séquelles de la violence. Il décortique les stratégies de réponse, celles du corps et celles de l’esprit, à la violence subie, de l’agression brute à l’état d’angoisse liée à une menace larvée constante. Il raconte l’impossibilité dans un groupe d’assumer une émotion positive en parlant de quelque chose de beau, et l’obligation d’enrober sa prise de parole dans la grossièreté pour ne pas faire face aux moqueries voire à l’agressivité des autres.
Il s’intéresse également à la manière dont l’habitat « oriente notre état d’esprit et notre parcours » et brosse au passage l’histoire désastreuse des politiques du logement ouvrier et du logement social à Glasgow, avec des projets conçus par architectes qui ne connaissent pas les gens du quartier mais ont plein d’a priori à leur propos – « les personnes concernées par le programme n’ont jamais été consultées ». Promiscuité, pas d’intimité, pas de vie privée, les failles exposées, puis destruction de ces « anomalies dans la marche du progrès social », effaçant au passage les lieux où les habitants ont une mémoire. Les facteurs dangereux qui se cumulent : désocialisation, maltraitance, toxicomanie – un lien qu’il est urgent de souligner. Darren McGarvey observe la fabrication des préjugés, qui aboutissent à des retranchements « dans sa catégorie sociale » et créent l’impossibilité d’un dialogue. Et il énumère les paramètres susceptibles de donner à son récit une « illusion de neutralité » et en faire une « réalité objective » : problèmes de dépendance à des substances, casier judiciaire, difficultés financières, tentatives de suicide, prison, vote, relation à problème, problèmes de santé, stress… Pour nombre de paramètres, la formulation est négative : « aucun n’est allé à l’université, aucun n’est propriétaire de son logement, aucun n'a d’économies à la banque […] aucun ne fréquente de librairie ou de lieu qui présente un intérêt culturel… » Et de commenter : sous cette forme, « on comprends plus facilement que chaque situation a beau être unique, il est quasiment impossible d’échapper au déterminisme social ».
Darren McGarvey regrette que ces problèmes du quotidien soient négligés par la classe politique, laissant un boulevard à l’extrême droite. Entre conséquence d’un système injuste et responsabilité individuelle, les discours sur la pauvreté étant le fait de personnes qui en ont « une expérience très limitée », il y a un « décalage entre les principaux concernés et les “sachants” [qui] neutralise toute tentative de peser dans la balance tout en donnant aux déclassés l’impression qu’ils ont définitivement disparu des radars de la “culture” ». Autre conséquence : l’abstention et la défiance vis-à-vis des institutions, qui desservent les intérêts des concernés – hormis des expériences de résistance grâce à des personnalités qui réussissent à proposer d’autres possibles. Darren McGarvey appelle à un débat de fond sur le racisme : « Nous ne pouvons pas nous permettre d’ignorer les préoccupations de nos concitoyens sous prétexte qu’elles représentent, dans noter grille de lecture, une insulte ou une menace. […] Il y va de la survie de notre modèle multiculturel. » Il conclut son livre sur un « Manuel pragmatique pour radicaux réalistes », avec cette touche finale : « Ce que je pense, c’est que je me trahirais et je trahirais les mien si je refusais d’admettre que j’ai changé, alors que rien ne m’y disposait. Voilà l’acte le plus radical qu’on puisse accomplir. » Un texte très fort.
Kenza Sefrioui
Fauchés. Vivre et mourir pauvre (2018)
Darren McGarvey, traduit de l’anglais (Écosse) par Madeleine Nasalik
Autrement, 336 p., 250 DH