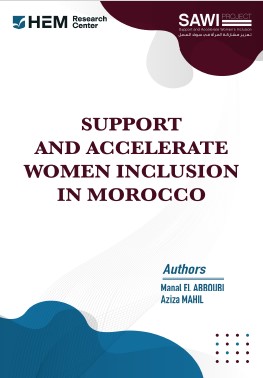
SUPPORT AND ACCELERATE WOMEN INCLUSION IN MOROCCO (SAWI)
We are extremely proud, as HEM Research Center, to be Morocco leading scholarly institution on this problematic and highly urgent issue of women inclusion in the corporate world, referred to by the acronym SAWI, with other university partners in the MENA region. Our research team has been involved for more than two years and will start a new implementing cycle under the supervision of Prof. Manal El Abboubi, who is at the head of our chair on Social Innovation.
Manal EL ABBOUBI
Professeure à l’Université Mohamed V, Rabat. Elle est chercheure associée à HEM Research Center et à EGiD (Etudes sur le Genre et la Diversité en Gestion) à l’Université de Liège (Belgique). Elle détient un doctorat en sciences économiques et de gestion de HEC Ecole de Gestio...
Lire la suite ...Aziza MAHIL
Titulaire d’un Ph.D en sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et une d’une M.Sc en marketing aux Hautes Etudes Commerciales (HEC Montréal), Aziza MAHIL est professeure de gestion à la FSJES de Ainsebaâ, Université Hassan II Casablanca et chercheure associ...
Lire la suite ...



