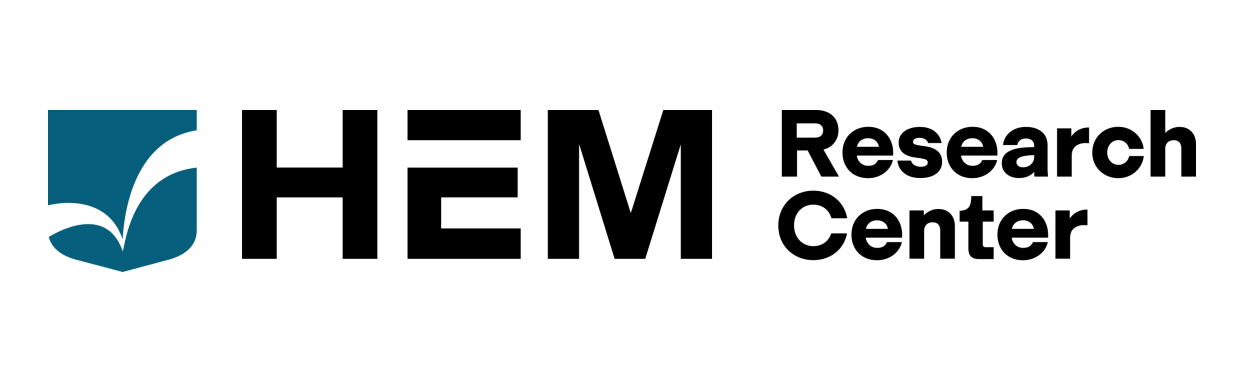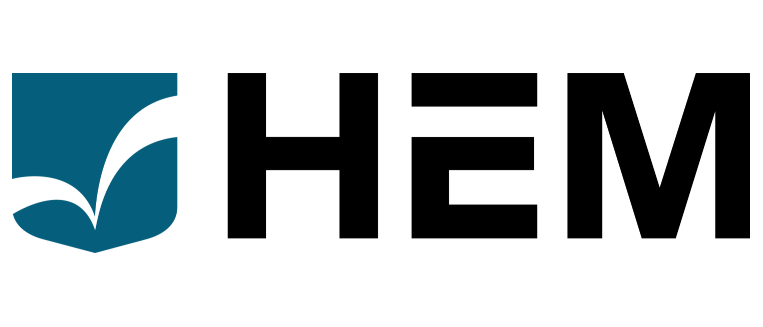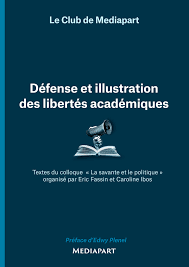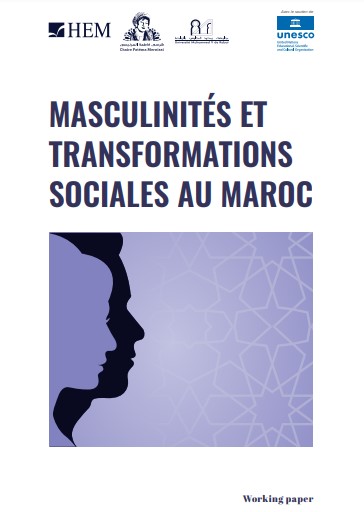Interview with Jörg GERTEL : Coping with uncertainty
Question 1: Your work (co-authored with R. Hexel) and titled "Coping with Uncertainty: Youth in the Middle East and North Africa, ( in arabic مأزق الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Beirut, Dar al-Saqi, 2019) presents the results of a quatitative study conducted on a large scale in 2016 and addressing the situation of youth in the region (Morocco, Tunisia, Bahrain, Jordan, Lebanon, Palestine, and Yemen) in a Post-Arab Spring context, what are the main lessons you have retained from the study?
Entretien avec Imed MELLITI : L’opportunisme politique n’a pas que des méfaits !
L’une des particularités de Imad Melliti réside dans le fait d’avoir choisi les adolescents du monde arabe comme objet de sa recherche sociologique. Il se définit comme faisant partie d’une mouvance qui a essayé de réhabiliter les approches qualitatives en Tunisie, cherchant ce que peut apporter la parole de l’acteur social ordinaire, ses catégories et son point de vue. « Nous avons intérêt, au Maghreb aujourd’hui, à creuser davantage ce sillon et à donner plus de place à la recherche qualitative qui travaille sur l’enjeu du sens », dit-il.
Défense et illustration des libertés académiques
Auteur : Médiapart
Contrer la réaction
Le colloque "La savante et le politique" rappelle l’importance des savoirs situés et leur dimension fondamentalement politique.
La science est politique, rappellent les 22 contributeurs et contributrices du colloque organisé par les sociologues français Éric Fassin et Caroline Ibos du 7 au 10 juin 2021, La Savante et le politique, dont les actes sont publiés sous la forme d’un eBook en téléchargement gratuit disponible dans le Club Médiapart. Aujourd’hui, explique en préface le directeur de publication du site Edwy Plenel, intellectuels, chercheurs et journalistes font face, au-delà des différences de leurs écosystèmes professionnels à une menace commune : « la fin de la vérité. De la vérité comme exigence, recherche et audace, production et vérification, confrontation et discussion ». Les politiques néolibérales et réactionnaires dégradent les conditions d’enseignement et s’en prennent aux savoirs critiques. En France, puisque c’est surtout à partir de là qu’est étudié ce phénomène généralisé (Turquie, Suisse, Serbie, Colombie, Brésil, Hongrie, Royaume-Uni, États-Unis…), sous l’étiquette très peu scientifique d’« islamo-gauchisme », on récuse toutes les recherches – études sur la race, le genre, l’intersectionnalité, études postcoloniales et décoloniales, écriture inclusive… – qui « parlent des formes de domination – et donc de la liberté et de l’égalité, valeurs universalistes », au nom en plus de l’universalisme, de la liberté d’expression, voire de la neutralité axiologique. C’est cette « offensive contre l’ensemble des savoirs critiques » par un camp conservateur dont l’anti-intellectualisme est profondément idéologique, qu’étudient ces contributions, fortes de leur position éthique, qui assument la responsabilité de défendre la liberté et l’émancipation, bref, « les principes de la démocratie ».
Réancrer la production de savoir dans la société
La première partie éclaire les attaques visant les libertés académiques. L’accusation d’être idéologique et non scientifique faite aux études minoritaires qui portent justement sur « les processus de minoration, c’est-à-dire d’altérisation et de naturalisation des groupes sociaux qui sont en situation de moindre pouvoir », procède, selon la sociologue Sara Garbagnoli d’un « renversement victimaire » des majoritaires. La convergence de l’ultra-néolibéralisme, de l’antiféminisme et du racisme érige en politique la « guerre contre la production de connaissances » explique la chercheuse et féministe brésilienne Sonia Corrêa. « Guerre contre le terrorisme » pour criminaliser les révoltes populaires et « servir le capital », c’est cela, « enfin faire de la science » en Turquie, déplore Zeynep Gambetti, qui rappelle « la nature politique de la critique ». L’« islamo-gauchisme » est la réaction nationaliste des universitaires âgés et de disciplines représentant « la fraction la moins ouverte aux échanges et collaborations internationales », note le politiste français Philippe Marlière, alors que les savoirs sont « de nature internationale ». Interroger la domination masculine, l’héritage colonial et les modèles de la communauté nationale française expose à être broyé par l’institution universitaire, explique la chercheuse Mame-Fatou Niang, qui déplore que la France se dise « aveugle à la couleur, tout en [la] renvoyant à celle-ci dès [qu’elle s’] aventure hors des deux cadres d’interventions publiques qui [lui] sont concédés : le silence et la gratitude ».
La deuxième partie, « Pour en finir avec la neutralité axiologique », s’intéresse aux approches « pluriverselles » contestant un centre unique et hégémonique, pour garder « le potentiel critique et subversif » des concepts créés par des subalternalisé.e.s. Nassira Hedjerassi, chercheuse en sciences de l’éducation, explore les « voie/x ex-centriques », avec celle de Bell Hooks, qui avait à cœur de toucher hors du monde académique pour déclencher une « résistance épistémique », en produisant « de nouvelles façons de savoir et d’apprendre ». La politiste Gwenaëlle Perrier se penche sur les résistances à l’écriture inclusive en France, au Brésil et en Allemagne, « entre antiféminisme discret et anti-intellectualisme ouvert ». Le chercheur en étude culturelles Mehdi Derfoufi étudie comment les réponses des minorités de genre et ethnoraciales dans le jeu vidéo permettent de « repenser depuis les minorités les moyens de prendre la place ». La sociologue Karine Espineira témoigne du « sport de combat » que sont les savoirs situés, en témoignant sur la transidentité et les savoirs trans. La géographe Rachele Borghi interroge la place de son propre corps de chercheuse : « Comment produire un savoir sur les sujets étudiés sans délégitimer et invisibiliser celui produit depuis l’intérieur ? » L’historienne Delphine Gardey rappelle le « caractère relationnel, situé, engagé, incorporé de toute forme d’être au monde et donc à la connaissance » et appelle à « inverser la charge de la preuve ».
La dernière partie, « Défendre les savoirs critiques », porte sur les modes de production des savoirs. « Il est du devoir des chercheurs, payés par le contribuable, de mettre au service du débat public le fruit de leurs travaux, fussent-ils vénéneux aux yeux de certains, car leur seule utilité, s’il en faut une, est d’empêcher de penser en rond. Par définition, le chercheur est un emmerdeur, et telle est sa grandeur, ou plutôt celle de son métier », martèle le politiste Jean-François Bayart, inquiet des dispositifs de cooptation induits par les financements contractuels et de la dépolitisation de la figure de l’expert. Pour le sociologue Fabien Jobard, il faut résister aux atteintes aux libertés académiques et à l’autonomie scientifique, du fait de la pression des financements et des injonctions ministérielles. La géographe Anne-Laure Amilhat Szary interroge les violences non seulement adressées à la liberté d’opinion, mais aussi portant sur les conditions de production des savoirs émancipateurs. La sociologue Nacira Guénif rappelle les processus de « domestication » et de « rappel à l’ordre disciplinaire » et invite à mettre à bas « le régime de conditionnalité réservé aux racisé.e.s, basané.es et métèques » pour revoir les espaces de pensée. Pour l’historienne Fanny Gallot, il faut « reconnecter les intellectuel.les engagé.es au mouvement social » et reconstruire un « intellectuel collectif ». Enfin Éric Fassin et Caroline Ibos rappellent, avec David Graeber, « que les sciences sociales ne sont pas nées d’un goût de l’érudition mais de la nécessité de comprendre les structures de pouvoir, dans l’espoir d’améliorer la vie en société ». La route est longue…
Kenza Sefrioui
Défense et illustration des libertés académiques
Collectif
Médiapart, 275 p., en ligne gratuitement sur https://blogs.mediapart.fr/edwy-plenel/blog/230921/defense-et-illustration-des-libertes-academiques-un-ebook-gratuit
Développer les talents de la future génération de leaders
Ce rapport de recherche est la synthèse d’une étude sur les leaders émergents, leurs stratégies, pratiques et leviers d’empowerment, un travail d’une durée de trois ans, fruit d’un partenariat entre le Policy Center For The New South et Economia HEM Research Center avec la participation du laboratoire LARGEPA de l’Université Pa
Entretien avec Mounia BENNANI-CHRAÏBI "Théoriser sur le terrain des jeunes"
Vous avez commencé vos terrains sur les jeunes au Maroc il y a presque trois décennies. Votre livre Soumis et rebelles : les jeunes au Maroc a été l’un des premiers où la parole leur était donnée et où l’analyse a été faite à partir de données empiriques. Qu’est-ce qui reste d’actualité de ce travail pionnier ?
Fadma Ait Mous
Fadma Ait Mous est actuellement professeure-chercheure au Département de Sociologie à la faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain Chok (université Hassan II de Casablanca). Elle assure la coordination scientifique du Centre Marocain des Sciences Sociales (CM2S) de la même université...
Voir l'auteur ...Leila Bouasria
Leila Bouasria est enseignante-chercheuse en sociologie à la faculté des lettres et des sciences humaines d’Ain Chock, université Hassan II de Casablanca. Elle est membre associée au Laboratoire de Recherche sur les Différenciations Sociales et les Identités Sexuelles (LADSIS) et me...
Voir l'auteur ...Lisa BOSSENBROEK
Depuis 2010 Dr. Lisa Bossenbroek travaille sur la thématique du genre et la gestion des ressources naturelles. Ses premières recherches se sont focalisées sur le Tadjikistan et l’Afghanistan. Depuis 2011, elle travaille au Maroc sur les thématiques de...
Voir l'auteur ...Masculinités et transformations sociales au Maroc
Ce projet de recherche vise à esquisser dans une phase de pré-étude les représentations sociales et imaginaires des masculinités au Maroc. L’idée de mener cette recherche, avec l’appui de l’UNESCO Maghreb, à partir du prisme des transformations sociales en cours, intervient dans un contexte particulier. En effet, suite aux avancées réalisées en matière des droits des femmes et des dynamiques de changement qui traversent les rapports sociaux de sexe, la binarité traditionnelle qui sépare les féminités et les masculinités se trouve remise en question.
Pause_R : Nouveau Podcast à découvrir !
Economia, HEM Research Center, en partenariat avec TelQuel et l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), lancent une série de Podcasts intitulée Pause_R !
Chaque mois, Murtada Calamy donne RDV avec un nouvel épisode sur une thématique sociétale, économique ou philosophique, en compagnie d'invités, chercheurs éclairés.
Découvrez ci-dessous les Podcasts Pause_R sortis à date & Inscrivez-vous pour être informé des Podcasts à venir !