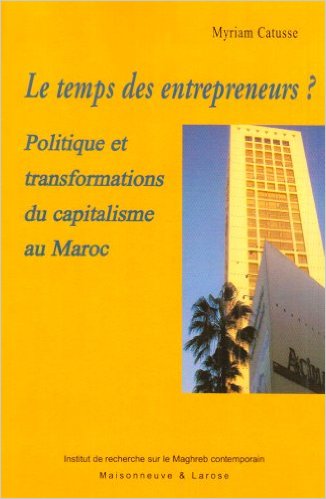
Le Maroc au temps des entrepreneurs
Auteur : Myriam Catusse
Myriam Catusse considère le Maroc comme un laboratoire des transformations du capitalisme, et ce en suivant deux axes principaux. Le premier s’intéresse aux enjeux des privatisations en tant qu’instrument qui engendre une nouvelle génération d’entrepreneurs, au clivage entre action publique et investissements privés et à la formation de nouveaux pouvoirs dans un cadre marqué par la normalisation. Le second s’attache aux conditions de l’entrée des entrepreneurs dans l’environnement politique, à travers le rôle de groupes d’intérêt comme les Chambres de commerce et d’industrie, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), les partis politiques, les associations et les syndicats.
Dès le début trois problématiques importantes se dégagent. La première est double : d’un côté, les difficultés de l’Etat dues aux déséquilibres économiques de la balance courante de la fin des années 1970. Se posait alors la grande question des systèmes d’accumulation de richesses, de leur redistribution, tout en assurant la pérennité du régime – n’oublions pas les deux coups d’Etat, les troubles de 1973 et le problème de la récupération des provinces du sud. De l’autre, la question des ressources, des prédispositions des différents opérateurs économiques, ainsi que leur capacité à gérer avec profit et rationalité la vague des réformes néolibérales du programme d’ajustement structurel (PAS) de 1983.
La deuxième date de 1989, quand le Parlement a adopté la loi sur les privatisations, dans la suite logique du PAS, négocié tant bien que mal avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La troisième se résume dans une image forte : en 1996, à la suite de la difficile campagne d’assainissement,
Hassan II reçoit la CGEM avec cette phrase marquante : «Nous faisons partie d’une seule et même équipe et notre objectif commun est de gagner le défi économique, social et de la dignité du Maroc».
Un capitalisme opportuniste
De ces problématiques découlent, sur les vingt dernières années, de grandes transformations, marquées par des réformes néolibérales qui donnent au capitalisme marocain une singularité et un caractère paradigmatique. Ces transformations interpellent l’auteur par rapport à la bourgeoisie et à son rôle dans l’évolution du Maroc contemporain. Bourgeoisie «non bourgeoise», bourgeoisie «makhzénienne», antérieure au protectorat, ou «d’Etat» qui ne peut être liée qu’à un capitalisme d’Etat ? Le débat reste entièrement posé. Une chose est sûre: elle est critiquée pour ses activités de rente peu productivistes, peu industrialisantes et certainement peu entrepreneuriales.
Il est certain que les Marocains n’ont pas encore réglé la question existentielle de leur relation à l’argent, étant donné les valeurs et repères en cours sur la moralité du capital ou les pesanteurs de la culture matérielle du succès. Durant les deux dernières décennies, la formation de grandes fortunes a marqué un tournant dans l’émergence d’une nouvelle élite, constituée de grands propriétaires terriens, de hauts fonctionnaires, d’enseignants, d’industriels, d’hommes ou de femmes d’affaires et de commerçants, et qui accède au pouvoir législatif. Toutes ces catégories, largement identifiées sur le plan statistique et qui contribuent aux changements politiques, sociologiques et économiques, sont en décalage avec le concept d’entrepreneur, notion encore inexistante à la direction de la statistique du HCP et caractérisée par le clivage, pour ne pas dire le paradoxe, entre modernité et traditionalisme.
L’entreprise marocaine s’inscrit par conséquent dans une adaptation et un ajustement évolutif qui semble lent et certainement pas dans une transition radicale d’un état économique vers un autre. La preuve, c’est que ce nouveau langage autour de l’espace politique et social, de la légitimité des nouveaux pouvoirs privés face à un pouvoir public, est en train d’évoluer sous l’effet de cette manne que l’Etat a offert au secteur privé par les privatisations. Le capitalisme du Maroc est un capitalisme opportuniste, créé par l’Etat et qui continue à être soutenu par les pouvoirs publics. C’est ainsi que les industries manufacturières sont principalement dans une logique de profit des avantages liés à l’exportation, facilitée par les accords de libre-échange. Les activités commerciales et de services récemment créées sont orientées vers les besoins d’une nouvelle couche sociale, qui se forme et dispose d’un certain pouvoir d’achat.
L’impact des privatisations
Le stimulant majeur de ces changements reste le discours de Hassan II du 8 avril 1988 devant la Chambre des représentants. S’est depuis confirmée la volonté de l’Etat de transformer les préférences collectives, au profit de l’action entrepreneuriale et des vertus du privé mais dans quelle mesure cette politique qui a voulu engendrer des entrepreneurs a-t-elle été profitable au développement économique et social du Maroc ?
Les privatisations, fortement critiquées durant les années 1990, vont sortir du débat idéologique après l’arrivée de l’opposition au gouvernement (1998). On en vient même à dire qu’elles n’étaient pas imposées par le PAS ou la Banque mondiale, que c’est un «choix interne» ou encore, une «réorientation» de la politique économique.
Nouvelle question qui découle logiquement de la précédente : à qui profite la privatisation ? Ou, pour la formuler autrement, les privatisations ne constituent-elles pas une «OPA sur le Maroc» ou plus encore «une spoliation des biens publics» par de grands groupes nationaux et des groupes privés étrangers ? Quelques années après, la réponse est évidente. Il suffit d’observer quels capitaux contrôlent actuellement les structures pétrolières, les gestions déléguées de distribution d’eau, d’électricité, d’assainissement, des ordures ménagères, l’hôtellerie, les télécommunications…
[ photo manquante ]
Comment l’argent des privatisations a-t-il été utilisé ? Au départ, l’idée dominante était de l’injecter dans des projets structurants d’intérêt public. Ce fut le cas, même si les statistiques ne sont pas très précises, mais ce qui est également certain, c’est qu’il y a eu redistribution d’un grand patrimoine public à des réseaux sur lesquels s’est organisée la nouvelle autorité du pouvoir.
Parallèlement, la terminologie du management des entreprises marocaines privatisées ou non a évolué vers les concepts de «bonne gouvernance», d’«éthique», de «transparence»… et la CGEM s’est positionnée dans ce contexte comme le rempart de la crédibilisation et de la moralisation des affaires.
Avec des succès, quelques cas d’échec ou de révision des contrats avec les pouvoirs publics, les privatisations se sont inscrites dans des logiques plurielles, mettant en jeu des intérêts variés qui dépassent le contexte de l’entreprise, du fait qu’elles touchent aussi l’espace urbain, le sport, de nouvelles formes de mécénat, avec une vision, peut-être démagogique, qui tente de minimiser les risques sociaux et de s’intégrer dans une cogestion de la pauvreté, conférant à l’entreprise une image de citoyenneté.
Myriam Catusse voit dans l’annonce par le roi Mohammed VI, en mai 2005, de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) - un an après les attentats de Casablanca - un signe «des ajustements substantiels de l’économie politique du royaume en matière de réorganisation de la gestion des risques sociaux».
Vers un Etat de droit…
Restait à mettre en place un Etat de droit pour les affaires et à s’engager dans des perspectives de normalisation. C’est dans ce cadre que s’inscrit la Lettre royale au Premier ministre de juin 1993 où, annonçant le projet de réforme de la Constitution de 1996, Hassan II affirmait : «Nous avons voulu que cet Etat moderne soit un Etat de droit, où la loi est au dessus de tous et inspire confiance à tous; un Etat qui garantit les libertés et se démarque de toutes pratiques ou légalisations contraires aux Droits de l’homme».
Il s’agissait par conséquent d’établir la stabilité et le climat de confiance nécessaires au développement du marché, d’où un arsenal juridique constitué de la charte des investissements, du nouveau code du commerce, de la loi sur la société anonyme, de celle sur la concurrence ou encore de la loi instituant les tribunaux de commerce, et la signature, en août 1996, à la fin de la campagne d’assainissement, du «Gentleman’s agreement» entre le ministre de l’Intérieur et la CGEM. Ce document, aussi technique que politique, reconnaissait la légitimité de l’organisation patronale et symbolisait clairement l’entrée en politique des entrepreneurs.
En effet, durant cette dernière décennie, la CGEM a accompagné certains changements majeurs. Son pouvoir s’est adapté aussi bien à la période du PAS qu’à la période de l’assainissement, et on peut même affirmer que les structures sociales de cette organisation se sont consolidées. Ensuite, les héritiers des grandes familles du Souss et de Fès ont modernisé les activités de leur famille à la suite de leurs études en Europe ou en Amérique du nord, et ces «golden boys» affichent actuellement leur réussite. Enfin, nous assistons à une accentuation de la concurrence qui a poussé les PME–PMI à s’adapter tant bien que mal et les grandes structures à envisager leur évolution dans un espace de plus en plus mondialisé, profitant de nouvelles relations avec l’administration publique, de nouvelles sources d’accumulation et de la diversification de leurs activités.
[ photo manquante ]
Durant cette période, la CGEM, qui se veut le pivot de ces changements, a dû aussi se transformer. D’un «club de patrons» très proche des pouvoirs publics, elle se veut de plus en plus une organisation installée, prétendant représenter les intérêts du patronat et de l’entreprise, mais sans clivages malgré les divergences entre les intérêts des grands groupes et ceux, très différents, des PME. Sur la même période, les chambres de commerce et d’industrie, qui avaient sombré dans une certaine morosité, se sont lancées dans une trop lente réforme, compte tenu des changements rapides que connaissait le pays. Un double enjeu pour ces deux structures: laquelle d’entre elles allait le mieux représenter les entrepreneurs et réhabiliter l’image de l’entreprise ? Mais aussi, à un moment où s’engageait le dialogue social, laquelle pouvait conquérir le leadership au niveau de la représentativité sociale ?
Avec de nouvelles ressources, une nouvelle vision et des positions plus claires et plus déclarées, la CGEM, malgré ses conflits internes, commençait à susciter le doute sur ses liaisons dangereuses et sur la distance qu’elle devait garder entre économique et politique. C’est en 1998, que les dirigeants de cette organisation ont précisé les missions qu’ils entendaient assumer dans un document intitulé Stratégie et Plan d’action. Outre les missions classiques de représentation des membres et de concertation avec les administrations, la CGEM s’attribuait trois autres missions qui semblent plus politiques qu’économiques : une mission d’interlocuteur, auprès des pouvoirs publics, des partenaires sociaux ou des instances internationales. Avec cette nouvelle attribution la CGEM est mandatée aussi bien localement qu’internationalement, d’où son rôle dans le dialogue social ou lors des accords internationaux de libre-échange, par exemple ; une mission d’animateur, dans les domaines de la conceptualisation, de la modernisation, de la prestation de services, ce qui lui attribue le rôle stratégique «d’éclaireur et de pédagogue». Enfin, un rôle de dynamisation du partenariat et d’attraction des investisseurs étrangers.
De ces trois missions et des pratiques qui en ont découlé, on peut constater un passage d’une lutte des classes à une conception fondée sur le dialogue social, qui a fait passer le Maroc d’un «pays des privatisations à un pays des privations», a entraîné des effets sociaux très dangereux, dans des domaines aussi importants que l’éducation, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, la santé, le pouvoir d’achat, la culture, le sport… en un mot tout ce que l’on intègre dans l’indicateur du développement humain. Ainsi, alors que le pays connaît une dynamique récente, on n’a pas relayé les réformes issues du PAS et des privatisations par de nouveaux modes de régulation du rapport salarial, mais on s’est plutôt orienté vers une logique de flexibilité inspirée des politiques «thatchériennes et reaganiennes» du début des années 80.
Avec cette nouvelle génération d’entrepreneurs à l’assaut du politique, le Maroc passe avec une particulière singularité à «l’économisation de la représentation politique». Du coup, 39% des 325 élus à la Chambre des représentants en 1997, et 41% des 270 élus à la Chambre des conseillers dans les différents collèges électoraux sont issus du monde de l’entreprise ou des affaires. En 2002, les entrepreneurs, professions libérales et cadres d’entreprise représentent 55,97% de la Chambre des représentants, répartis entre toutes les formations politiques et témoignant d’un début de la prééminence des élites économiques dans le champ politique marocain.
Enfin, Myriam Catusse constate que le Maroc est «au diapason avec l’agenda néolibéral» et affirme : «Les réformes mises en place depuis plus de vingt ans dans les arènes de la politique économique se réclament des dogmes du développementalisme néolibéral». Une question reste posée : le fossé qui est en train d’éloigner les nantis des démunis, ne met-il pas le Maroc face à de graves incertitudes ?
Par : Noureddine Cherkaoui

