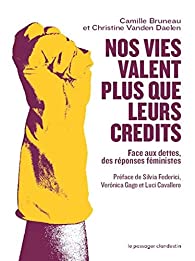
Kenza Sefrioui
Kenza Sefrioui est docteur en littérature comparée, de l'Université Paris IV-...
Voir l'auteur ...Nos vies valent plus que leurs crédits. Face aux dettes, des réponses féministes
Auteur : Camille Bruneau et Christine Vanden Daelen
Dette : remettre la vie au centre
Dans un essai documenté à travers le monde, Camille Bruneau et Christine Vanden Daelen montrent comment la dette affecte particulièrement les femmes.
« Sur quels corps atterrissent les dettes publiques et des ménages ? », s’interrogent en préface trois grandes figures du féminisme, Silvia Federici, Veronica Gago et l’Argentine Luci Cavallero, rappelant que les discours économiques prennent trop souvent les femmes pour des « variables d’ajustement », une « main d’œuvre d’appoint », bref « des pourvoyeuses non rémunérées de la reproduction sociale ». L’accélération actuelle du capitalisme est en fait, constatent-elles, celle de la précarité : « la dette est devenue la plus grande machine à accumuler des richesses et, simultanément, une forme de contrôle social au niveau micropolitique ».
La chercheuse en sciences politiques Chrisitine Vanden Daelen et la sociologue Camille Bruneau sont toutes deux membres du comité pour l’abolition des dettes illégitimes et leur travail s’inscrit dans une histoire de recherche engagée pour une économie féministe, plus juste, plus inclusive et plus écologique. « Les politiques économiques imposées au nom du remboursement de la dette (à savoir l’austérité aux Nords et les plans d’ajustements structurels aux Suds) s’attaquent justement, de façon spécifique et disproportionnée, aux personnes se situant du “côté perdant” de chacun des rapports sociaux : les personnes racisées, celles faisant partie des classes populaires, les minorités de genre ou sexuelles, les personnes porteuses de handicaps et, bien entendu, les femmes. » Pour elles, la dette et le féminisme sont les défis majeurs de notre époque et il est essentiel de souligner le lien qui existe entre eux. Leur approche s’attache à tout ce qui fait obstacle à l’émancipation individuelle et collective, et elles s’intéressent aux femmes en tant que travailleuses, usagères des services publics, personnes assignées au care, au ménage et aux besoins des proches, productrices et agricultrices notamment dans l’informel et cibles des violences sexistes.
De l’État social à la mère sociale
La première partie établit le lien entre dette et patriarcat. L’approche est ici historique, et retrace la dévalorisation, depuis le Moyen-Âge, du travail des femmes, et leur dépossession des communs[1] dans le cadre des enclosures. Les colonisations et l’esclavage ont aggravé la situation des femmes non blanches et, avec l’industrialisation, s’est imposé le contrôle sur les ouvrières et le cantonnement des femmes dans quelques activités sous-payées, voire gratuites. Aujourd’hui, les logiques de domination se maintiennent surtout par le biais de la dette publique, moyen principal de financement des États, remboursée par l’argent public tiré d’impôts inéquitablement répartis et par le maintien de politiques d’austérités qui contraignent les ménages et notamment les femmes à s’endetter pour faire face à leurs besoins élémentaires, comme l’éducation ou la santé.
Les autrices s’intéressent ensuite à la façon dont la dette affecte particulièrement l’emploi et l’autonomie économique des femmes. En termes de rémunération : elles soulignent que rendre compte correctement des écarts de rémunération entre femmes et hommes, devrait prendre la formulation qui fait apparaître le chiffre le plus haut, et non l’inverse, comme le remarque l’Observatoire des inégalités, en termes de temps, puisqu’elles surtravaillent tout en étant sous-payées. Et elles sont les premières victimes des coupes budgétaires : licenciements, taux d’emploi (plus révélateur que le taux de chômage). Les logiques extractivistes et de libre-échange (comme les champs de panneaux solaires au Maroc) ont par ailleurs contribué à faire exploser les inégalités foncières, sachant que les femmes sont les premières productrices, transformatrices et commerçantes, mais aussi « détentrices et gardiennes de savoirs, connaissances, semences, territoires, communs » et produisent de 60 à 80 % des aliments dans les pays du Sud. Contraintes de s’endetter, elles font face à la hausse des taux d’intérêt et sont exposées à ces violences économiques, environnementales et mentales. Enfin le dogme de la flexibilité crée des « zones de libre exploitation des femmes », jugées peu ambitieuses et peu coûteuses, tandis que des organisations comme l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) se félicite de ces « opportunités de développement » et « d’émancipation » des femmes par le travail, et que l’informel explose, donc expose des populations de plus en plus nombreuses à l’absence de régulation, de protection sociale et de droits. Les autrices s’inquiètent du détournement de la notion d’empowerment, tant les possibilités ouvertes aux femmes dans le cadre de stratégies genrées sont loin de leur permettre une véritable émancipation, et sont surtout du genderwashing. « Il est indispensable de radicalement repenser et repolitiser ce que l’on entend par la notion de travail et d’en faire quelque chose de collectivement libérateur et satisfaisant les besoins de tou.tes. »
La troisième partie montre comment les femmes sont aux avant-postes de la dégradation de la protection sociale. Celle-ci, qui était du reste perfectible car conçue sur le présupposé d’une carrière ininterrompue à temps plein, ce qui reste l’apanage des hommes, est attaquée par les politiques d’austérité. Les autrices analysent le démantèlement des prestations sociales (allocations familiales, indemnités chômage, retraites) et comment les réformes fiscales tendent à faire peser « l’effort budgétaire » sur les femmes. Au nom du remboursement de la dette sont attaquées « toute politique et processus participant à l’émancipation des femmes » : coupes dans les subventions aux associations féministes, destruction des services publics… De fait, tout le travail lié à la reproduction sociale (santé, petite enfance…) est renvoyé au privé, donc aux femmes, « via une augmentation de leur travail gratuit et invisible ».
Remettre la vie au centre
La dette devient donc un levier de survie, déplorent les autrices, en analysant tous les types d’endettement privé : dettes étudiantes, crédit hypothécaire, prêts à la consommation et microcrédits aux taux usuriers. Elles montrent aussi comment le genre détermine les conditions d’emprunt, créant de véritables situations d’esclavage.
Dans la dernière partie, Camille Bruneau et Christine Vanden Daelen esquissent des pistes de sortie du système et présentent les recherches écoféministes, qui « revisitent les principes de l’économie dominante et questionne les paradigmes androcentriques qui donnent un rôle subalterne et invisible aux femmes dans le système économique. » Pour elles, il s’agit d’inverser la logique : la dette du care, c’est « la différence entre le care donné et le care reçu ». Cela supposer de valoriser le soin sur le plan économique, social, mais aussi symbolique, en socialiser les responsabilités au sein des ménages et dans l’ensemble de la société. Cette réflexion en profondeur sur les interdépendances et la prise en compte des facteurs invisibilisés constitue un appel fort à l’action, dans le sillage des mouvements anti-dettes et de la mémoire du non-paiement.
Kenza Sefrioui
Nos vies valent plus que leurs crédits. Face aux dettes, des réponses féministes
Camille Bruneau et Christine Vanden Daelen
Le passager clandestin, 288 p., 18
[1] Les communs désignent des formes d'usage et de gestion collective d’une ressource par une communauté. Cette notion permet de s'intéresser davantage à l'égal accès et au régime de partage et décision plutôt qu'à la propriété.


