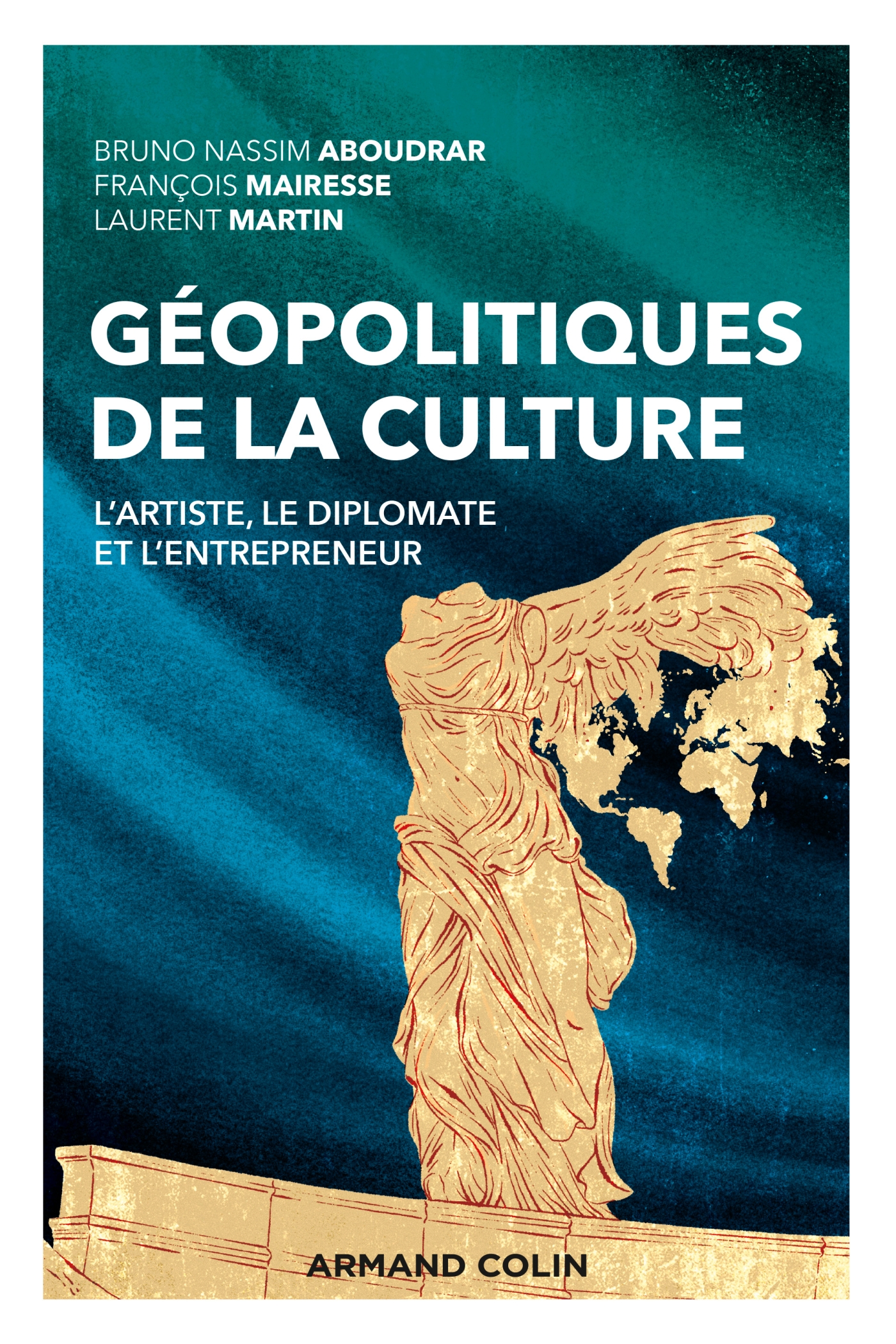
Kenza Sefrioui
Kenza Sefrioui est docteur en littérature comparée, de l'Université Paris IV-...
Voir l'auteur ...Géopolitiques de la culture, l’artiste, le diplomate et l’entrepreneur
Auteur : Bruno Nassim Aboudrar, François Mairesse et Laurent Martin
Cultures en guerre
Dans la compétition interétatique à l’échelle mondiale, la culture figure au nombre des armes employées. Analyse d’un phénomène ancien mais récemment théorisé.
Malgré un discours persistant sur leur caractère éthéré, l’art et la culture sont profondément géopolitiques, c’est-à-dire pris et constitués de dimensions politiques et économiques des plus terre-à-terre, voire des plus brutales. Trois chercheurs français de l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 s’intéressent à ce dispositif complexe. Bruno Nassim Aboudrar est professeur d’histoire et de théorie de l’art, François Mairesse, professeur d’économie de la culture et de muséologie, et Laurent Martin professeur d’histoire et codirecteur du master Géopolitique de l’art et de la culture. Tous trois cosignent un ouvrage où ils abordent cette vaste question par le prisme des relations internationales. « En quoi l’art est-il géopolitique ? » Ce fil conducteur les amène à entrecroiser la perspective de l’histoire, des sciences politiques et de l’économie, mais aussi l’étude des imaginaires construits dans la confrontation et la négociation. Ils s’intéressent tour à tour aux différentes figures impliquées dans ces formes de compétition : les artistes, les diplomates et les entrepreneurs. Le phénomène n’est certes pas nouveau, mais les reconfigurations actuelles du monde lui donnent, estiment les auteurs, une acuité particulière.
De la géopolitique de l’art à l’art géopolitique
La première partie, la plus historique, se penche sur la « géopolitique des artistes » et sur la manière dont ceux-ci, soit aux côtés de l’État, soit en opposition avec lui, ont été associés à un projet national, et leurs œuvres impliquées dans les rivalités politiques. Les auteurs soulignent la « naturalisation de la notion d’art national » à coup de concepts comme le climat, le milieu, la race, le génie… Ils décryptent, avec l’histoire de la biennale de Venise, comment cet événement international a battu en brèche l’acception de « généricité universelle de l’art ». À partir d’exemples comme le Paris de l’entre-deux-guerres ou le « melting-pot » américain, ils analysent l’articulation entre art national et dimension internationale, suscitant tantôt enthousiasme tantôt rejet. Ils envisagent ensuite la circulation des concepts et des références hors du monde occidental : le terme de modernité renvoie à des pratiques très différentes au Japon, où « ce qui peut apparaître comme un emprunt se révèle en fait constitutif de la nationalisation (au sens de devenir national) moderne des arts à une échelle, à l’époque, de plus en plus mondiale – et aujourd’hui réellement « globale » », en Iran où on redécouvre les grandes civilisations millénaires et dans l’Amérique latine des « dévorateurs de modernité ». Avec la guerre froide et les indépendances, les récits des anciens colonisateurs sont contestés. L’école de Casablanca, plaidant pour une abstraction en droite ligne des traditions plastiques anciennes (ce qui n’est pas un « mythe », contrairement à ce qui est écrit) ou l’art de combat de la révolution palestinienne, s’inscrivent dans des logiques de libération et de réappropriation. Plus récemment, les œuvres se font elles-mêmes géopolitiques, « pas seulement par les positions qu’elles expriment, mais par les agencements plastiques matériels et immatériels qui les constituent ». Elles « ne résultent pas d’une commande politique passée par un État, une ONG ou une autorité, ne commémorent pas d’événement diplomatique ou guerrier, mais cherchent plutôt à faire éprouver au spectateur un fait géopolitique dans la complexité de ces dimensions ».
L’évolution de l’arsenal conceptuel
Les trois auteurs s’intéressent ensuite à l’axe de la diplomatie culturelle et aux rapports entre culture et politique depuis la Seconde Guerre mondiale, à l’échelle internationale et transnationale. Ici, les rapports de force sont envisagés non plus à l’échelle des États, mais à celle des différents acteurs, étatiques et non étatiques, « pris dans des relations souvent dissymétriques qui obéissent à des logiques de pouvoir, de puissance, de compétition plus que de coopération ». Développement, mondialisation, décolonisations, anti-impérialisme, démondialisation…, entre hégémonies et résistances, chaque période invente des notions pour orienter la façon dont la relation à l’autre entité prend forme. Les auteurs entrecroisent ici l’histoire, depuis la France de Louis XIV à l’émergence de la Chine, et l’inventaire des pratiques et de leur arsenal conceptuel. La diplomatie culturelle classique appelait les échanges et les relations, la coopération, le rayonnement : il y était question de prestige, de diffusion d’une langue. Depuis les années 1970, il est plutôt question de diplomatie d’influence, au sens plus large : on se veut moins élitiste et paternaliste, il est question non pas seulement de langue et d’arts, mais de dossiers comme la santé, le climat, les marchés, la sécurité, les migrations… Entre approche réaliste et idéaliste, la doctrine s’interroge sur l’efficacité d’actions trop directes qui évoqueraient la propagande. Les auteurs pointent le « paradoxe d’une action qui en appelle aux valeurs universelles pour défendre des intérêts nationaux ». De plus en plus, s’impose dans ce domaine une « stratégie de management de l’image », d’où l’apparition, sous la plume de Joseph S. Nye, de la notion de soft power, de smart power et de nation branding. La puissance n’est plus seulement fonction des armes ou de la monnaie, elle tient à la capacité d’un pays à « influencer les autres pays, à les persuader d’agir dans un sens favorable à ses intérêts ». La culture, en tant que matrice des imaginaires, et le contrôle des sources et vecteurs de l’information, y sont centraux. De même, les acteurs en sont moins l’État que la société civile, dans une approche plus multilatérale. Si le smart power consiste en un continuum entre soft et hard power évoluant selon les circonstances, le nation branding apparaît comme le dernier avatar du concept de géopolitique de la culture. Les auteurs s’interrogent sur la pertinence de son volontarisme, qui se heurte nécessairement à des stéréotypes difficilement modifiables, sur celle de considérer une opinion publique comme une clientèle à séduire et surtout sur sa méthode panachant scientificité et normativité. « Fonds de commerce de cabinets de conseil stratégique », le nation branding est une « vision marketing de la diplomatie », dont les réalisations dépassent rarement le discours performatif. Un inventaire très complet des acteurs étatiques, interétatiques et non étatiques illustre les variations autour des hiérarchies et des questions de représentation, mettant toujours en jeu les notions de prestige, d’universalisme, de différentialisme, pour construire une gouvernance complexe, à multiple niveaux.
Enfin la troisième partie porte sur les ressorts économiques – dans le cadre d’une logique de marché – qui influencent voire instrumentalisent la culture. Les auteurs montrent, l’exemple de Bilbao à l’appui, comment investir dans la culture n’est plus une conséquence de la richesse mais vise à la produire. « Les rapports de force entre les pays se conçoivent de plus en plus, y compris sur le plan culturel – à partir d’une logique commerciale et industrielle ». Des rapports profondément inégalitaires, avec une très forte concentration des éléments de soft power et des industries créatives productrices de la culture mainstream à l’échelle du monde. Et même quand des notions comme celle de diversité culturelle prétendent échapper à cette logique de libéralisation, la reconnaissance n’est que de principe, tant règne la logique de marque et de la concurrence. Si cette lutte de pouvoir dans laquelle est prise la culture est « une guerre sans morts ni destructions », mais bel et bien une guerre, d’aucuns sont fondés à estimer qu’en tant que mode de façonnement des imaginaires, elle ne constitue pas un soft power, mais un hard power.
Kenza Sefrioui
Géopolitiques de la culture, l’artiste, le diplomate et l’entrepreneur
Bruno Nassim Aboudrar, François Mairesse et Laurent Martin
Armand Colin, 320 p., 25 €


