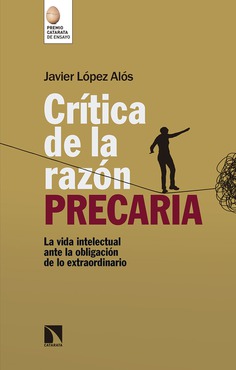
OTHMAN NEJMEDDINE

ZOHRA MAKACH

ALLAE HAMMIOUI

BRAHIM EL MAZNED

Matthieu Duperrex

AZOUINE ABDELMAJID

MERYEM AASSID
Critica de la razon precaria, la vida intelectual ante la obligacion de lo extraordinario (2019)
Auteur : Javier Lopez Alos
Les lois de la précarité
Le philosophe espagnol Javier Lopez Alos analyse les conséquences de la précarisation des intellectuels sur le champ de la pensée et des libertés.
« La précarité touche des individus, mais ce n’est pas une affaire individuelle » : c’est au contraire un fait social qui touche tous les domaines de la vie et auquel la solution ne peut en aucun cas être individuelle. Tel est le propos du philosophe espagnol Javier Lopez Alos dans cet essai qui lui a valu en 2018 le premier prix Catarata de l’essai, et dont il prolonge la réflexion dans El intellectual plebeyo, vocacion y resistencia del pensar alegre (L’intellectuel plébéien, vocation et résistance de la pensée joyeuse, Taugenit editorial, 2021). Critica de la razon precaria est nourri de son expérience personnelle, sa décision de quitter la vie universitaire et d’être chercheur indépendant, un deuil qu’il tâche de transcender sans ressentiment ni autocompassion. Intimement touché par la précarité des milieux intellectuels, c’est sur ce milieu qu’il concentre sa réflexion pour montrer, comme l’indique le sous-titre du livre, comment la pensée est entravée quand « la vie intellectuelle fait face à la contrainte de l’extraordinaire », quand elle est rejetée hors de ce qui fonde une vie normale. Si sa démonstration prend pour objet principalement les professions intellectuelles (universitaires, journalistes, artistes…), les logiques qu’il met à jour vont au-delà de ces milieux et dessinent les lois implacables qui s’imposent à la pensée d’une façon générale.
Menace sur les libertés
Le livre s’articule en deux parties dont la première porte sur les affects générés par la situation de précarité, tels que le ressentiment et la quête de reconnaissance, et les réactions individuelles, comme l’acceptation des règles de la compétition, et, pire, l’autoexploitation. Javier Lopez Alos rappelle l’étymologie latine du mot précaire, renvoyant au statut d’exploitants d’un terrain dont ils ne sont pas propriétaires et dont ils peuvent être expulsés à tout moment. La notion de provisoire est inhérente au concept. De fait, être contraint d’avoir plusieurs emplois pour pallier l’absence de contrat stable empêche les précaires de se projeter dans le long terme, tant à titre personnel que professionnel, donc d’avoir une vie normale. Cela va au-delà d’un phénomène économique, insiste l’auteur : c’est une condition existentielle. Javier Lopez Alos déplore la pression accrue, du fait que le nombre de diplômés augmente mais que le monde du travail ne parvient pas à les absorber. Contrats à durée déterminées, rémunérations modiques, durées de travail interminables dans des conditions lamentables…, ces jeunes diplômés se retrouvent contraints à cette précarité. Et des années plus tard, de moins en moins jeunes, ils sont encore à les subir. Javier Lopez Alos interroge cette équivalence douteuse qui s’impose entre jeunesse et instabilité, alors que la jeunesse devrait être le moment des possibles. Il adresse une pique cinglante à la génération précédente, qui n’a pas tenu ses promesses, a renoncé à protéger la jeunesse mais a bel et bien conservé ses réflexes paternalistes. Mais ce qui l’interpelle au premier chef, c’est l’auto exploitation des précaires eux-mêmes. Ces conditions de précarité, ils les acceptent au nom d’un soi-disant enthousiasme. Il y a là, explique le philosophe, un détournement de la notion même de vocation : sommés de faire sans cesse la preuve de leur mérite et convaincus qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur, les intellectuels précaires, ou plutôt « les précaires intellectuels » puisqu’à ce stade « le travail intellectuel s’adjective », tombent dans le piège. Pour s’en sortir, ils reproduisent eux-mêmes les logiques qui créent cette précarité.
La seconde partie de l’essai s’intéresse aux conséquences de cette situation sur la vie intellectuelle et sur la production de pensée. La liberté intellectuelle nécessite en effet pour se déployer des conditions de disponibilité mentale dont les précaires sont privés. Comment en effet produire une œuvre quand on jongle entre les contraintes ? Comment développer une vision plus large et à long terme quand on est noyé dans les boulots alimentaires ? À la racine de ce cercle vicieux, l’hégémonie des logiques productivistes dans le monde de l’université et de la culture d’une façon générale. La compétition, les critères à la rentabilité et les injonctions à des productions pratiques à court terme sont en effet une machine à exclure et imposent une logique de survie dans des champs où la collaboration devrait l’emporter sur la compétition. Mode de production systématique de précarité, cette « raison précaire » constitue aussi un lieu de production de la subjectivité. Elle a pour conséquence d’aggraver les inégalités existantes dans la société, voire de figer la société dans ces inégalités. Javier Lopez Alos rappelle qu’une démarche moderne tend au progrès, à la liberté. Il s’inquiète des menaces que la précarisation fait peser sur celle-ci. D’abord sur le droit à l’information : si la rentabilité économique est le critère dominant, comment dénoncer et corriger des situations d’injustice ? Dans le champ des savoirs, quelles conséquences cela a, pour les humanités, de qualifier de « non productives » des disciplines qui de fait ne pourront être étudiées que par des étudiant.e.s riches ? Quelle pensée peut être transmise et discutée quand la pression à la visibilité sur les réseaux sociaux et la nécessité d’attirer l’attention – notamment des professionnels installés, dans l’espoir d’être reconnu comme leur égal – contraint les précaires devenir « leur propre marque » et à en faire la promotion comme telle ? Et que dire des dangers de l’accélération qui crée une relation consumériste au monde et à la culture, contraignant les intellectuels à adopter les codes de l’influenceur, et soumettant la profondeur et l’expérience aux exigences de l’immédiateté ? Dans ce système, la valeur de l’intellectuel précaire tient à son exploitabilité, déguisée en méritocratie et en sacrifice, dénonce Javier Lopez Alos. Au précaire intellectuel qui joue ce jeu pervers, il oppose la figure de l’intellectuel plébéien, qui fait face aux inégalités structurelles et qui assume lucidement que la résistance ne peut être que collective.
Critica de la razon precaria, la vida intelectual ante la obligacion de lo extraordinario (2019)
Javier Lopez Alos
Ed. Catarata, 144 p., 14,50
Tisser le temps politique au Maroc, imaginaire de l’État à l’âge néolibéral
Auteur : Béatrice Hibou et Mohamed Tozy
Néolibéralisme à la marocaine
Les politologues Béatrice Hibou et Mohamed Tozy s’intéressent à la façon dont la culture politique marocaine, oscillant entre modèle stato-national et modèle impérial, met en œuvre le néolibéralisme.
Poursuivant leur réflexion sur les transformations de l’État et sur l’art de gouverner, les politologues Béatrice Hibou et Mohamed Tozy prennent pour cas d’étude le système politique marocain, afin de saisir comment il trouve en son sein les ressorts nécessaires à l’acclimatation du néolibéralisme. La chercheuse au Centre d’études et de recherches internationales (CERI) au CNRS, et le professeur des universités à l’IEP d’Aix-en-Provence et ancien membre de la commission de révision de la Constitution en 2011, se penchent dans Tisser le temps politique au Maroc, imaginaire de l’État à l’âge néolibéral sur l’imaginaire qui oriente les représentations et les pratiques du politique au Maroc. Pour eux, c’est en effet « la matrice où se déploient les processus de naturalisation et la légitimation de la violence des rapports de domination ». En hommage à Ibn Khaldoun, l’introduction se double de Prolégomènes pour « donner les clefs de compréhension » des deux types idéaux, l’Empire et l’État-nation, qu’ils identifient comme les deux pôles structurant l’imaginaire politique marocain. Ils y retracent l’histoire des modes de gouvernance, depuis le gouvernement à distance et la rationalisation du pouvoir dans l’État patrimonial, jusqu’à « l’invention du dualisme » et de « l’exotisme légal » par le Protectorat, puis l’Indépendance, marquée par « l’illusion de la toute-puissance de l’État-nation » tandis que le registre impérial travaille en sourdine la monarchie, jusqu’à la « hallalisation du néolibéralisme » dans les années 1995-2005.
Penser par idéal-type
L’ouvrage est structuré en trois parties. La première porte sur les fondements du pouvoir et questionne trois concepts centraux : la représentation, la responsabilité et la violence. Béatrice Hibou et Mohamed Tozy mobilisent les outils de l’histoire, de la sociologie et de l’anthropologie pour décrire la mise en pratique, souvent problématique, de ces concepts. Ils étudient les ambiguïtés de la Constitution, les paradoxes, les impasses. Ainsi de la cooptation, centrale après 2011 : « Cette revitalisation d’une technique longtemps perçue comme arbitraire et que nous avons conceptualisée comme impériale est paradoxalement valorisée par les nouvelles ingénieries néolibérales de la démocratie participative ». De même, malgré la demande de la société, notamment lors du hirak du Rif, la responsabilité du prince persiste à ne pas être liée « indistinctement » à sa population, mais « individuellement », selon les liens tissés, a fortiori « dans un monde médiatisé qui, désormais, célèbre des héros » puisque le responsable estime n’avoir « de comptes à rendre que devant Dieu et l’Histoire ». L’institution de la justice et le désamorçage des recommandations de l’IER montrent le refus d’une institutionnalisation de la responsabilité. Quant à la violence, celle de l’État-nation (lutte pour le pouvoir et la modernisation, brutalité des Années de plomb…) est doublée par la violence impériale (mise en scène et institutionnalisation de la haiba, invention de la tradition, et banalisation de la disgrâce sous la forme des colères royales).
La seconde partie, « Gouverner la nation » s’intéresse à la gestion au quotidien de l’État à travers trois « scènes », représentatives de l’imbrication, de la porosité et de l’hybridation des logiques impériales et stato-nationales, plutôt que de leur antagonisme. Les auteurs notent à propos de Tanger Med que « le projet politique de l’État-nation a été historiquement conduit, et le reste largement, avec des moyens, des outils et parfois des compréhensions qui nous donnent à voir “autre chose”. Cette autre chose – que nous nommons conception impériale, ou encore dispositifs impériaux – fait aujourd’hui écho à l’idéologie néolibérale. » De même, la territorialisation « à géométrie variable », avec une décentralisation problématique, fait question : « Dans l’Empire, l’autonomie des populations et des terroirs locaux ne remet pas en cause les manières de gouverner et les rapports entre l’État et la société. Dans l’État-nation, en revanche, sa mise en place n’a de sens que dans un cadre démocratique. Or, dans le Maroc actuel, la décentralisation, devenue un impératif catégorique de la globalisation néolibérale, ne peut se réaliser qu’en en modifiant la signification, plus précisément en l’apparentant à un gouvernement indirect fort peu démocratique. » Quant à l’administration « en entente », elle est « orientée en fonction d’implicites, de sous-entendus, “comme si” un ordre existait mais en l’absence d’accord, même tacite, puisqu’elle ne repose pas sur l’harmonie et le consensus, mais implique aussi la permanence de luttes et de conflits ».
La troisième partie constitue réellement le cœur du questionnement des auteurs sur « Les affinités impériales dans l’art néolibéral de gouverner ». Dans ce contexte de « réinvention permanente d’une tradition érigée en véritable idéologie », où les pratiques néolibérales se sont acclimatées dès les années 1980 avec un nécessaire adossement au palais, le mot de néolibéralisme est peu employé par les acteurs – sauf par des voix critiques qui se focalisent plus sur ses conséquences (corruptions, inégalités…) que sur le système en soi. Béatrice Hibou et Mohamed Tozy montrent comment le néolibéralisme, porté par des experts et technocrates convaincus « de porter la modernisation au cœur de l’État », s’accommode de modes de gouvernance comme la planification « au nom de la stratégie et de la rationalisation des ressources », ou l’informel au nom de « l’accommodement négocié » et comment il n’apparaît de ce fait pas comme « le résultat d’actions issues d’une force naturelle supérieure (l’État allié aux organisations internationales) » mais le résultat d’interactions mouvantes et relatives.
Un ouvrage trop prudent
Ce livre abondamment documenté laisse cependant perplexe. D’abord parce qu’il postule la bonne foi des acteurs au risque de passer pour « naïf et inconsidérément optimiste », alors même qu’il multiplie les exemples qui appellent une toute autre conclusion : répression du hirak du Rif, non-respect des recommandations de l’IER, persistance de la pratique de la cooptation, emblème du gouvernement par l’arbitraire présentée comme une autre conception de la représentation, absence d’indépendance de la justice…
À vouloir s’attacher à la polysémie des actes qui impose de formuler des hypothèses sur le sens, les auteurs en arrivent parfois à des postulats qui ne convainquent pas : se demander en effet « pourquoi le statut du roi se maintient-il, voire se renforce-t-il lorsque celui-ci est défait et que sa volonté n’aboutit pas ? » et se limiter à une réponse anthropologique (son statut de saint) sans évoquer ici l’appareil répressif à l’œuvre, est l’indice d’une certaine fascination et tend à naturaliser le phénomène. Décrire, certes avec un grand sens de la nuance, les conflits de compréhension liés à la multiplicité des registres en présence occulte la cohérence et le sens d’ensemble d’un projet qui ne repose ni sur l’intérêt général ni sur le respect des institutions qui fondent une démocratie. Il eût été honorable de le dire avec plus de franchise.
La conclusion du livre se termine curieusement sur le constat que les ingénieries de gouvernement décrites tout au long de ces 658 pages sont portées par une minorité en voie d’extinction. Or, si la singularité de cette culture politique puisant à la fois aux sources impériale et stato-étatique est appelée à disparaître, qu’est-ce qui distinguera le Maroc d’un pays néolibéral et autoritaire gouverné par des technocrates aspirant théoriquement au consensus et faisant réprimer les voix dissidentes, comme tant d’exemples ont déjà été étudiés sur tous les continents ?
Kenza Sefrioui
Tisser le temps politique au Maroc, imaginaire de l’État à l’âge néolibéral
Béatrice Hibou et Mohamed Tozy
Karthala, 658 p., 450 DH



