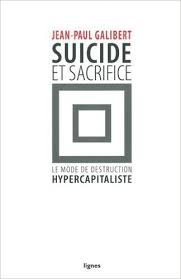
Les évolutions du capitalisme depuis la seconde guerre mondiale instaurent, au nom d’une rentabilité absolue, une logique de destruction : du travail, de l’humain, et au final, de la vie.
Auteur : Jean-Paul Galibert
Cinglant. Le pamphlet de Jean-Paul Galibert grince d’amère ironie face à une réalité terrifiante. Le philosophe relève que dix mille suicides se produisent chaque année en France, soit un toutes les 40 minutes (deux fois plus que de morts sur la route) et que, malgré cela, la réduction du suicide n’est que le 92e objectif sur les cent que compte la loi de 2004 sur la politique de santé publique. Et d’en conclure que cette société « produit des suicides », est « suicideuse ». « Le suicide est le plus indétectable des meurtres sociaux » : pas de massacre, aucune contrainte, aucun coût, aucun risque pénal… c’est « la mort ultralibérale ».
Car c’est bien du système économique mondial qu’il s’agit. L’auteur souligne en effet que les employés et les ouvriers se suicident trois fois plus que les cadres. Le capitalisme traditionnel exploitait les travailleurs mais avait quand même un « double souci d’existence et d’humanité », qui rendait son exigence de rentabilité relative. La rupture date de la seconde guerre mondiale : « On prend tout à coup conscience que le patronat allemand a pu employer presque gratuitement les millions d’esclaves des camps de la mort, tandis que les bombes atomiques américaines révèlent que les démocraties elles-mêmes peuvent fort bien décider de détruire les humains par centaines de milliers » : les germes d’une « société d’extermination » sont semés, comme l’avait déjà relevé François Emmanuel dans son roman, La Question humaine (Stock, 2000 – adapté au cinéma en 2007 par Nicolas Klotz). « Auschwitz et Hiroshima ont sonné le glas de l’obligation proprement capitaliste d’assurer l’existence du travailleur en lui versant un salaire minimal ». L’heure est désormais à l’hypercapitalisme et à ses corollaires : l’hyperrentabilité, qui n’admet aucune charge ni responsabilité ; l’hyperdestruction, c’est-à-dire le démantèlement de l’appareil productif, puisque les usines ne subsistent plus que dans les pays de non droit tandis que les pays du Nord voient proliférer des activités de tourisme, loisirs, publicité, etc. ; enfin l’hypertravail, qui consiste à vendre au consommateur son propre travail imaginaire en lui faisant croire à l’hyperréalité, la réalité, si valorisée, des images et du virtuel.
Société d’extermination
Michel Foucault avec décrit les « sociétés de discipline », Gilles Deleuze les « sociétés de contrôle », on est désormais dans une société suicidaire, qui fonctionne sur la dépréciation systématique de l’humain, le réduisant à un consommateur aussi jetable que ce qu’il doit consommer. La liberté du consommateur après 1968 supposait une offre et des stocks énormes : « Au lieu de répondre à la demande, on s’est mis à la créer de toute pièce. A l’espoir, qui fait désirer à chacun ce qu’il veut, on a préféré le désespoir, qui fait que tous désirent la même chose ». Et pour ce faire, les médias de masse ont largement été mis à contribution. La télé, cette « glu des yeux et des cerveaux », vous persuade que votre vie est un échec ; Internet vous donne une « deuxième chance » : « vous pouvez réussir dans le virtuel tout ce que vous avez raté dans le réel, à condition d’imaginer et de payer. » Un « braquage », en somme. L’idéologie hypercapitaliste s’appuie aussi sur le « néofascisme d’entreprise », qui dévalorise les travailleurs par la précarité qu’il engendre, et qui, avec ses rythmes effrénés, donne des « ordres de négligence » dont le but est de faire « accepter d’avance toutes [les] morts possibles ». Autre levier : la peur. Jean-Paul Galibert note que « la moitié du temps et de l’espace de l’information est consacrée à l’entretien de la terreur » : OGM, pesticides, amiante, Fukushima, cancer, sida, Médiator… Car « la terreur fait bien vendre les journaux, bien regarder les télés, bien regarder les publicités […] bien consommer, bien voter ». Au « fétichisme de la marchandise » du capitalisme, l’hypercapitalime prône un « totémisme de la terreur ». L’auteur relève la multiplication des conduites à risque chez les jeunes, des jeux suicidaires dès l’école primaire et de la dépendance aux drogues – un « business » où l’Etat prélève des taxes allant parfois jusqu’à 80 % du prix de vente. Emblème de cette société d’élimination : la téléréalité « où il n’y a plus de gagnant, il n’y a plus que des survivants » et dont l’enjeu est d’isoler les gens chez eux. « Peu à peu, le caveau devient notre idéal de sécurité », ironise Jean-Paul Galibert, qui rapproche l’hyperamitié des réseaux sociaux, où l’humain se réduit à une liste d’amis virtuelle, de la liquidation des Indiens d’Amérique, parqués dans leurs réserves. L’isolement provoque en effet la dépression et l’autodestruction ? L’hypercapitalisme nie l’existence en tant que fait et la transforme en un « bien extérieur », commercialisable donc périssable et soumise à approbation. Les travailleurs deviennent précaires ? L’hypercapitalisme « vous présente votre exploitation comme une joie désirable ». Tant pis pour les suicidés victimes de Monsanto ou de Coca-Cola.
Négation de tout, de l’humain comme de la réalité, ce système n’hésite pas non plus à tenter de détourner la révolte qui s’accumule à son encontre. « Il tente de faire passer le suicide, le fondement morbide de sa domination, pour l’expression même de la révolte ». La façon dont les médias relient les attentats-suicides, les immolations politiques et les tueurs fous est, pour Jean-Paul Galibert, le summum de l’indécence, car elle transforme les faits en « programmes de suicide-spectacle » : « Un pas de plus, et le grand capital va venir faire la révolution pour vous, chez vous, juste pour vous rendre service », ironise-t-il. Or présenter ainsi le suicide, comme une révolte « hypermédiatique, autodétruite, et prête à l’oubli », vise à faire oublier le syndicalisme, la loi et la lutte collective. A ce « nouvel ordre mondial » morbide, l’auteur oppose l’indignation, morale, collective et non violente. Et il rappelle le choix d’Hamlet, non entre une existence sans vie et une vie sans existence, mais entre l’art et la révolte. A nous de savoir trancher.
Suicide et sacrifice, le mode de destruction hypercapitaliste
Jean-Paul Galibert
Editions Lignes, 88 p., 13 €

